Référence électronique
Azoulai J., (2023), « La mer de Michelet. Une genèse de la peau », La Peaulogie 10, mis en ligne le 28 octobre 2023, [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/mer-michelet
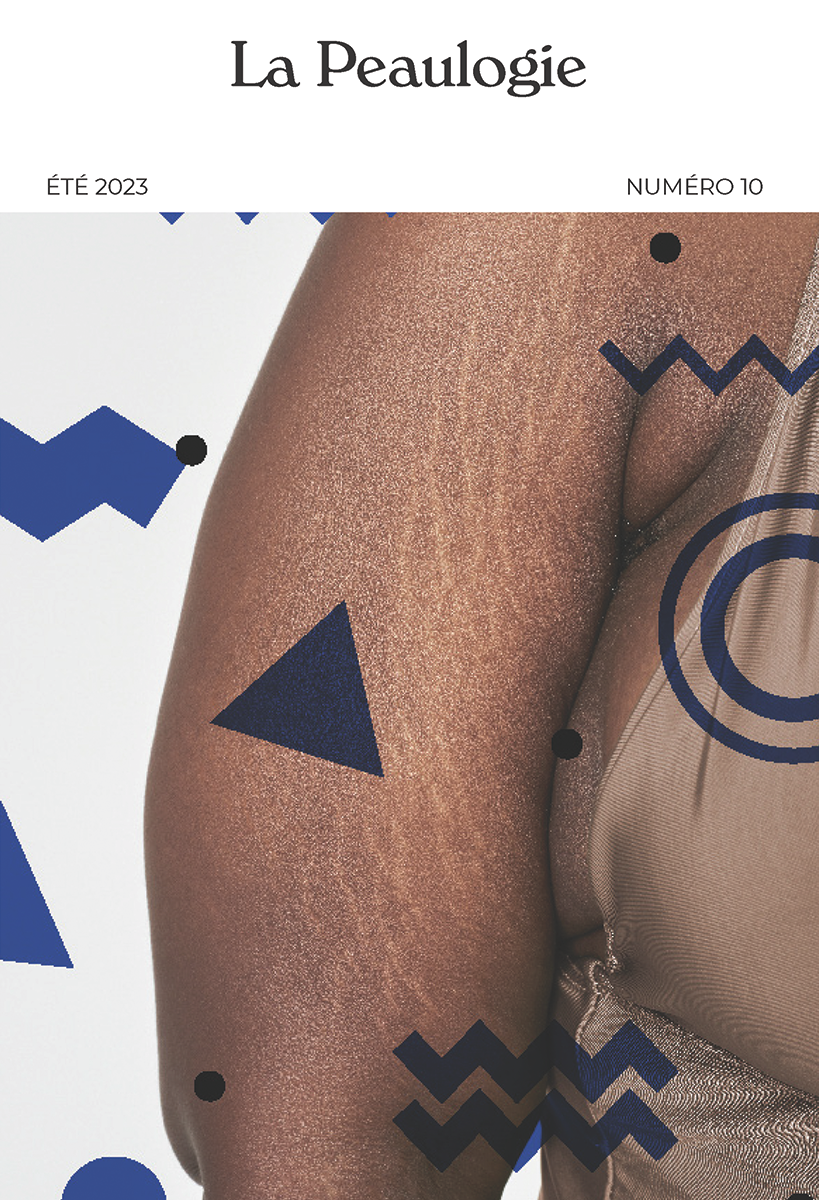
La Mer de Michelet. Une genèse de la peau
-
Description
Juliette AZOULAI
Maîtresse de conférences en Littérature française, LISAA (EA 4120), université Gustave Eiffel, Institut Universitaire de France.
Résumé
Dans le chapitre « Genèse de la mer » de son essai de 1861, Michelet présente un récit de l’évolution des espèces, de l’infusoire marin au lamantin, dans lequel la question de l’enveloppe tient une place centrale (« l’enveloppe, toujours l’enveloppe ») : de la coquille des mollusques (obsédés, selon l’essayiste, par le problème de la protection) à la peau des baleines (« qui frémit et vibre à tout »), en passant par la carapace des crustacés (véritable armure médiévale) et les écailles du poisson (armure souple et donc révolutionnaire), se lit un trajet progressif, qui dessine un accès à l’individuation tout en ménageant une possibilité de relation de l’individu avec le monde extérieur, de contact avec les autres. Ainsi les mammifères marins, au sommet de l’échelle de vivants produits par le milieu océanique, vont, selon lui, jusqu’à développer une faculté de tact et un sens de la caresse. Cet article se propose de suivre à la trace ce motif de l’enveloppe, afin de comprendre comment Michelet, à travers sa vision anthropomorphique de l’animalité marine, propose une sorte de généalogie phénoménologique de la peau et y rattache un certain nombre de valeurs éthiques, voire politiques, fondamentales : sécurité, liberté, communication, mobilité, tendresse, amour, etc.
Mots-clés
Michelet, Vie sous‑marine, Enveloppe, Animaux
Abstract
In the chapter “Genesis of the Sea” of his 1861 essay, Michelet gives an account of the evolution of species, from the marine infusoria to the manatee, in which the question of the envelope holds a central place (“the envelope, always the envelope”): from the shell of mollusks (obsessed by their protection), the carapace of crustaceans (a true medieval armor) and the scales of the fish (flexible and thus revolutionary ) to the skin of the whale (“which shudders and vibrates to everything”), Michelet maps a way towards individualization, that preserves a possibility for the individual to engage with the outside world and with others. Thus, at the higher end of this sea‑induced chain of beings, the marine mammals develop a sense of tact and an art of caress. This article tracks the images of the envelope in Michelet’s essay and examines how the historian, in his anthropomorphic vision of marine animals, puts forward a phenomenological genealogy of the skin and reveals the ethical and political values that ensue: security, freedom, communication, mobility, tenderness, and love.
Keywords
Michelet, Submarine life, Envelop, Animals
Dans son ouvrage d’histoire naturelle La Mer, Jules Michelet entreprend de retracer, au fil d’une rêverie fondée sur les sciences de son temps, l’histoire des espèces marines depuis l’infusoire jusqu’aux mammifères amphibies. La mer, « grande femelle du globe » (Michelet, 1983, 113[1]), y apparaît comme un vaste ventre maternel dans lequel s’élaborent, à travers une sorte d’embryologie cosmique, des formes de vie sous‑marines qui ne cessent de se métamorphoser les unes dans les autres pour former des êtres de plus en plus perfectionnés : c’est le miracle de ce qu’il nomme la « Genèse de la mer », titre du livre II de son essai. S’appuyant sur les théories d’Étienne Geoffroy Saint‑Hilaire et de Lamarck sur la transformation des espèces[2], Michelet propose une vision anthropomorphique du devenir des formes vivantes, dans lequel il perçoit l’émergence d’un certain nombre de valeurs proprement humaines. L’aventure de chaque espèce représente un essai pour défendre, à travers un mode d’être singulier, un idéal ou une priorité éthique[3] (la prudence et la sécurité pour l’oursin, la liberté pour la méduse, la mobilité pour le poisson, etc…). Le bestiaire marin de Michelet ne repose cependant pas sur une série de choix existentiels éclatés, mais s’ordonne selon une échelle des êtres, des formes les plus rudimentaires aux formes les plus complexes. Chaque échelon marque un progrès sur le précédent et l’histoire de ce progrès procède d’une aspiration, inscrite dans le vivant, à « être au‑delà de son être et pouvoir plus que sa puissance » (p. 120) ainsi que d’un désir, toujours relancé, de dépasser une négativité qui ne manque jamais de ressurgir – ce que Michelet nomme « la mélancolie de la mer » (p. 197).
Nous nous proposons de relire cette trajectoire du vivant sous l’angle d’une généalogie de la peau, en examinant la manière dont l’auteur envisage la mer comme enveloppe matricielle, au sein de laquelle ne cesse de se poser, pour les animaux marins qui y vivent, le problème de l’enveloppe corporelle – problème d’ordre biologique, mais aussi philosophique et politique. De la coquille des mollusques à la peau de la baigneuse, en passant par la carapace des crustacés (soumis aux servitudes douloureuses de la mue), par les écailles des poissons et par la peau des baleines, Michelet trace, dans le livre II et IV de son ouvrage, un itinéraire progressif, qui dessine un accès à l’individuation tout en ménageant une possibilité de relation de l’individu avec le monde extérieur, de contact avec les autres, de socialité et même d’érotisme. Il s’agira donc de comprendre comment la mer, selon Michelet, est créatrice de peaux et comment cette création dévoile de manière sensible et incarnée un sens humain inscrit dans la Nature. Pour ce faire, il importera de développer l’idée que Roland Barthes exprimait dans un aperçu extrêmement dense sur l’œuvre de Michelet : « l’eau engendre la peau, c’est au fond la même nappe. » (Barthes, 2002, 313)
LE MUCUS MARIN : PELLICULE ET MATRICE
Pour Michelet, la nature essentielle de l’eau de mer comme « élément universel de la vie » (p. 115) ne peut être appréhendée que dans une expérience tactile. Cette eau, explique‑t‑il, se caractérise en effet par son caractère visqueux : « retenue entre les doigts, elle file et passe lentement » (p. 114). C’est qu’il ne s’agit pas d’une substance inerte, mais bien d’une substance vivante, ce qu’il appelle le « mucus de la mer », d’après les recherches de Bory de Saint‑Vincent[4] et qui serait « une matière à demi organisée et déjà tout organisable » (p. 116). Loin d’être réductible à un simple composé chimique, que l’analyse de ses éléments pourrait entièrement expliquer, l’eau de mer manifeste lorsqu’on la touche sa nature organique. Sa texture gélatineuse indique une forme de corporéité rudimentaire : c’est « le premier degré des corps organiques » (p. 117). Mais ce commencement de l’animation est aussi lié à la mort, selon le principe d’un « circulus vital » (p. 78) qui transforme ce qui meurt en vie nouvelle. C’est alors le modèle de la peau et de la mue qui est convoqué par Michelet :
le mucus de l’eau de mer […] est à la fois une fin et un commencement. Résulte‑t‑il des résidus innombrables de la mort qui les céderait à la vie ? […] Mais la vie, sans arriver à sa dissolution suprême, mue sans cesse, exsude de soi tout ce qui est trop pour elle. Chez nous autres, animaux terrestres, l’épiderme perd incessamment. Ces mues qu’on peut appeler la mort quotidienne et partielle, remplissent le monde des mers d’une richesse gélatineuse dont la vie naissante profite à l’instant. Tout cela ne retombe pas à l’état inorganique, mais entre rapidement dans les organismes nouveaux. (p. 116)
Le mucus marin serait donc cette matière composée des squames du vivant, de cette mort partielle des organismes, qui se transmue aussitôt en existence nouvelle – faisant pour ainsi dire peau neuve. Michelet note d’ailleurs, à la suite du naturaliste Bory de Saint‑Vincent, que cette mucosité enveloppe les corps des plantes et des animaux marins à la manière d’un « habit diaphane » (p. 114), d’une seconde peau.
La consistance gluante du mucus marin est ce qui révèle dans l’immédiateté du sensible la validité de la théorie des générations spontanées. Au moment où l’écrivain publie son essai, cette question est en effet au cœur d’une célèbre controverse entre Félix‑Archimède Pouchet, naturaliste rouennais, défenseur de la thèse de la génération spontanée, et Louis Pasteur, son détracteur, qui triomphera en démontrant que les expériences conduites par son adversaire manquaient de rigueur. Michelet, qui fréquente Pouchet et correspond avec lui, lui apporte son soutien dans La Mer : « Prenons une goutte d’eau dans la mer, nous y verrons recommencer la primitive création » (p. 117). De la matière réputée inerte (la goutte d’eau) au vivant, il n’y a pas de solution de continuité : la vie peut surgir spontanément de la matière morte et ne nécessite pas forcément d’être transmise sous forme de germe par un autre être vivant. En 1861, lorsque La Mer paraît, le débat scientifique sur les générations spontanées n’est pas encore clos (il durera jusqu’en 1864), mais Michelet prend fait et cause pour Pouchet[5] parce que sa thèse, exposée dans un ouvrage de 1859 (Hétérogénie), donne une assise théorique à ce qui se révèle, sous forme de prescience, dans l’expérience primitive et naïve de l’eau de mer. L’enfant qui voit pour la première fois un poisson brillant et glissant entre ses doigts ne peut pas faire autrement, affirme Michelet, que de concevoir cet animal comme « identique à l’élément où il nag[e] » et d’imaginer qu’il n’est « rien autre chose que de l’eau animale, organisée » (p. 115). De même, pour le regard ingénu, comme pour les Anciens, qui la nommaient « gelée marine », la méduse transparente semble de « l’eau gélatinisée ». Et « certains rubans d’un blanc jaunâtre dont la mer fait l’ébauche nouvelle de ces solides fucus, les laminaires qui, brunissant, arriveront à la solidité des peaux et des cuirs » apparaîssent comme du « flot solidifié » (p. 115). Si, dans ce dernier exemple, l’eau de mer produit l’ébauche des peaux de mer que sont les laminaires, c’est peut‑être que cette eau est elle‑même, dans sa puissance de fécondité, productrice d’une peau, ou plutôt d’une petite peau, d’une pellicule : s’étant fait offrir par un pêcheur un oursin et deux étoiles de mer presque mourantes, Michelet raconte qu’il les plaça dans un peu d’eau de mer et que deux jours après :
tout était mort […] la scène était renouvelée :
Une pellicule épaisse et gélatineuse s’était formée à la surface. J’en pris un atome au bout d’une aiguille, et l’atome, sous le microscope, me montra ceci :
Un tourbillon d’animaux […] allaient, venaient, ivres de vie. […]
Pour trois animaux perdus j’en avais gagné des millions. (p. 124‑125)
De cette constatation Michelet tire la conclusion que « la vie des imperceptibles surgit immédiatement des débris que la mort lui lègue » (p. 126) et il se réfère alors directement aux récentes expériences de Pouchet, qui ont établi que le premier stade de la génération spontanée consistait, dans des infusions riches en matière organique morte, en l’apparition d’une « gelée féconde », d’une « “membrane prolifère” d’où naissent non pas de nouveaux êtres, mais les germes, les ovules d’où ils pourront naître ensuite » (p. 126). Les termes de membrane et de pellicule sont empruntés au texte de Pouchet. Celui‑ci évoque la « pellicule » ou la « membrane proligère »[6] (et non « prolifère » comme l’écrit Michelet), qui désigne, d’après l’Hétérogénie, la mince couche qui se forme à la surface des liquides observés, constituée de débris de microzoaires :
C’est cette mince pseudo‑membrane que j’ai nommée pellicule proligère, parce qu’il est évident que c’est elle qui, à l’instar d’un ovaire improvisé, produit des animalcules. On peut y suivre leur développement à l’aide de nos instruments et reconnaître qu’ils s’engendrent à même les débris organiques dont elle se compose. (Pouchet, 1859, 353.)
L’analogie tracée par Pouchet entre la pellicule proligère et l’ovaire[7] trouve un écho particulier dans le texte de Michelet, qui ne cesse au cours de son essai de comparer la mer à un ventre maternel, à « une matrice infinie où sans cesse de nouveaux enfants viennent nager comme en un lait tiède » (p. 117). L’eau de mer constitue ainsi une enveloppe primordiale du vivant, qui à la manière d’une matrice, c’est‑à‑dire d’un moule, donne forme et contour à des « fœtus à l’état gélatineux » (p. 117), selon l’image régulièrement convoquée par Michelet pour désigner les créatures marines. Dans son article « L’osmose émersive » (2019), le philosophe Bernard Andrieu dessine le trajet qui conduit de la peau vivante du fœtus in utero à la peau vécue de l’enfant caressé : reprenant une formule de Luce Irigaray, il indique ainsi que la vie « s’habite d’abord de l’intérieur d’une peau qui n’est pas la sienne » (Andrieu, 2019, 41) : la pellicule du mucus marin incarne cette peau originaire à l’intérieur de laquelle la vie peut se développer. L’ontogénèse de la peau vécue proposée par Andrieu pourrait ainsi entrer en résonance avec la phylogénèse de la peau esquissée par Michelet dans La Mer. En effet, Michelet est un grand admirateur des travaux d’embryologie d’Étienne Serres[8], l’un des tout premiers scientifiques du xixe siècle à postuler un parallélisme entre « la chaîne du règne animal » et « celle des formations embryonnaires » (Serres, 1860, 14). Les animaux inférieurs que sont les animaux marins apparaîssent dès lors comme des espèces arrêtées aux étapes embryonnaires du développement des animaux supérieurs.
ÉVOLUTION ET DESTIN DES ENVELOPPES
Le corail est le premier animal marin de la série qu’examine Michelet : il s’agit de l’ouvrier du globe, qui œuvre sans relâche à fabriquer de nouvelles terres en exhaussant les fonds marins par des constructions madréporiques sur lesquelles d’autres espèces peuvent venir se développer. Dans la logique d’un imaginaire de la génération spontanée, Michelet décrit ce « faiseur de monde » (p. 141) comme la résultante d’un durcissement de la « gelée vivante » (p. 146). Les polypes du corail sont des animaux vivant en communauté sur un même squelette madréporique : cette vie communautaire et fixée assure la stabilité nécessaire pour offrir l’hospitalité à des créatures plus élevées sur l’échelle des êtres (végétaux, poissons, etc.). Reprenant les analyses de Darwin sur la formation des îles madréporiques, Michelet présente ainsi le corail comme un animal capable d’aménager dans les conditions hostiles de la houle marine un système de remparts en anneaux abritant des bassins d’eau douce ou saumâtre propices au développement de formes de vie variées. Le mode de vie du corail est ainsi empreint d’altruisme, de modestie et d’abnégation, mais c’est une existence collective, non‑individuée, et surtout immobile et pétrifiée – ce qui génère une forme d’insatisfaction, propice à la marche progressive de l’évolution des espèces : « Tout polype n’est pas résigné à rester polype. » (p. 149)
C’est de cette insatisfaction que provient la méduse, créature qui a fait le choix de l’individuation, de la mobilité et du voyage, en abandonnant la communauté polypière pour partir seule « voir l’inconnu, le vaste monde » (p. 149). Elle opte pour la liberté aux dépens de la sécurité : pour cela elle doit vivre seule, loin de « l’association qui fit la sécurité du polype » (p. 153), et assumer par là sa vulnérabilité. Contrairement au polype qui, même mutilé, peut se régénérer par bourgeonnement, la méduse, elle, risque sa peau, ou plutôt risque l’aventure de l’émancipation, sans aucune défense, ni protection, car c’est une de ces « molles et tendres créatures qui n’ont pas même de peau » (p. 139) : « ébauche de la nature libre – embryon de la liberté », elle essaie « d’être soi‑même, d’agir et de souffrir pour son propre compte » (p. 154), mais elle est si peu armée pour cela qu’elle s’expose à être en permanence blessée : « elle ne se cuirasse pas d’épiderme résistant, comme nous autres animaux de la terre ; elle reçoit tout à vif. » (p. 151) Cette faiblesse est corrélée à une extrême sensibilité : « elle a le toucher fort délicat, beaucoup trop pour son malheur » (p. 155). À cette créature embryonnaire, si précocement expulsée du giron maternel de l’association madréporique qu’elle n’a même pas pu se constituer une enveloppe, manque une des fonctions fondamentales du moi‑peau selon Didier Anzieu[9] : la fonction de pare‑excitation, qui lui permettrait de se protéger des agressions extérieures et de l’excès des stimulations. On notera qu’Anzieu dans sa théorie du moi‑peau mobilise plusieurs modèles issus du bestiaire marin pour penser les pathologies du moi‑peau : moi‑peau algue, moi‑peau poulpe ou moi‑peau crustacé[10]. Le texte de Michelet, par la puissance de son imagination anthropomorphique, invitant le lecteur à se mettre (littéralement) dans la peau des animaux marins, constitue sans doute l’un des éléments de l’arrière‑plan culturel et intellectuel dans lequel s’inscrit Anzieu lorsqu’il reprend ces mêmes analogies animalières pour penser la genèse et le fonctionnement des enveloppes psychiques.
Pour résoudre le problème de cette extrême vulnérabilité et de la douleur propre à l’être « sans défense et nu » (p. 161), surgit une forme dont « tout l’effort porte sur un violent renforcement des enveloppes » (Richard, 1999, 38) : l’oursin. Comme la méduse, c’est un être qui tend vers l’individualité, mais qui pousse cette logique jusqu’au solipsisme, comme l’indique la tirade que Michelet lui prête :
Je ne veux qu’une chose, être… être un […] être ramassé […] – l’être enfin centralisé. […] je résoudrai […] le problème de la sureté. […] Couvert d’épines mobiles, je me ferai éviter. Hérissé, seul comme un ours, on m’appellera l’oursin. (p. 163)
La vie de l’oursin est gouvernée par un principe de prudence et de crainte (aux antipodes de l’aventureuse méduse) : il a « posé la borne du génie défensif » en construisant autour de lui une véritable « cuirasse » faite de « pièces mobiles, résistantes, cependant sensibles » (p. 167). Si le corail, prisonnier du squelette collectif, n’avait pas de chair propre, si la méduse, toute chair, n’avait pas de peau, l’oursin, lui, est une chair séquestrée, repliée sur son quant‑à‑soi, à l’abri d’un squelette externe qui l’isole du monde extérieur. Son test en forme circulaire lui assure une centralisation propice à l’émergence d’un moi (« l’être centralisé »), ainsi que le manifeste la prosopopée de Michelet : si les polypes du corail parlaient à la première personne du pluriel, l’oursin est le premier à dire « je ». Son enveloppe épineuse lui assure un mode d’individuation permettant de différencier son moi du non‑moi et d’« exclure l’ennemi » (p. 163). Hélas, un tel chef‑d’œuvre dans la protection du moi conduit l’animal à devenir prisonnier de lui‑même, « privé de toute relation qui fait le progrès » (p. 168). En « sa jouissance solitaire de sécurité bienheureuse » (p. 166), il perd tout rapport au monde[11]. C’est précisément cette dialectique entre sécurité et communication qui constituera le problème fondamental du coquillage bivalve d’après Michelet : « […] il faut qu’il soit garanti, mais en même temps en rapport avec le monde extérieur. Il ne peut pas, comme l’oursin, s’isoler. » (p. 171) Ermite, lui aussi, le coquillage se cloître dans sa maison‑coquille, mais cette « vie craintive est toute pleine de mélancolie » (p. 172) et risque fort de devenir irrespirable. Aussi s’efforce‑t‑il de ménager dans sa demeure quelques ouvertures – autant d’entrebâillements qui sont parfois une « porte ouverte à la mort » (p. 168).
À l’opposé de cette logique défensive (qui va de pair avec une forme de pacifisme), le poulpe, lui, qui appartient encore au monde gélatineux et vulnérable, opte pour une stratégie offensive, consistant, non pas à préserver son intégrité, mais à vivre aux dépens des autres. Au lieu de s’envelopper d’une cuirasse, il choisit plutôt de s’enfler, de se dilater démesurément : Michelet le dépeint comme un mollusque devenu « ballon », « vessie absorbante, qui, de plus en plus gonflée et d’autant plus affamée […] suça » (p. 177). C’est pourquoi il est « le suçeur du monde mou » ; le vide qui l’habite le rend d’autant plus avide : « Il offre l’aspect étrange, ridicule, caricatural, s’il n’était terrifiant, de l’embryon allant en guerre, d’un fœtus cruel, furieux, mou, transparent, mais tendu, soufflant d’un souffle meurtrier. » (p. 177‑178) Comme les autres créatures molles, c’est un fœtus, par conséquent un être capable de souffrir et de sentir, mais qui a choisi d’occulter sa vulnérabilité et sa sensibilité en se vouant à la cruauté. Choix sans avenir, selon Michelet, car c’est le choix de l’orgueil et de la vanité, qui ne repose que sur du néant et qui doit rapidement retourner au néant :
tu n’as rien au‑dedans. […] Sans base, sans fixité, de la personnalité tu n’as que l’orgueil encore. […] tu n’es qu’une poche, – puis, retourné, une peau flasque et molle, vessie piquée, ballon crevé, et demain un je ne sais quoi sans nom, une eau de mer évanouie. (p. 181)
Le poulpe, au fond, est une « peau ». Mais il n’est que cela, une pure surface qui n’est connectée à rien ni au‑dedans, ni au dehors : c’est une peau emplie de vide et boursouflée – ce qui en fait un être essentiellement faux[12] et par conséquent condamné.
Autre stratégie, tout à la fois offensive et défensive : celle du crustacé, qui entoure son corps d’une armure redoutable, tout à la fois protectrice (carapace) et agressive (pinces, mandibules, tenailles, etc.) : « Son inattaquable armure est en état d’attaquer tout. » (p. 185) Cependant la carapace « fixe et dure » devient vite carcan, « ne prêtant pas aux variations de la vie » (p. 185). Si le coquillage souffrait, dans son habitacle, de se fermer trop à l’espace environnant, le crustacé, lui, souffre, dans son blindage, de n’être pas assez ouvert aux fluctuations du temps, et notamment à l’évolution du vivant, « à la croissance, à l’extension progressive des organes » (p. 186). L’armure se fait alors « entrave » (p. 185), dont le crustacé doit se libérer (on retrouve là la dialectique de la sécurité et de la liberté qui opposait le polype à la méduse), au prix d’une coûteuse régression : la mue, qui le « précipit[e] tout à coup de la vie la plus énergique à une déplorable impuissance » (p. 187). En effet, la cuirasse doit s’amollir, « se dépouill[er], se pel[er], jet[er] une partie d’elle‑même », pour devenir « une peau » (p. 186). Michelet médite alors sur cette « mort partielle » (p. 186) que constitue la mue et qui est la condition de la vie : opération mélancolique par essence chez tous les êtres qui la connaissent, car il s’agit d’accepter de s’affaiblir pour se renouveler. Oiseaux changeant de plumage, serpents changeant de peau éprouvent une certaine tristesse, qui reste plus vague et imperceptible chez les humains dont la peau mue imperceptiblement tous les jours (p. 186). En revanche, la mue du crustacé est une épreuve déchirante, dans tous les sens du terme :
Combien la chose est plus terrible chez l’être où tout doit changer à la fois, la charpente se disjoindre, l’inflexible enveloppe s’écarter, s’arracher. Il est accablé, assommé, défaillant, absent de lui‑même, livré au premier venu. (p. 187)
En des pages poignantes, Michelet décrit le désarroi de ce tyran des mers devenu brusquement serf, expérience d’une extrême vulnérabilité, d’autant plus pathétique qu’elle touche l’être qui était le mieux armé au monde. Ce revers de fortune amène ainsi le fort à « subir la loi des faibles » (p. 186), en devenant la proie de ses proies. La mue déclasse le crustacé, pour reprendre l’image sociale de Michelet, or ce déclassement introduit une forme de jeu dans ce monde inégalitaire et très Ancien Régime : l’historien de la Révolution, qui souvent pense le devenir historique sur le modèle de la Nature, a aussi tendance à méditer sur le devenir naturel en prenant appui sur des modèles socio‑historiques. Filant la métaphore, Michelet compare les ruses de certains crustacés pour protéger leur corps fragilisé par la mue aux « expédients » dont vivent les « intrigants », les « gens déclassés », « sans métier avouable » : ainsi le Bernard‑l’ermite s’empare de coquilles de raccroc pour y abriter la partie de son corps « qui reste molle » (p. 188).
Mais cette alternance de la force tyrannique et de la faiblesse absolue n’a rien d’émancipateur. Elle empêche tout réel progrès social en maintenant des hiérarchies immuables. Tous ces êtres obsédés par « le problème accablant de la défense extérieure », qui ne songent qu’à « l’enveloppe, toujours l’enveloppe », sont de fait des êtres « tardigrades » (p. 191), marchant lentement, évoluant peu, fermés au mouvement. Face à eux apparaît un être subversif, de « libre audace », qui opère un véritable déplacement copernicien du point de vue : « Le crustacé s’entourait comme d’un squelette extérieur. Le poisson se le fait au centre, en son intime intérieur, sur l’axe où les nerfs, les muscles, tout organe viendra s’attacher. » (p. 191) Ce passage de l’exosquelette du crustacé à l’endosquelette du poisson s’appuie sur les recherches en anatomie comparée d’Étienne Geoffroy Saint‑Hilaire dans la première moitié du xixe siècle. Celui‑ci avait en effet défendu l’idée d’une unité du plan de composition du règne animal en montrant notamment l’analogie de structure entre les invertébrés (comme les insectes ou les crustacés) et les vertébrés. Un des éléments clés de ses recherches a consisté à présenter le crustacé (ou l’insecte) comme un animal vivant au‑dedans de sa colonne vertébrale[13]. Cette représentation de la vertèbre comme pouvant aussi bien être à la périphérie qu’au centre des organismes se retrouve chez Michelet, qui évoquait déjà, à propos du test sphérique de l’oursin, son « ébauche vertébrale » (p. 163). Une fois admis avec Geoffroy Saint‑Hilaire que le crustacé et le poisson ne diffèrent pas en nature mais seulement dans le positionnement de leurs organes par rapport au squelette, il devenait logique d’admettre la théorie transformiste selon laquelle le poisson dérive du crustacé par une métamorphose de son schéma anatomique : la continuité entre ces deux formes est assurée par ce cylindre dur que constitue la vertèbre et qui peut aussi bien faire office d’enveloppe que de charpente. On voit ici comment sont intimement liés, dans la pensée de Michelet, le soutien intérieur du corps par le squelette et sa protection extérieure par une écorce. Cette « révolution hardie » (p. 192), opérée par le poisson, est à comprendre comme un vrai retournement des coordonnées du vivant, mais aussi, dans un sens politique, comme un renversement du système de valeurs antérieur : l’enveloppe n’est plus une priorité mais devient « chose subordonnée » (p. 191). Au lieu de chercher la sûreté, il s’agit de viser à la force et au mouvement, seules conditions d’une vraie liberté (bien supérieure à la tentative embryonnaire et irréfléchie de la méduse). Or comme toutes les révolutions, celle‑ci n’est d’abord pas prise au sérieux par ceux qui ne peuvent entrevoir le nouveau monde qu’elle inaugure, empêtrés qu’ils sont dans l’ancien :
Le crustacé dut en rire, quand il vit la première fois un être mou, gros, trapu (les poissons de la mer des Indes), qui, s’essayant, glissait, coulait, sans coquille, armure ni défense ; n’ayant sa force qu’au‑dedans, protégé uniquement par sa fluidité gluante, par le mucus exubérant qui l’entoure, et qui, peu à peu, se fixe en écailles élastiques. Molle cuirasse qui prête et plie, qui cède sans céder tout à fait. (p. 191)
Le poisson fait de la sorte figure de sans‑culotte, moqué par la vieille aristocratie crustacée qui ne sait pas reconnaître l’histoire en marche : comme l’écrit Jean‑Pierre Richard, les poissons de Michelet « pour instinct ont la liberté dynamique, pour idéologie l’en‑avant. Ce sont des êtres progressistes […] » (1999, 51). Mais, une fois de plus, ce progrès représenté par le poisson présente une part de négativité – ce qui concourt à cette « alternative de plaisir et de douleur » (p. 161) dans laquelle Michelet perçoit le moteur de l’évolution des espèces, par l’aspiration du vivant, toujours relancée, à une vie meilleure. L’ombre au tableau de la « félicité » (p. 195) du poisson est la difficulté pour « organiser l’amour » (p. 198). L’excès du mouvement interdit la véritable rencontre amoureuse. Aussi les poissons doivent‑ils se contenter du frai, c’est‑à‑dire de « l’amour vague encore, élémentaire, impersonnel », mode de reproduction anonyme dans lequel l’animal ne connaît ni « l’être aimé », ni sa « postérité » (p. 198). Cette impossibilité de l’union amène donc les « races de la mer » (p. 258) à rêver d’une fixité, d’une stabilité, qui trouvera son accomplissement dans les espèces terrestres.
Toutefois l’ultime étape du destin des espèces marines est incarnée par les mammifères marins et amphibies. La baleine en particulier, « vraie fleur du monde » (p. 203), est un animal dont toute l’existence exprime une tension vers l’amour, notamment l’amour maternel : « la mère allaite avec tendresse » (p. 202). Ce contact prolongé de la mère allaitante avec son enfant est bien entendu lié à l’apparition d’un nouveau fluide corporel : le lait. Celui‑ci est en continuité directe avec la substance même du mucus marin, que Michelet désignait, dès le début de son essai, tantôt comme un liquide amniotique, tantôt comme un lait. Le lait maternel de la baleine découle du mucus lactescent, conformément à la représentation d’un monde lisse et « sans couture » (Barthes, 2002, 259), si chère à Michelet, et dans laquelle l’eau est le liant universel :
Le lait de la mer, son huile, surabondaient ; sa chaude graisse animalisée fermentait dans une puissance inouïe, voulait vivre. Elle gonfla, s’organisa en ces colosses, enfants gâtés de la nature […]. (p. 203)
Le corps de la baleine semble né par génération spontanée d’un gonflement du mucus qui se serait agencé en énorme mammifère marin : comme l’écrit Paule Petitier, pour Michelet, « la mer n’est pas l’espace où vit le poisson, mais la matière déjà à demi vivante où il se précise » (Petitier, 2021b, 91). Cela vaut aussi bien pour la baleine : la mer de lait devait tôt ou tard s’organiser en mamelle marine, en organe lactifère. La mer, grande femelle du globe, devait engendrer cette « grande femme de mer » (p. 204) qu’est la baleine. Alors que les animaux précédents restaient égoïstement soucieux de leurs enveloppes protectrices, la baleine, être de pure générosité, est une créature qui se donne, qui s’épanche, répandant, au prix de sa vie, ses fluides vitaux et vivifiants : « tonneau[x] de lait » (p. 207) pour son petit ; « torrent » de sang chaud qui « inonde la mer en un moment, la rougit à distance » (p. 204), dès qu’elle est blessée. Nature expansive, exubérante, c’est‑à‑dire, au sens étymologique, débordante, parce que regorgeant d’amour. Or cette prodigalité, cette capacité à se donner, sont liées à un affinement, à un raffinement de son enveloppe, qui fait sa vulnérabilité mais aussi sa prodigieuse sensibilité :
On est plus vulnérable, bien plus capable de jouir, de souffrir. […] tout en elle profite au toucher. La graisse, qui la défend du froid, ne la garde nullement d’aucun choc. Sa peau, finement organisée, de six tissus distincts, frémit et vibre à tout. Les papilles tendres qu’on y trouve sont des instruments de tact délicat. (p. 204)
La baleine est le premier animal selon Michelet à être doté d’une peau capable de sentir, de toucher et d’être touché. Cette prédominance du toucher, cette exacerbation du tact, en fait un être relationnel, un être d’attachement, particulièrement attachant aux yeux de l’écrivain. Mais son destin est d’autant plus tragique, car cet effort d’attachement est voué à l’impuissance et à l’échec : le couple de baleines s’élève hors de l’eau pour essayer de s’embrasser mais « gémiss[e]nt de leurs bras trop courts » (p. 206), avant de retomber lourdement ; de même, l’enfant ne peut que s’abriter sous le ventre de la mère, mais n’y a aucune « prise » et « prend le lait comme au vol » (p. 207).
Ce n’est qu’avec les espèces mammifères amphibies que pourra se résoudre le problème : pour ne pas traîner sur le sol dur de la terre, les mamelles remontent en haut du corps, ce qui laisse apparaître « l’ombre de la femme » (p. 209). Ce changement anatomique exige aussitôt de pouvoir hausser l’enfant jusqu’au sein, requiert donc le holding maternel (selon le terme consacré par Winnicott[14]). Ce holding était « refusé à la mère qui nageait » (p. 210) ; il devient possible chez la mère amphibie. Or ce contact prolongé, peau contre peau, entre la mère et l’enfant, est ce qui est selon Michelet à l’origine de la socialisation :
La fixité de la famille, la tendresse, à fond ressentie, et approfondie chaque jour (disons plus, la Société), ces grandes choses commencent dès que l’enfant dort sur [le] sein. (p. 210)
Pour remplir cette fonction (tenir l’enfant), le lamantin femelle s’est même créé un organe spécifiquement voué à la tendresse :
La nature s’ingénie dans l’idée fixe de caresser l’enfant, de le prendre et de l’approcher. Les ligaments cèdent, s’étendent, laissent aller l’avant‑bras, et de ce bras rayonne un polype palmé. – C’est la main. (p. 214)
Cette naissance de la main, ainsi relatée à travers un récit en forme de métamorphose ovidienne, signe l’avènement d’un nouveau rapport au monde : c’est ce qui fera advenir l’art et la technique, mais aussi ce qui, à travers la caresse et le maintien de l’enfant auprès de sa mère, ouvrira le champ de l’éducation. L’expérience sensorielle de la surface du corps joue un rôle majeur dans l’avenir des espèces : l’enveloppement maternel du bébé lamantin constitue une seconde peau, culturelle, permettant le progrès individuel par l’éducation (peau élastique en quelque sorte), mais aussi la fabrication d’une appartenance sociale (peau collective).
« De ses caresses assidues » (p. 123), la mer avait créé sur le rivage des renfoncements propices à l’apparition de la vie, comme l’indiquait Michelet au début de son essai ; il évoquait également la « puissante main » de l’océan, dans laquelle le baigneur se sent comme « un faible enfant » (p. 44). Ainsi, selon une logique cyclique, bien relevée par Michel Serres (1974, 788), cette main caressante et maternelle de la mer devait donner naissance à une autre main caressante et maternelle. D’un attouchement à l’autre, c’est tout une érotique du toucher marin qu’élabore Michelet, englobant aussi bien l’amour impersonnel de l’élément, que l’amour de l’amant pour l’aimé et l’amour de la mère pour l’enfant. Or cet érotisme de la peau marine culmine dans le contact de la peau humaine avec la mer.
JUSQU’À L’HUMAIN : VÉNUS EN PEAU MARINE
Dans la dernière partie de son ouvrage (livre IV, « La renaissance par la mer »), Michelet fait l’éloge des séjours balnéaires et de leur puissance thérapeutique : la mer, dotée du pouvoir de faire la vie (comme il l’a montré dans le livre II, « Genèse de la mer ») a également la capacité de la refaire, grâce à la puissance vivifiante du « mucus embryonnaire » (p. 283). C’est en particulier la « jeune femme maladive » (p. 284) qui doit venir chercher dans les bains de mer la restauration de sa santé, par l’absorption des propriétés vitales de l’eau de mer. La mer est non seulement le lieu de la naissance de Vénus, comme le veut le mythe antique, mais aussi de sa renaissance, sous la forme d’une baigneuse resplendissante de santé, « non pas la Vénus énervée, la pleureuse, la mélancolique – la vraie Vénus victorieuse, dans sa puissance triomphale de fécondité et de désir. » (p. 277‑278)
Grâce aux bains de mer, la malade peut « s’imbiber des vertus des eaux » (p. 310), à la manière d’une éponge. Le bain dans cette eau pleine de mucus n’exerce pas seulement une action en surface sur le corps, mais le traverse et y infuse une vigueur nouvelle : il peut fortifier l’ossature, redonner du tonus ou de la chaleur, reconstituer le sang (p. 284). Il se produit en effet une infiltration des principes actifs de l’eau de mer à travers les pores de la peau :
Notre peau, qui, tout entière, se compose de petites bouches, et qui à sa façon absorbe et digère comme l’estomac, a besoin de s’habituer à cette forte nourriture, à boire le mucus de la mer, ce lait salé qui est sa vie, dont elle fait et refait les êtres. (p. 310)
On pourrait donc dire que la peau de la baigneuse ressemble aux animaux marins qui, d’après Michelet, semblent pour la plupart « des fœtus […] qui absorbent […] la matière muqueuse » (p. 117). La femme se réfléchit d’ailleurs en eux comme dans un miroir : contemplant des annélides nageant au creux d’un rocher, elle « se sent et se reconnaît », « à ces couleurs rougissantes et pâlissantes tour à tour » (p. 307) qui sont les leurs. La peau de la Vénus en villégiature est faite de la même étoffe colorée que les fragiles et gracieuses créatures marines. Comme ces dernières, elle se nourrit du mucus qui donnera à la femme « la moelleuse consistance de son être » (p. 283). Cette percolation de l’eau marine à travers la peau va jusqu’à la moelle, pénètre la profondeur du corps mais aussi du cœur. Ainsi, explique Michelet, le désir féminin, en bord de mer, se réveille, sous forme de « bouillonnement » : « Nulle part plus qu’aux bains de mer on n’est imaginatif. » C’est un véritable « orage intérieur » (p. 312), qui rejaillit à l’extérieur, en traces affleurant sous la peau :
La mer, l’impitoyable mer, amène et révèle à la peau toute cette excitation qu’on voudrait garder secrète. Elle la trahit par des rougeurs, de légères efflorescences. […] [Les femmes] en sont humiliées […]. Elles craignent d’en être moins aimées. Tant elles connaissent peu l’homme ! Elles ignorent que le grand attrait, le plus vif aiguillon d’amour, c’est moins la beauté que l’orage. (p. 312)
La mer possède une vertu aphrodisiaque (pour la femme, comme pour l’homme), qui se révèle dans l’aventure, tout à la fois intime et visible, d’une peau féminine au contact de l’eau.
Cette sensualité à fleur d’eau et à fleur de peau s’exprime également dans le port de certains bijoux en matière marine, corail ou perle. C’est en effet le bijou porté qui intéresse Michelet et plus spécifiquement le collier, posé sur la gorge, conçu comme une peau au contact d’une autre peau. La femme elle‑même, dans le discours que lui prête Michelet, se représente davantage le bijou en corail comme une expérience tactile et sensuelle que comme l’instrument d’un embellissement destiné aux regards extérieurs. Au brillant des rubis, elle préfère, écrit‑il, la douceur du corail : « il a la douceur d’une peau et il en garde la tiédeur. » (p. 140) Cette contiguïté entre le bijou et la peau aboutit à une union érotique. Il y va d’un secret accord entre deux corps vivants : Michelet postule ainsi que la femme a senti, bien avant les savants naturalistes eux‑mêmes, que le corail était un animal et non une simple pierre. Or, cette mystérieuse entente repose sur une similitude profonde entre les deux : les rosissements du visage et le rouge du corail proviennent d’une même substance chimique, d’après la science : « dans le corail, comme sur sa lèvre et sur sa joue, c’est le fer qui fait la couleur. » (p. 140) La relation de la femme à son bijou est en ce sens homoérotique (puisqu’il lui est analogue) et confine même à l’autoérotisme, car la proximité qui existe entre eux finit par les confondre en une même chair : « Dès que je l’ai deux minutes, dit‑elle à propos du corail, c’est ma chair et c’est moi‑même. Et je ne m’en distingue plus. » (p. 140) De même la perle, « quand elle a dormi tant de nuit sur son sein, dans sa chaleur, quand elle s’est ambrée de sa peau et a pris ces teintes blondes qui font délirer le cœur », devient « une partie de sa personne » (p. 175). Fantasme fétichiste, qui exprime en même temps la profonde homogénéité postulée par Michelet entre ces matières marines et le corps de la femme : deux carnations pâles ou rougissantes, deux beautés non pas froides et minérales mais chaudes et vivantes, deux peaux douces, polies dans les profondeurs mystérieuses d’une intimité (fond de l’océan, nudité secrète).
Dans L’Eau et les Rêves, Bachelard révélait comment la psychologie des eaux violentes pouvait générer un imaginaire de la peau : dans le « complexe de Swinburne » se manifeste la jouissance masochiste du nageur à se laisser flageller par les flots ; dans le « complexe de Xerxès », s’exprime au contraire le fantasme sadique de punir l’eau en la faisant fouetter (Bachelard, 1942, 213‑249). Dans les deux cas, la relation à l’eau implique une blessure, un marquage fait à l’épiderme. La littérature française du xixe siècle sur la mer donnerait encore bien des exemples pour illustrer un tel schéma. Chez Hugo, dans Les Travailleurs de la mer, l’eau de mer est « pleine de griffes » (1992, 360) ; c’est un prédateur qui menace sans cesse de venir perforer, lacérer, déchiqueter les enveloppes corporelles pour réabsorber les individus dans la totalité indifférenciée qui les entoure. Chez Lautréamont, dans Les Chants de Maldoror, l’océan est un « bleu appliqué sur le corps de la terre » (2001, 98) : il est la meurtrissure cosmique qui exprime par excellence la violence et l’agressivité de l’univers. Chez Michelet, au contraire, qui se rattache, comme on l’a vu, à l’imaginaire de « l’eau maternelle et féminine » (Bachelard, 1942, 155‑180), on trouve une tout autre configuration du rapport entre l’eau et la peau. La mer est une peau affectueuse, qui à force de caresses engendre d’autres peaux porteuses d’un progrès moral au sein du monde naturel : enveloppe d’individuation, enveloppe de liberté, enveloppe de mouvement, enveloppe d’amour, enveloppe de civilisation. C’est la raison pour laquelle, il convient pour l’homme de la respecter et de la chérir, sinon de la caresser, comme l’écrira Éluard (1968, 47) :
L’eau, telle une peau
Que nul ne peut blesser
Est caressée
Par l’homme et par le poisson
BIBLIOGRAPHIE
Andrieu, B., (2019), « L’osmose émersive : De la peau vivante à la peau vécue », Spirale, 89, 40‑48. doi : https://doi.org/10.3917/spi.089.0040
Anzieu D., (1985), Le Moi‑Peau, Paris : Dunod.
Anzieu D., (1986), « Cadre psychanalytique et enveloppes psychiques », Journal de la psychanalyse de l’enfant, 2, 12‑24.
Bachelard G., (1942), L’Eau et les Rêves, Paris : Corti.
Barthes R., (2002), Michelet [1954], Œuvres Complètes, Paris : Seuil, I.
Bory de Saint‑Vincent J.‑B., (1822‑1831), Dictionnaire classique d’histoire naturelle (17 vol.), J‑B. Bory de Saint‑Vincent (éd.), Paris : Rey et Gravier.
Cupa D., (2006), « Une topologie de la sensualité : le Moi‑peau », Revue française de psychosomatique, 29, 83‑100. doi : https://doi.org/10.3917/rfps.029.0083
Éluard P. (1968), « Les Animaux et leurs hommes. Les hommes et leurs animaux », Œuvres complètes, t. I, Paris : Gallimard, Pléiade.
Geoffroy Saint‑Hilaire É., (1820), « Mémoires sur l’organisation des insectes : Troisième mémoire, sur une colonne vertébrale et ses côtes dans les insectes apiropodes ; lu à l’Académie des Sciences, le 12 février 1820 », Journal complémentaire du Dictionnaire des sciences médicales (t. 6), Paris : Pankoucke, 138‑168.
Hugo V., (1992), Les Travailleurs de la mer [1866], Paris : Garnier Flammarion.
Kaplan E., (1975), « Michelet évolutionniste », Romantisme, 111‑128.
Lautréamont, (2001), Les Chants de Maldoror [1869], Paris : Le Livre de Poche.
Michelet J., (1983), La Mer [1861], Paris : Gallimard, Folio classique.
Petitier P., (2021a), « La prairie n’est pas le gazon. De la différence en démocratie ». in : P. Petitier et E. Plas (dir.), Michelet et la démocratie naturelle, Paris : Presses de la Sorbonne nouvelle, 90‑102.
Petitier P., (2021b), « Michelet et les allures de la vie », dans P. Petitier et E. Plas (dir.), Michelet et la démocratie naturelle, Paris : Presses de la Sorbonne nouvelle, 173‑184.
Pouchet F.‑A., (1859), Hétérogénie ou traité de la génération spontanée, Paris : Baillière.
Richard J.‑P., « Bestiaire de La Mer », dans : Essais de critique buissonnière, Gallimard, NRF, 1999, 29‑58.
Saint‑Denis (de) É., (1965, déc), « Michelet et la genèse de La Mer », Bulletin de l’Association Guillaume Budé, t. XXIV, 561‑579.
Séginger G., (2019), « Michelet et La Mer », Arts et Savoirs, 12, doi : https://doi.org/10.4000/aes.2187
Serres E., (1860), « Principes d’embryogénie, de zoogénie et de tératogénie », Mémoires de l’Académie des Sciences, t. 25, Paris : Didot frères.
Serres M., (1974, sept‑oct), « Michelet, la soupe », Revue d’Histoire littéraire de la France, 5, 787‑802.
Winnicott D., (1969), « La préoccupation maternelle primaire » [1956], De la pédiatrie à la psychanalyse, Paris : Payot, 168‑174.
[1].↑. Nous nous référerons systématiquement à cette édition dans la suite de l’article : nous nous contenterons donc désormais d’indiquer entre parenthèses la pagination pour chaque citation.
[2].↑. Sur le rapport de Michelet à la biologie de son temps et notamment à la question de l’évolution des espèces, voir Kaplan, 1975 et Séginger, 2019.
[3].↑. Petitier, 2021b.
[4].↑. Il consulte en particulier les articles « Matière » et « Mer » du Dictionnaire classique d’histoire naturelle. Voir Bory de Saint‑Vincent, 1822‑1831. Sur les sources de documentation de Michelet pour La Mer, voir Saint‑Denis, 1965, ainsi que la notice de Jean Borie dans l’édition citée de La Mer.
[5].↑. « L’hétérogénie vaincra à la longue. » (Michelet, 1983, 332)
[6].↑. Étymologiquement, porteuse d’enfants.
[7].↑. Il faut rappeler que le scientifique rouennais a publié en 1847, avant L’Hétérogénie, un traité de gynécologie sur l’ovulation spontanée chez la femme. (Théorie positive de l’ovulation spontanée et de la fécondation des mammifères et de l’espèce humaine, Paris : Baillière)
[8].↑. « Son livre de l’Embryogénie me souleva le voile d’Isis […]. » (Note manuscrite de Michelet de 1868 « Sur l’influence de la Nature », citée par Paule Petitier, dans La Géographie de Michelet, Paris : L’Harmattan, 1997, 105.)
[9].↑. Voir Anzieu, 1985. Dans la théorie psychanalytique d’Anzieu, comme l’explique Dominique Cupa (2006, 87), « le moi‑peau est une instance psychique, peau psychique qui est une métaphore de la peau biologique ».
[10].↑. Anzieu fait référence à des images utilisées par Frances Tustin à propos de l’autisme primaire (moi‑poulpe) et secondaire (moi‑crustacé). Voir Anzieu, 1986.
[11].↑. Jean‑Pierre Richard note ainsi que l’oursin « donne congé au monde » (Richard, 1999, 40) ; son dernier mot dans la prosopopée de Michelet est : « Bonsoir ».
[12].↑. « Tu es un masque plus qu’un être. » (Michelet, 1983, 181)
[13].↑. Selon Geoffroy Saint‑Hilaire, les insectes ou les crustacés « vivent au‑dedans de leur colonne vertébrale, comme les mollusques au sein de leur coquille, véritable squelette pour ces derniers » (Geoffroy Saint‑Hilaire, 1820, 152).
[14].↑. Voir Winnicott, 1969.





