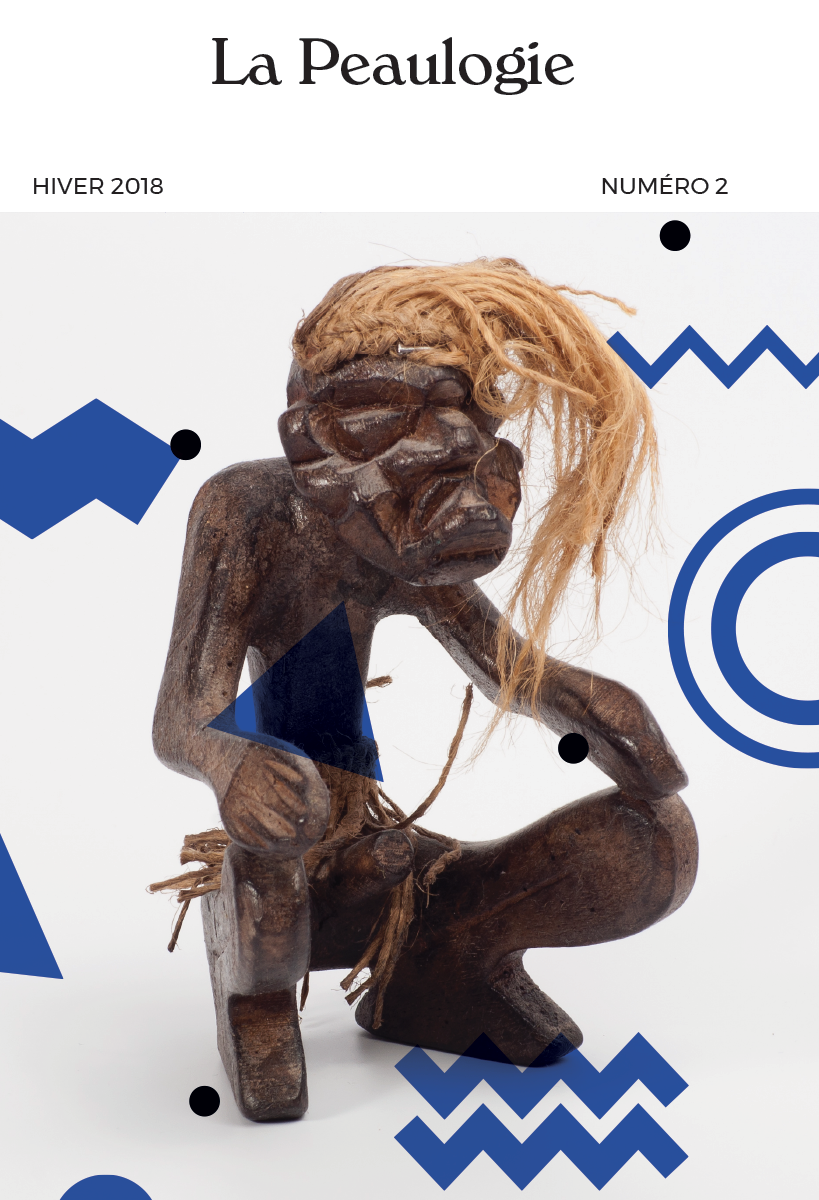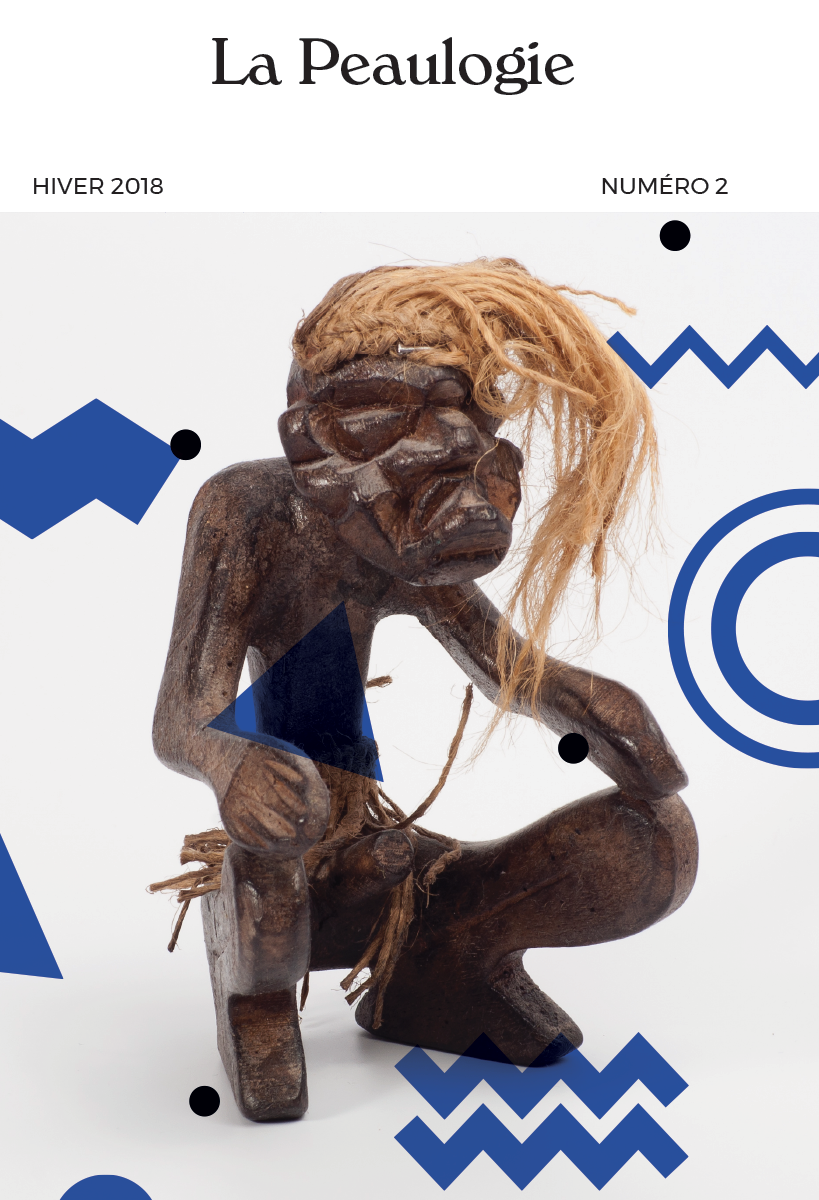Nous disposons en revanche, dans notre corpus latin, de trois sources qui rapportent ce mythe. Voici comment Hygin, auteur du Ier siècle de notre ère, raconte la punition de Marsyas dans ses Fabulae :
« Marsyas ainsi vaincu, Apollon le lia à un arbre et le remit à un Scythe qui l’écorcha (separauit), membre par membre (membratim) ; le reste de son corps (reliquum corpus) fut remis à Olympos pour l’ensevelir, et c’est de son sang que la rivière Marsyas tient son nom ».
Hygin insiste sur la minutie de l’opération qui consiste à « séparer » le corps de l’une de ses parties, à la mettre de côté, de manière méthodique et progressive, membratim, « membre par membre ». Le fabuliste ne précise pas ce qui est séparé de Marsyas, selon son habituelle et sèche concision. L’emploi du verbe en usage absolu surprend et peut évoquer la découpe d’une victime dans le cadre d’un sacrifice. Il est intéressant de constater que chez Hygin, c’est non pas Apollon lui-même mais un de ses compagnons scythes, peuple réputé mangeur d’homme, voire collectionneur de crânes-gobelets et de serviettes-scalps, qui procède à l’écorchage. On peut alors s’attendre à ce que la peau du vaincu victime de son hybris soit érigée en trophée. Mais ce qui nous frappe ici, c’est que la dépouille de Marsyas soit absente de cette représentation de son écorchage, nous ne savons pas ce qu’il en advient. Seul est mentionné « le reste de son corps » (reliquum corpus), à l’exclusion de la peau. Nous notons toutefois que même si elle n’est pas évoquée directement, la peau ne joue plus son rôle d’enveloppe corporelle, de contention, et le sang quitte le corps, se répand abondamment, au point de former un fleuve, qui prend le nom de Marsyas. Cette tradition étiologique, liée à l’écoulement du sang – et qui diffère en cela de la tradition de Xénophon –, ne nous est pas connue par ailleurs.
La deuxième source est double. En effet, le récit de la mise à mort de Marsyas nous est donné à deux reprises par Ovide, une fois dans les Métamorphoses :
« Quand on eut ainsi raconté la fin de ces hommes du peuple de Lycie, un autre rappela celle du satyre que le fils de Latone punit après l’avoir vaincu à la flûte de Minerve. ‘Pourquoi m’arraches-tu à moi-même (me mihi detrahis)? dit-il. Ah, je regrette ! criait-il. Ah ! Une flûte ne vaut pas tant !’ Et tandis qu’il criait, sa peau fut déchirée (cutis est direpta) sur la surface de ses membres : ce n’était plus qu’une plaie (uulnus). Son sang coule de toutes parts, ses nerfs mis à nus (detecti nerui) s’offrent aux regards, ses veines (uenae), sans la peau (sine ulla pelle), palpitent (micant) et tressaillent (trepidae) ; l’on pourrait dénombrer dans sa poitrine ses viscères grouillants (salientia uiscera), ses fibres transparentes (perlucentes fibras) »
Une autre fois, plus brièvement, dans les Fastes :
« Phébus vainqueur le pendit ; ses membres coupés se retirèrent de sa peau (recesserunt a cute) ».
Cette évocation froide sort de la bouche de Minerve. On peut remarquer ici que, contrairement à Hérodote, la pendaison précède l’écorchage, c’est le vivant que l’on suspend, pas la peau-relique. Le supplice est évoqué en termes neutres avec le verbe recedere, « se retirer ». L’action de Phébus est effacée au profit d’une sorte de séparation spontanée, comme si les membres quittaient seuls la peau. Cette action est mise en valeur par la césure entre recesserunt et a cute. Point de violence ni de pathétique dans ce passage. Le corps mort, après supplice, devient deux entités distinctes, des membra nus et une cutis. Minerve dans son récit n’en dit pas plus : la peau disparaît, ne reste que l’invention de la flûte attribuée à la déesse. Le satyre, qui n’est même pas nommé, et sa dépouille ne laissent pas de trace, ne sont pas dignes d’êtres célébrés dans ce catalogue des dates et fêtes sacrées que sont les Fastes. Le mythe, intégré au calendrier romain, et absorbé dans la culture romaine peut-être dès le IVème siècle av. J.-C., comme la statue de Marsyas sur le forum, ne laisse pas de place à la relique de peau.
Revenons-en à la première version qu’Ovide donne de ce supplice, bien plus riche et développée. Les premiers propos de Marsyas sont très frappants. À l’inverse du passage des Fastes, le polyptote me mihi, renforcé par la juxtaposition, voire par une coupe secondaire à l’hephthémimère, montre que la peau, avant même qu’elle soit nommée, ne peut être conçue comme séparée de l’être : elle permet l’unité. La détacher du corps, c’est faire perdre à Marsyas son unité, son identité (« Pourquoi m’as-tu arraché à moi-même ? »). Ovide insiste également sur la violence de la torture infligée par Apollon, grâce aux verbes detrahere et diripere au préfixe suggérant l’arrachement, par les allitérations en –t et en –c notamment. Il fait fortement appel au sens de la vue, dans un pathétique appuyé : le corps est mis à nu, à découvert, transparent. Ovide occupe ainsi quatre vers pour rendre compte de l’état de ce corps écorché, en révélant toutes les parties qui sont normalement invisibles, cachées par cet écran que forme la peau. Les termes detectus (« découvert »), patere (« être découvert, visible »), qui évoquent un dévoilement, une apparition, ainsi que le groupe verbal numerare posse (« pouvoir compter ») mettent l’accent sur le fait que le corps puisse être détaillé, comme disséqué : l’absence de peau (sine ulla pelle) révèle des parties du corps normalement invisibles, cruor, nerui, uenae, uiscera, fibrae, sang, nerfs, veines, viscères et muscles, comme si l’on suivait du regard l’écorchage progressif. L’auteur résume la situation de Marsyas par le terme uulnus, « blessure », qui déshumanise la victime puisqu’il est annoncé par le pronom neutre indéfini quicquam. Puis, il entame une scène très visuelle avec des effets de couleur (le rouge vif du cruor, « sang qui s’écoule »). L’auteur joue également avec l’idée d’éclat, de brillance sanguinolente, toujours avec le participe perlucentes, mais aussi le verbe micare qui possède ici selon nous le double sens de scintiller et de palpiter. C’est enfin avec ce terme et d’autres (trepidae, salientia) l’évocation d’un mouvement convulsif qui suggère à la fois la vie qui perdure encore dans ce corps et la souffrance extrême qu’il subit. Ce morceau de bravoure pathétique insiste donc sur l’opération qui vise à isoler la peau du reste du corps. Mais là encore, la dépouille n’est que peu de choses, d’abord une cutis direpta, encore une peau humaine et vivante qu’on arrache, puis dès lors qu’elle est détachée (sine ulla pellis), elle s’animalise – car elle devient pellis – et disparaît avant même de devenir outre ou cuir tanné, en raison de la préposition privative sine (« sans ») et du pronom négatif à valeur ici redondante ulla (« aucune »).
La suite du texte présente une sorte de cérémonie funéraire pour Marsyas, qui pourrait faire figure d’embryon de culte : les divinités agrestes, faunes, satyres, nymphes mais aussi les bergers, s’unissent pour le pleurer et leurs larmes assemblées forment un fleuve nommé Marsyas :
« Et les dieux agrestes, les divinités sylvestres, les faunes et ses frères les satyres, son Olympus chéri aussi, les nymphes le pleurèrent, ainsi que tous les bergers, bouvillons et vachers qui font paître leurs troupeaux laineux et cornus sur ces collines. La terre fécondée et humide s’abreuve des larmes versées, s’en imprègne, les absorbe jusqu’au fond de ses entrailles. Elle en conçoit alors une rivière qu’elle fait jaillir à l’air libre. Ainsi le flot rapide, qui s’écoule sur les rives pentues, prend le nom de Marsyas, fleuve phrygien aux eaux limpides ».
Cependant, contrairement à la grotte mentionnée par Xénophon où est suspendue la peau-relique de Marsyas, qui donne ainsi son nom au fleuve, Ovide n’évoque pas la présence de dépouille ou de peau suspendue et visible. A nouveau, c’est le silence sur cette « outre de peau ». Ce qui sert à rappeler le souvenir de ce satyre supplicié, c’est la source issue des pleurs, pas le corps du supplicié, pour les Romains destiné à disparaître, comme tout corps mort. Ces deux récits étiologiques d’Ovide, l’un racontant la naissance de la flûte, l’autre celle du fleuve Marsyas, évacuent un motif qui aurait pu servir à étayer la naissance d’un culte. Ovide, dans les Fastes et les Métamorphoses, se régale pourtant de ce genre de récits.
Notre troisième source concernant le mythe de Marsyas est un extrait des Florides d’Apulée (IIème siècle apr. J.-C.) qui raconte longuement le concours fatal. Elle se clôt sur une évocation brève mais également frappante de la punition de Marsyas :
« [Les Muses] abandonnèrent le joueur de flûte vaincu dans ce concours, comme un ours à deux pieds, le cuir écorché (corio exsecto), les viscères mis à nu et lacérés (nudis et laceris uisceribus) ».
Outre l’idée de l’exposition des parties internes du corps, il est à noter qu’ici le caractère animal de Marsyas l’emporte. S’il n’est pas présenté comme un satyre par Apulée, mais comme « un Phrygien et un barbare », la bestialité de son physique est soulignée par le narrateur – il le décrit comme ayant « le visage d’une bête fauve », (uultus felinus), comme étant « hérissé » (hispidus) et « couvert de piquants et de poils » (spinis et pilis obsitus) – et dans les propos de Marsyas lui-même, qui décrit sa « barbe répugnante » (barba squalidus), sa « poitrine hirsute » (pectore hirsutus). Ces descriptions préparent la comparaison de Marsyas supplicié à un gibier, à un ours écorché. Le terme corium employé pour désigner la peau arrachée renforce ce processus de déshumanisation. L’enveloppe découpée et séparée du corps, grossière, moins tendre qu’une cutis, s’approche d’une fourrure manufacturée, tannée, mais in fine inutile
puisqu’abandonnée par les Muses. Contrairement à Ovide qui fait de Marsyas une victime aimée et pleurée par ceux qui l’entourent, comme un être humain, sa dépouille chez Apulée est laissée à l’abandon, livrée au mépris des Muses et de Minerve. L’auteur des Florides est le seul chez les Latins qui mentionne cette peau-objet, cette peau autonome si l’on peut dire. Mais pas plus qu’Ovide, il ne fait cas du corium de Marsyas ; car, après le supplice, Hygin et Ovide la font disparaître et n’évoquent que le reliquum corpus, pour Hygin, et les différents restes du corps énumérés chez Ovide. Plus que la peau du mort, c’est davantage le corps nu, découvert, qui concentre les regards, même dans le passage d’Apulée, puisqu’il s’achève sur la mention des nuda et lacera uiscera abandonnés par les Muses, Minerve et Apollon.
L’on peut ainsi formuler une remarque globale à l’issue de cette étude portant sur la représentation de l’écorchage de Marsyas. C’est que la littérature latine se montre beaucoup plus explicite au sujet du supplice que du résultat de ce supplice. Comme si le récit visait à l’édification plus qu’à l’étiologie, en insistant sur les risques encourus par les orgueilleux. La littérature latine est aussi plus crue que ne l’est l’iconographie dans son ensemble qui, sous des formes très variées, ne représente le personnage de Marsyas qu’avant la punition : sans lien avec Apollon et seulement chargé d’une outre évocatrice, pendant le concours ou au moment où Apollon s’apprête à accomplir son geste ; elle est plus explicite aussi que les auteurs grecs antérieurs à nos sources, qui évoquent seulement l’écorchage avec une grande économie de moyen (par le verbe ἐκδέρω essentiellement, et une fois ἐκτέμνω), sans représenter le corps mis à nu. Il faut alors y voir un fort goût (ou dégoût) romain pour le pathétique et l’horrible, le sanguinolent, mais seulement en imagination, dans les textes, et non dans les représentations figurées. Le pas sera franchi à la Renaissance, époque à laquelle l’anatomie de Marsyas est dévoilée dans des gravures et enluminures, comme la lettrine de Vésale de 1543, représentant l’écorchage par Apollon (Figure 3). Ce qui était supplice et châtiment dans le mythe prend une valeur scientifique et anatomique, soulignant peut-être les liens d’Apollon avec la médecine. De même, le Frontispice de Valverde (Figure 4), datant de 1586 reprend le motif de Marsyas : on y voit en surplomb la peau écorchée du satyre malheureux, au visage faunesque mais aux mains et pieds bien humains. Sur l’une des figures illustrant le Traité des instruments et martyrs de Gallonio, de 1590 (Figure 5), on peut reconnaître dans l’écorché à gauche un motif inspiré du Marsyas religatus évoqué par Pline ou le Marsyas condamné apparaissant sur des monnaies du Ier siècle av. J.-C. (Figure 2). Mais cette fois-ci, l’écorchage a lieu sous nos yeux et la peau tombe en drapé le long du corps, comme un écho au vêtement figurant au premier plan.