Blanc de plomb.
Histoire d’un poison légal
Judith Rainhorn

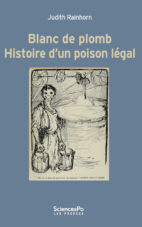
Blanc de plomb.
Histoire d’un poison légal
Judith Rainhorn
Judith Rainhorn, Blanc de plomb. Histoire d’un poison légal, Paris, Les Presses de Sciences Po, coll. « Académique », 2019, 372 p., ISBN : 9782724624359.
Compte rendu de Stéphane Héas
Référence électronique
Héas S., Kassabian (trad.) (2019). « Blanc de plomb. Histoire d’un poison légal », [En ligne] La Peaulogie 3, mis en ligne le 18 décembre 2019 , URL : https://lapeaulogie.fr/blanc-de-plomb-histoire-dun-poison-legal/
L’autrice réalise ici une démonstration fine des arcanes de la perceptibilité vs. de l’imperceptibilité (p. 15) dans la sphère publique d’un poison, la céruse (carbonate de plomb, dit « blanc de plomb »). Elle montre comment les positions des acteurs naviguent « entre délit, déni, dénonciation et accommodement » (p. 16).
Avec des titres et des sous‑titres tout à fait évocateurs, elle maintient l’attention du lecteur ou de la lectrice de ce qui constitue un empoisonnement au long cours. Malgré une démonstration très ancienne et indiscutable de la toxicité du plomb, le développement de son emploi devenu massif au XIXème siècle, va se poursuivre au gré des intérêts professionnels (peintres), industriels (chimistes), mais aussi des intérêts politiques (maintien ou développement de l’emploi, priorité au pain quotidien avant la santé des populations…). Ce travail historique montre que les « premiers concernés » par cet empoisonnement pour reprendre une notion contemporaine ne constituent pas un bloc monolithique. Entre les ouvriers cérusiers et les peintres du bâtiment, la différence est grande en termes de parole publique (voice) et d’organisation collective face à l’intérêt ou non à employer, usiner, a fortiori à contester l’emploi de ce carbonate de plomb basique.
Cette histoire du blanc de plomb constitue un cas d’école pour affirmer que l’attention publique (efficace pour réduire cet empoisonnement) ne s’est pas imposée d’une manière linéaire. Des résistances, des périodes d’oubli, etc., se succèdent au fil des deux siècles analysés ici dans notre pays et dans le reste de l’Europe. Le livre est organisé en sept chapitres. Dans « l’appropriation du poison (XVIIIème‑1830) » l’auteure montre les intérêts politiques successifs, industriels et scientifiques, qui ont valorisé avec force incitation la production et l’utilisation du blanc de plomb français. La collusion entre des instances de l’Etat (les annales d’hygiène publique, et surtout le comité de salubrité publique « composé de plus de chimistes et de pharmaciens que de médecins », p. 68) et certains industriels influents à Paris ralentira la prise en compte et a fortiori, les mesures de prévention contre les risques d’exposition des ouvriers et des ouvrières. Avec « l’invention du saturnisme (1820-1860) », les analyses précisent comment l’argument sanitaire a pu renverser l’échelle des valeurs entre les entreprises concurrentes. Se soucier de la santé des ouvriers et employés devient un argument qui retient l’attention publique. L’auteure rappelle que « les céruseries traînaient une réputation de mouroir » (p. 43). La réalité est, en effet, une hécatombe mortelle dans les rangs ouvriers. Les médecins témoins directs de cet empoisonnement parce qu’ils sont employés des entreprises ou bien témoins indirects par les files actives hospitalières le constatent, avec plus ou moins d’empathie. L’appellation même de cette intoxication a connu une diversité et des confusions étonnantes : « colique des potiers », « coliques de Poitiers », en latin « des peintres (pictorum) », « du Poitou (pictonum) » (p. 49). Surtout, la complaisance productiviste de l’hygiénisme secondarisera, voire évincera, pendant des décennies la thèse de Tanquerel (1834), alors même qu’elle constitue un effort de clarification de l’étiologie de la « paralysie du plomb ou saturnine » qui deviendra le « saturnisme ». L’oxyde de zinc comme substitut ne réussira pas sa percée commerciale, en raison d’un prix élevé qui « n’entamera pas le monopole de la céruse jusqu’en 1845 » (p. 87). Le chapitre « les grammaires de l’opacité (1855‑1900) » souligne le silence presque complet autour du risque lié à la céruse, en tous cas dans les revues d’hygiène et au sein des rapports de la salubrité publique. Une “pax toxicologica”, véritable « accommodement aux nuisances » s’étend sur ce demi-siècle (p. 119). Reprenant Murphy, l’autrice précise les arcanes d’un « régime d’imperceptibilité » dans la sphère publique plutôt qu’un complot du silence autour de ce toxique. L’organisation d’un cartel cérusier permettra le déclassement de la production de céruse en une activité « non dangereuse » au sens administratif du terme. En effet, l’inefficacité des recommandations hygiéniques est patente tout au long du XIXème siècle. Les conditions de production de la céruse restent morbides. Une véritable mystification de « l’usage modéré » du toxique est mise en place. Les voies d’intoxication (respiratoire, gastrique et épidermique) au plomb vont s’affirmer progressivement autour de 1900.
J. Rainhorn précise l’inexistence quasi parfaite des victimes (les saturnins ; notons que le féminin n’est pas mentionné…), les ouvriers et ouvrières de la céruse pendant tout le XIXème siècle. Sont présents dans les archives une pétition en 1853 et quelques rares faits divers qui ont mis en lumière ponctuellement la dangerosité de l’utilisation du fard “blanc Vénus” ou “blanc Rachel” par des comédiennes par exemple ou des clients d’une boulangerie utilisant du bois cérusé pour cuire leur production de pains. Ces rares mentions n’effriteront pas ce déni collectif savamment orchestré. Les rares données chiffrées évoquent par exemple sous la plume du Dr J. Arnould en 1879 les « déchets sanitaires » de telle ou telle usine : 5 % par an apparaît comme un bon score, face au vingt ou trente morts pour 100 ouvriers d’autres usines (p. 170). Les statistiques partielles et balbutiantes feront l’objet de critiques de la part des contempteurs comme des « sonneurs d’alerte » vis-à-vis de la céruse. Etre soigné à l’hôpital reste au XIXème siècle le fait des populations les plus démunies, ce qui n’est pas le cas de tous les peintres. L’obligation de déclaration des cas de saturnisme en 1902 améliorera la précision des recensements de populations concernées. Surtout, si l’empoisonnement au plomb affecte durablement la santé (morbidité), sa mortalité est plus difficile encore à mesurer. L’invisibilité des questions sanitaires est, à cette époque, en lien avec les valeurs virilistes des mondes du travail de la céruse, dissimulant un autre coût de cette masculinité travailleuse.
Au « moment 1900 » le corps à l’ouvrage devient un objet de préoccupation publique, malgré une indifférence des instances syndicales en cours de consolidation et de revendications anticapitalistes moins rivées sur tel ou tel métier, et dans le cadre d’une sensibilisation croissante à la responsabilité des chefs d’entreprise. L’hécatombe saturnique, véritable “massacre des innocents” par le caractère tératogène du plomb, est démontrée de plus en plus précisément notamment à partir de la part importante de fausses couches, de mort-nés et de morts prématurés dans les descendances des ouvriers et ouvrières (p. 229). Les résistances industrielles gagneront du temps lors des débats parlementaires et surtout les débats sénatoriaux particulièrement conservateurs et même falsificateurs des données épidémiologiques, permettant d’écouler les stocks de poisons… Pour autant, la France est pionnière dans cette lutte contre les fléaux industriels. Avec la première guerre mondiale l’application de la prohibition de la céruse est freinée. L’après conflit verra la coordination internationale se déployer en termes de travail également. Cette internationalisation de la question de ce poison, parmi d’autres, verra l’opposition maintenue des acteurs en présence avant la guerre : « avocats du poison » (p. 296) contre les prohibiteurs ou, a minima, les partisans d’une régulation et d’un contrôle des composés chimiques ; les premiers soutenant jusqu’au cataclysme économique de l’abandon du plomb dans les peintures. La convention internationale n’est pas précisément prohibitionniste, la production et la vente de céruse (aux faïenceries par exemple) vont perdurer suivant les conditions nationales et les rapports de force entre les acteurs nationaux. Or, le secteur de la peinture est pluriel et les contrôles de la jeune inspection du travail restent partiels. À cette époque (comme aujourd’hui ?) l’organisation internationale du travail s’avère de peu de poids face aux Etats et aux industriels. En outre une concurrence s’installe entre prohibition des poisons et réparation des maladies professionnelles.
La condamnation d’employeurs dans l’affaire de l’amiante en France fait resurgir ce risque professionnel sous-estimé. Surtout, la pollution des sols et des bâtiments distillent ses poisons des décennies plus tard et font objet dans le meilleur des cas d’une surveillance étatique régulière. L’empoisonnement se poursuit donc malgré l’abandon quasi complet de certaines substances telle la céruse. La justice sanitaire et environnementale débute à peine selon l’auteure qui a montré que l’intrication des intérêts divergents ralentissait considérablement l’adoption de mesures d’interdiction de la production, de la vente et de l’utilisation des produits, mesures négociées et censées protéger les populations…