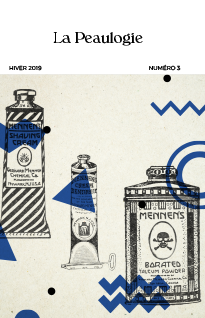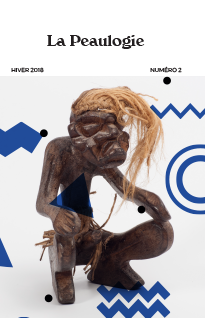[brick_social_site]
N°10 – 2023/10 | — pages
Le surplus par la perte. Représentations et physicalité de l’excédent de peau non intentionnel
Cette livraison de La Peaulogie traite une question peu abordée dans la littérature, une niche conceptuelle : comment penser qu’un excès résulte d’une perte ? Ce questionnement est particulièrement adapté à la peau, cet organe qui enveloppe notre corps. Cette enveloppe peut se déformer, se rétrécir, s’étirer et ne pas revenir à sa dimension initiale. Ce changement peut être volontaire et recherché ou involontaire, il peut être en lien avec l’alimentation, le sport, ou la vieillesse. Comment donc ce surplus de peau induit par une perte est-il vécu par les individus ? Comment la peau qui retrace l’histoire biographique d’un individu devient-elle un marqueur mémoriel de l’avant ? Comment les perceptions genrées influent-elles sur l’acceptation ou l’appréhension de ce surplus de peau ? Comment ce surplus handicape-t-il et stigmatise-t-il au quotidien ?
Ce numéro de La Peaulogie apporte ainsi des éléments de réponse à ces questions, il interroge les représentations et la physicalité de ce surplus de peau quand celui-ci est dû à une perte qu’elle soit de masse ou pour tout autre raison. Elle se concentre donc sur l’excès par la perte quand celui-ci se situe dans des configurations accidentelles. Les auteurs de ce volume ont choisi majoritairement de travailler cette problématique à l’aune de la perte de masse grasse, qui résulte d’un amaigrissement rapide lié notamment à une chirurgie bariatrique. Les articles dans la rubrique Varia de ce numéro traitent également mais de façon plus lointaine cette question, davantage centrée sur la variation et l’élasticité de la peau.
N°9 – 2022/07 | 344 pages
Pilosités. Variétés animales et esthétiques humaines.
Chez les êtres humains la pilosité et son traitement : esthétique, symbolique, etc., signale la différenciation, plus ou moins marquée selon les époques et les sociétés, entre les genres, les statuts sociaux, les positions et options politiques, le proche ou le lointain. Plusieurs travaux récents ont mis en évidence l’intérêt heuristique d’une étude de la pilosité (voir entre autres, Hiltebeitel et Miller, 1998 ; Nadjmabadi, 2005 ; Da Silva, 2009 ; Bromberger -2010- 2015 ; Auzépy et Cornette, 2011 ; Pouvreau, 2014…). Si la chevelure, la barbe et la pilosité corporelle ont donné lieu à plusieurs études récentes, les sourcils, et plus encore les cils dont les traitements varient selon les périodes historiques, les cultures, les classes d’âge, les modes, les intentions personnelles, demeurent des zones d’ombre. Des contributions sur les sourcils et surtout sur les cils sont attendues mais d’autres thèmes, mettant en jeu la pilosité, peuvent être traités.
N°8 – 2022/03 | 218 pages
Tatouage éthique et inclusif : la peau comme marqueuse politique
Le 8ème numéro de la revue La Peaulogie, dédié au tatouage éthique et inclusif, souhaite porter son attention sur ces dess(e)ins multiples et leur visibilisation, où la peau devient une marqueuse politique. Il pourra s’agir dans ce numéro d’aborder différents axes : les tatouages militants, qui croisent les pratiques féministes, punks, sorcières, etc. ; les salons qui déploient une charte éthique avec des pratiques safe, dans le respect des praticien·nes comme des client·es ; des tatouages thérapeutiques qui accompagnent la construction ou la reconstruction corporelle, psychologique ou identitaire.
N°7 – 2021/12 | 266 pages
Cuirs et peaux dans les sociétés humaines. Techniques de transformation, fonctionnalités, représentations et symbolismes
Comme l’indique le Conseil National du Cuir : « La peau (…) née de la nature (…) n’est pourtant rien sans l’homme qui la soigne, la transforme, la réhabilite afin qu’elle devienne un cuir somptueux et vivant. Sa naturalité et sa noblesse font d’elle une matière à forte valeur ajoutée ». Cette affirmation, au‑delà de la mention de la valeur des peaux et cuirs, relève le rôle que jouent les humains dans l’élaboration et la valorisation de ces matériaux. Et à travers l’histoire, ils ont justement développé des savoirs et des savoir‑faire pour produire du cuir aux fonctionnalités multiples. Dans nombre de sociétés, des mécanismes de transformation des peaux en cuirs et des cuirs en des produits variés ont existé, témoignages non seulement des intelligences développées autour de ces matériaux, de leurs fonctionnalités. De l’Antiquité aux Temps Contemporains en passant par le Moyen Age et les Temps Modernes, les peaux et cuirs ont occupé une place de choix. Ils sont devenus des produits de luxe des sociétés contemporaines et industrialisés, mais les usages artisanaux et rituels subsistent et leur confèrent une dimension spécifique. Peaux et cuirs d’animaux sauvages et domestiques sont exploitées d’une part selon des techniques traditionnelles qui n’ont pas beaucoup changé et d’autre part selon des procédés techniques sophistiqués et industrialisés. Les représentations, les symbolismes et les rituels autour de ces matériaux varient en fonction des contextes socioculturels. Cette diversité des savoirs et de savoir‑faire en matière de cuirs est pertinemment démontrée ici. En croisant les approches anthropologique, archéologique, biologique, chimique, ethnologique, historique, sociologique, toxicologique, les auteur.e.s étudient l’évolution des transformations, des traitements et la mobilisation des personnes et des groupes sociaux particuliers autour des différents types de peaux, à travers des contextes socioculturels et économiques divers.
N°6 – 2021/06 | 315 pages
Peaux artificielles. La technologie aura‑t‑elle la peau de l’être humain ?
Tanneurs, pelletiers, maroquiniers, dermatologues ou taxidermistes, tels sont depuis longtemps les travailleurs de la peau. Aujourd’hui, à l’heure des biotechnologies, ont surgi de nouveaux spécialistes : le peaussier du XXIe siècle est un scientifique, un ingénieur tissulaire, un biochimiste, un physicien des matériaux, un nano-informaticien, un entrepreneur innovant qui fabrique des peaux de synthèse, des épidermes in vitro et des e-skins. L’industrie épithéliale est florissante. Aux ateliers du cuir d’autrefois se sont ajoutés des laboratoires où trônent éprouvettes et bains nutritifs de kératinocytes. De son côté, la cybertechnique produit des peaux étirables en élastomère ou en silicone, pourvues de senseurs tactiles et de capteurs électroniques intuitifs.
N°5 – 2020/12 | 242 pages
Textes à vif. Tatouages, transferts, performances.
Marques corporelles, inscriptions, traces, piqûres, griffures, fleurs de bagne, bousilles, brouillages, matricules, ce numéro explore la mise en scène encrée du corps à travers différentes pratiques artistiques, sociales, esthétiques et éthiques. Que dit la citation sur le corps ? Comment le corps tatoué s’inscrit‑t‑il dans l’espace ? Comment est‑il lu, vu, perçu ? Comment devient‑il lisible ? Que performe‑t‑il ? Le tatouage relève‑t‑il d’une littérature dessinée, calligraphiée, performée ?
N°4 – 2020/4 | 209 pages
La littérature dans la peau : tatouages et imaginaires.
Lignes, tracés graphiques, surfaces encrées, impressions, parchemins et vélins sont autant de termes que le tatouage partage avec l’écriture. Entre les objets scripteurs, les gestes de l’écriture ou du dessin et l’aiguille du tatoueur se noue une relation sensible et palpable. Le littéraire fait retour sur la peau qui elle-même se transforme en archive et devient l’objet d’une mise en fiction des corps.
Ce numéro interdisciplinaire consacré à la littérature dans la peau aborde le tatouage, non plus comme un motif graphique uniquement visuel, mais comme un support narratif propre à la fiction…
N°3 – 2019/3 | 135 pages
(Peau)lluant. Les toxiques à notre contact.
La présence de polluants, visibles ou non, aujourd’hui est devenue une question cruciale en termes de santé publique, et plus largement, de « catastrophes écologiques » (Denhez, 2005). Chaque semaine, la médiatisation d’un scandale de ce type éclabousse tel ou tel pays. L’année 2018 est d’ores et déjà marquée par les scandales de la chlordécone aux Antilles, des fongicides SDHI (inhibiteurs de la succinate déshydrogénase) et notamment de la boscaline, etc.
N°2 – 2018/2 | 110 pages
Les peaux : entre trophées et reliques.
La peau est la part visible de l’être humain. Son interface avec le monde extérieur, l’objet du premier regard, du jugement, de la contemplation. Au-delà, la peau – prolongement palpable et sensible de l’individu – devient un objet cultuel, politique, religieux, social.
A travers la thématique de ce second numéro, « Les peaux : entre trophées et reliques », nous souhaitons attirer l’attention sur ces divers sens donnés à la peau (humaine, mais pas exclusivement), à ses « traductions » en terme ethnologique. Comment ses transformations, ses présentations, ses dissimulations revêtent un sens et une volonté qui dépassent la volonté individuelle, et peuvent s’étendre à un groupe tout entier (stigmatisation, adoration, hiérarchie, etc.)…
N°1 – 2018/1 | 181 pages
Le blanchissement de la peau humaine
Le numéro précise le phénomène complexe de blanchissement : son ampleur, ses ressorts, ses conséquences, etc. Ces deux premiers volets visent à éclairer les enjeux multiples qui concernent la peau humaine. Ces articles intéresseront les scientifiques, bien sûr, puisqu’il s’agit à partir du numéro 1 d’une revue qui répond aux exigences de l’expertise en double aveugle, mais ils intéresseront directement les personnels soignants au contact des malades et de leur famille. Enfin, nous espérons que des lecteurs non directement concernés par ces situations et ces pratiques y trouveront des éléments de réponses, mais aussi de questionnements. Une meilleure inclusion de chacun est l’horizon de cette revue qui vise à informer sur les impacts des atteintes épidermiques mais aussi de leurs possibilités créatrices, dans toute leur variété aujourd’hui comme hier, ici comme ailleurs.
N°α – 2017/1 | 90 pages
Les coutures humaines
Les peaux humaines sont scrutées par le «regard» de disciplines variées dans le cadre de cette nouvelle revue (sciences humaines et sociales, sciences médicales, etc.). Pour ce premier numéro α (le numéro de lancement de cette revue était pressenti pour un autre site, non spécifique aux problématiques de la peau) les textes montrent l’importance réelle et symbolique des cicatrices dans la vie humaine.
Newsletter
Vous souhaitez recevoir nos actualités ? Inscrivez-vous à notre newsletter.