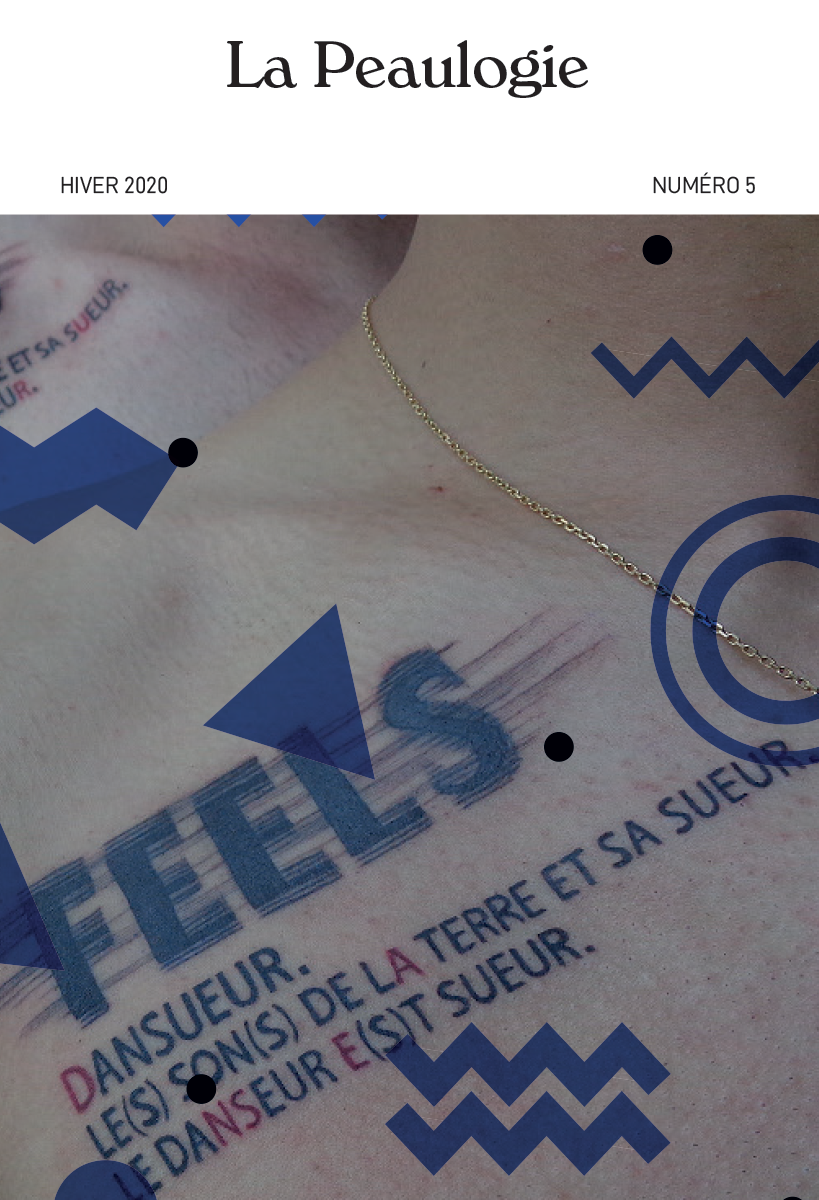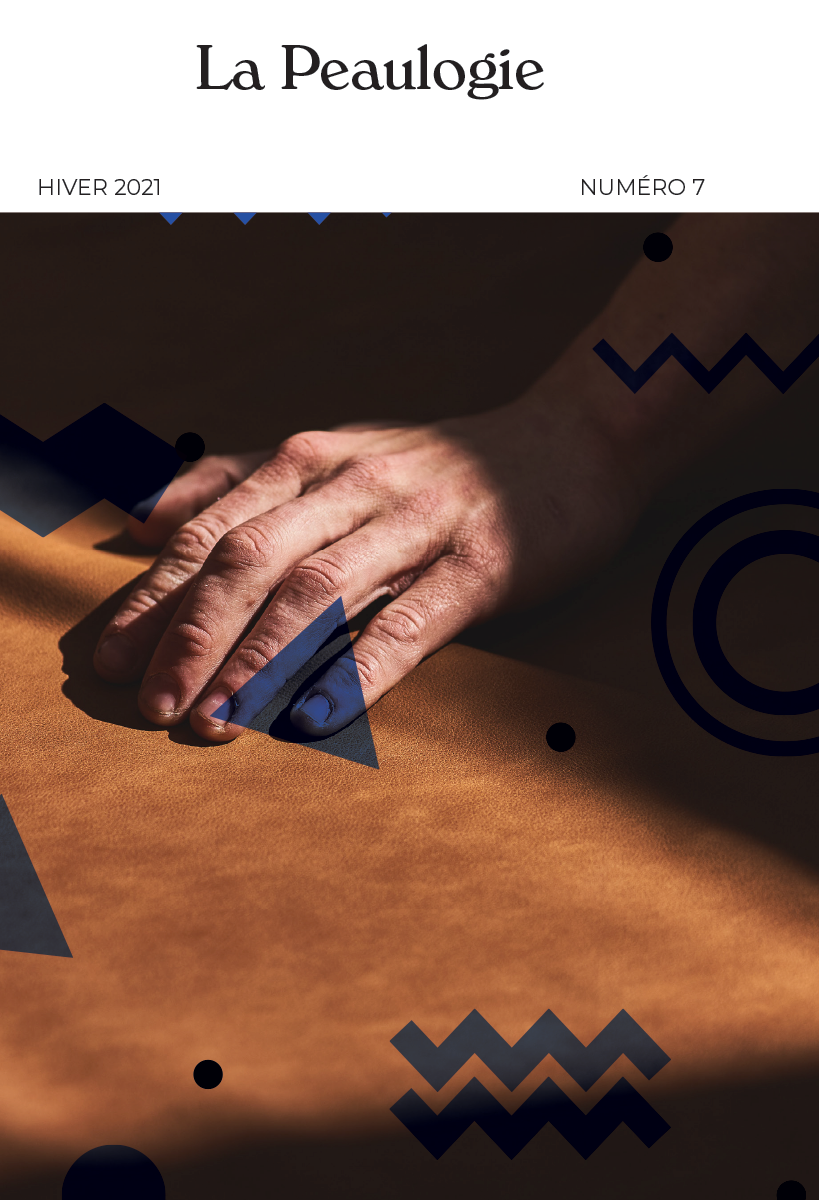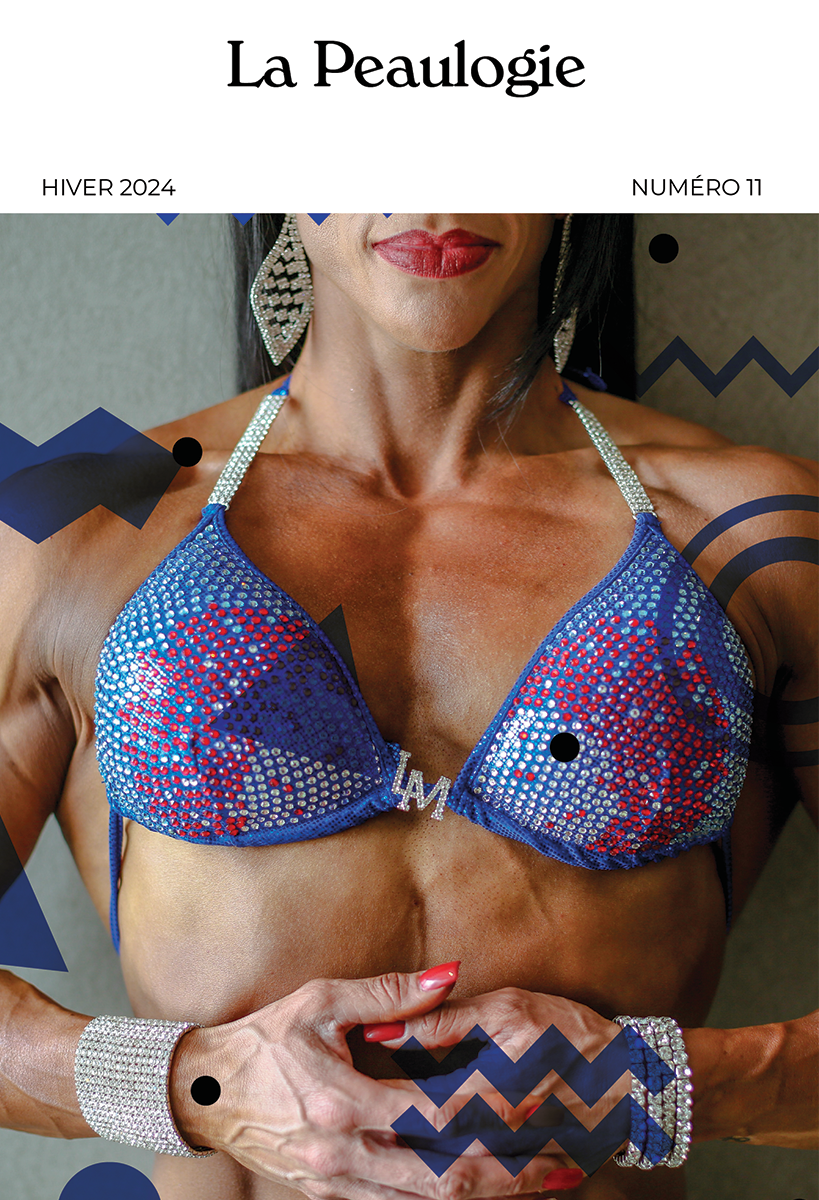Référence électronique
Lafrance M. (traduit par Deschamps G.), (2018). « Études de la peau : Survol de la recherche anglo-américaine contemporaine », [En ligne] La Peaulogie 1, mis en ligne le 01 juillet 2018, URL : https://lapeaulogie.fr/etudes-de-la-peau-passe-present-futur/
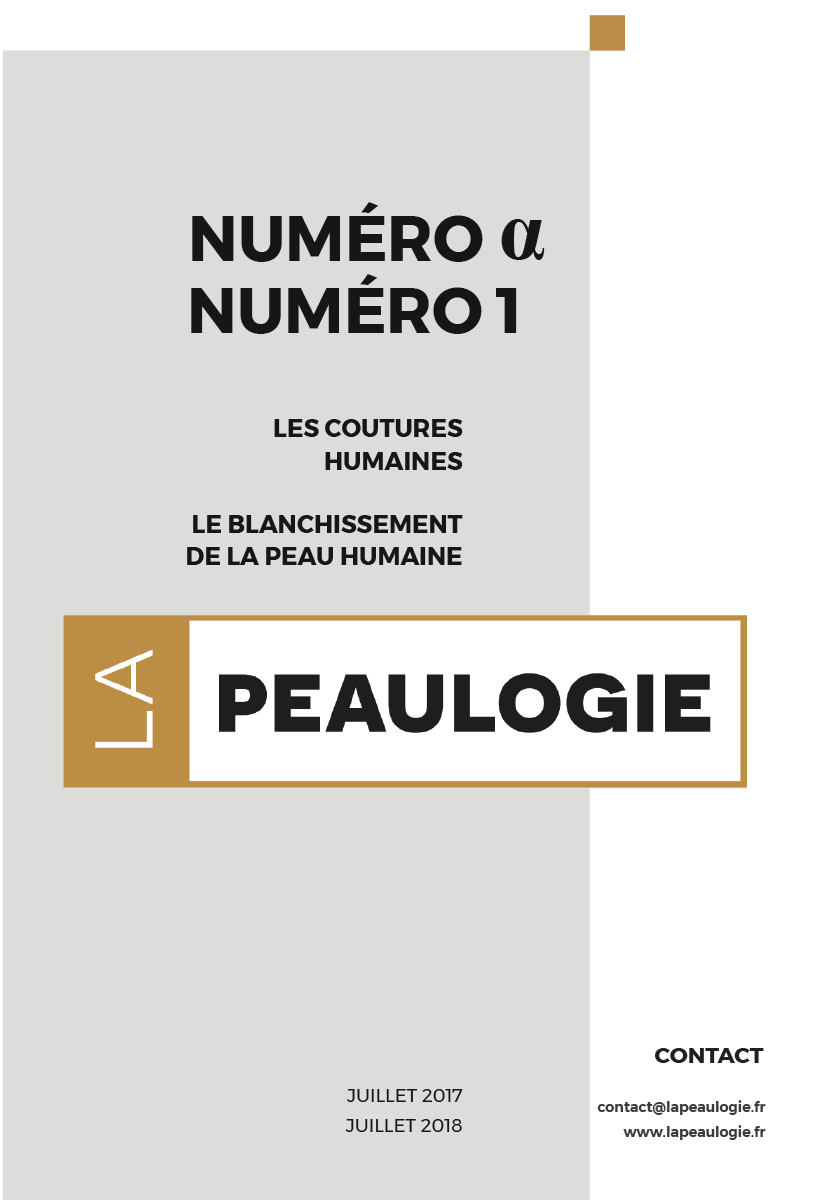
Études de la peau : Survol de la recherche anglo-américaine contemporaine
-
Description
Marc LAFRANCE
Université Concordia, Canada
Geneviève DESCHAMPS
traduction
Cet article a été réimprimé avec l’autorisation de la revue scientifique Body and Society (SAGE). Il s’agit d’une version légèrement révisée et traduite de l’article intitulé « Skin Studies: Past, Present and Future », vol. 24, no 1-2, p. 3-32.
Résumé
Cet article vise à offrir une introduction aux recherches contemporaines anglo-américaines sur la peau. Pour ce faire, je présenterai les études critiques de la peau en trois parties en m’attardant sur les travaux réalisés au cours des deux dernières décennies dans le domaine des sciences humaines et sociales. Je commencerai par une réflexion sur ce qui fait de la peau un phénomène aussi évocateur et, dans une certaine mesure, unique. Je donnerai ensuite un aperçu des principaux travaux, des thèmes récurrents et des débats actuels qui caractérisent le domaine d’étude qui nous intéresse. Je terminerai enfin avec une présentation des articles du récent numéro spécial de la revue scientifique Body and Society sur le thème de la peau. En offrant un aperçu fascinant de certaines des recherches les plus récentes sur la surface du corps, ce numéro fait des études de la peau un domaine d’étude à part entière. De cette manière, il contribue au domaine dans son état actuel tout en l’orientant vers de nouvelles questions et préoccupations et vers de nouveaux enjeux.
Mots-clés
Peau, Surface, Corps, Subjectivité, Corporéité
Au cours des 20 dernières années, un nouveau domaine d’étude ayant pour principal objet de recherche la surface du corps a commencé à émerger[1]. Comme les études du corps, un domaine connexe mieux établi, les « études de la peau » reposent sur un projet transdisciplinaire influencé par une multitude d’approches issues des sciences sociales et humaines, notamment l’anthropologie, l’histoire de l’art, les communications et les études des médias, l’histoire, la littérature, la philosophie, la psychologie et la sociologie. Et à l’instar des études du corps, les études de la peau sont le fruit d’interactions continues avec d’autres domaines, notamment les études critiques de la race, les études culturelles, les études du genre et de la sexualité, les études post-coloniales et les études sensorielles. Alors que ce domaine « évite de considérer “le corps” comme sa figure privilégiée » (Ahmed et Stacey, 2001 : 1) — mettant plutôt l’accent sur la façon dont la surface du corps est rendue habitable, intelligible et significative —, nombre des suppositions que font ses spécialistes au sujet de la peau sont semblables à celles que font les spécialistes des études du corps au sujet du corps. La peau est ainsi considérée comme ouverte, processuelle, relationnelle et sensible ; elle est humaine et non humaine, matérielle et immatérielle, indéterminée et multiple ; et, finalement, elle est fondamentalement associée au fait de penser, voire de repenser l’agentivité, l’expérience, le pouvoir et la technologie (Blackman, 2008 ; Featherstone, 2000 ; Shilling, 2013 ; Turner, 2008).
Nous pourrions raisonnablement nous demander pourquoi la peau est si importante. Pourquoi la peau — comme sujet et comme objet — mériterait-elle son propre domaine d’étude ? Et comment ce dernier a-t-il été façonné ? Pour répondre à ces questions, je proposerai une introduction aux recherches contemporaines anglo-américaines sur la peau. Je présenterai les études critiques de la peau en trois parties en m’attardant essentiellement sur les travaux réalisés au cours des deux dernières décennies dans le domaine des sciences humaines et sociales. Je commencerai par une réflexion sur ce qui fait de la peau un phénomène aussi évocateur et, dans une certaine mesure, unique. Je donnerai ensuite un aperçu des principaux travaux, des thèmes récurrents et des débats actuels qui caractérisent le domaine qui nous intéresse. Je terminerai enfin avec une présentation des articles du récent numéro spécial de la revue scientifique Body and Society sur le thème de la peau. En offrant un aperçu fascinant de certaines des recherches les plus récentes sur la surface du corps, ce numéro fait des études de la peau un domaine d’étude à part entière. De cette manière, il contribue au domaine dans son état actuel tout en l’orientant vers de nouvelles questions et préoccupations et vers de nouveaux enjeux.
De l’importance de la peau
Bien qu’on la tienne souvent pour acquise, la peau est, à bien des égards, l’organe sensoriel le plus fondamental. Nous pouvons vivre sans la vue, l’ouïe, le goût et l’odorat, mais nous ne pouvons pas survivre si la majeure partie de notre peau n’est pas intacte. La peau constitue la partie la plus importante et la plus lourde de notre corps et ses capacités sensorielles se développent plus tôt que celles des autres systèmes sensoriels. Pourtant, ce n’est que récemment qu’elle a commencé à susciter de façon durable l’intérêt des chercheurs. Comme l’explique l’anthropologue Ashley Montagu (1979) dans son ouvrage phare sur la peau dans les contextes transculturels : « On aurait pu penser que la remarquable faculté d’adaptation de la peau, sa résistance aux changements de l’environnement, ses aptitudes thermostatiques et tactiles étonnantes, sans compter l’efficacité particulière du rempart qu’elle oppose aux agressions du milieu, bref que toutes ces propriétés seraient suffisamment marquantes pour susciter l’intérêt des chercheurs. Mais, aussi étrange que cela puisse paraître, ce ne fut pas le cas, du moins jusqu’à ces dernières années » (11). Environ une décennie plus tard, le psychanalyste français Didier Anzieu (1991) avance un argument semblable. Alors que notre existence elle-même en dépend, nous avons tendance à prendre notre peau pour acquis, affirme-t-il : « […] il n’y a pas d’être humain sans une enveloppe de peau à peu près complète. Si un septième de la peau est détruit par accident, lésion, brûlure, l’être humain meurt. […] La peau est tellement fondamentale, sa fonction va tellement de soi que personne n’en remarque l’existence jusqu’au moment où elle est défaillante » (63).
Si la peau est souvent reléguée au second plan dans la vie de tous les jours, elle est cependant à l’origine d’expressions linguistiques bien établies (Anzieu, 1989 ; Benthien, 2001 ; Connor, 2004). De nombreuses expressions utilisées dans le langage courant font en effet référence aux structures et fonctions de la peau, révélant du même coup la place qu’elle occupe dans l’imaginaire collectif. Nous utilisons par exemple les locutions « faire peau neuve » ou « être bien dans sa peau ». Montagu 1979) offre d’autres exemples pertinents : « Certaines personnes […] ont “la peau dure”. D’autres encore ont une susceptibilité “à fleur de peau”. On peut “entrer dans la peau d’un personnage” ou “avoir quelqu’un dans la peau” (11). Toutes ces expressions considèrent la peau comme une métaphore de la subjectivité humaine et soulignent de ce fait son importance manifeste.
L’importance de la peau est aussi étroitement liée à la façon dont les sujets entretiennent et modifient leur corps. La peau fait en effet partie intégrante des rituels quotidiens de soins du corps comme le nettoyage et la toilette. Elle est par ailleurs impliquée dans le piercing, le tatouage, la scarification ainsi que dans les chirurgies cosmétiques, reconstructives et de transplantation. Il n’est dès lors pas surprenant que cet organe attire l’attention des médecins et des chirurgiens, mais aussi celle des publicitaires, des allergologues, des esthéticiens, des comédiens, les hygiénistes, des publicistes et des massothérapeutes, pour n’en nommer que quelques-uns (Anzieu, 1989). La peau nous met au défi et nous la mettons au défi à notre tour, où que nous soyons et quoi que nous fassions ; c’est un élément avec lequel nous devons nous engager activement à mesure que nous devenons ce que le phénoménologue Maurice Merleau-Ponty (1965) appelle le « corps-sujet ». En fait, si le corps est un projet, alors la peau est l’un des principaux sites où il est mené à bien. La peau n’est donc pas simplement un élément avec lequel nous devons vivre ; c’est un élément sur, avec et vers lequel nous devons travailler (Ahmed et Stacey, 2001 : 2).
La peau est un élément omniprésent de l’expérience de la corporéité du sujet, mais c’est aussi un élément qui ne cesse d’évoluer. Située à la limite de l’intérieur et de l’extérieur, de soi-même et de l’autre, du sujet et de l’objet, la peau se caractérise par « […] un statut d’intermédiaire, d’entre-deux, de transitionnalité » (Anzieu, 1995 : 39). Ce statut est partout en évidence : la peau est à la fois superficielle et profonde, permanente et temporaire, délicate et résiliente. Elle protège et attaque, unit et divise, révèle et dissimule. Elle est une frontière absolue, un bouclier universel, une armure défensive et une enveloppe qui nous aide à garder une posture. Elle assure notre cohésion, mais nous différencie aussi les uns des autres. La peau est omniprésente : il est impossible d’y échapper. Mais la peau est aussi en constante mutation. C’est une frontière fluide et une interface perméable. Elle est sans cesse configurée et reconfigurée par les relations affectives, les transactions sensorielles et les interactions sociales. Loin d’être une membrane scellée ou homogène, la peau est pleine de plis, de pores et d’orifices qui la poussent dans le monde et qui poussent le monde en elle. Vu sa capacité à se replier sur elle-même tout en conservant une orientation intérieure et extérieure, la peau — et la chair dont elle fait partie — peut être caractérisée par ce que Merleau-Ponty (1968) appelle la « réversibilité ».
La peau est dans un état constant d’activité sensorielle. Car même lorsqu’elle n’est pas touchée par d’autres, elle se touche souvent elle-même. De tous les phénomènes paradoxaux associés à la peau, le plus fondamental — tant pour Merleau-Ponty (1965) que pour Anzieu (1989) — est sans doute le toucher. Le toucher, ressenti à la fois à l’intérieur et à l’extérieur et perçu par le sujet et l’objet, peut non seulement être considéré comme paradoxal, mais aussi comme réflexif. En fait, pour Merleau-Ponty, la peau est unique parce qu’elle est capable de ce qu’il appelle une « sensation double ». Il utilise l’exemple d’une main touchant l’autre pour expliquer que l’on peut être à la fois l’objet et le sujet du toucher. Et si Merleau-Ponty n’aborde qu’implicitement le rôle de la peau dans la sensation double, Anzieu (1991) l’exprime quant à lui très clairement. Il écrit : « En effet, l’expérience tactile possède cette particularité, par rapport à toutes les autres expériences sensorielles, d’être à la fois endogène et exogène, active et passive […] Cette sensation double, passive et active, est propre à la peau. La sensation tactile procure la distinction de base entre le “dedans” et le “dehors” et elle est la seule qui puisse la donner […] » (63).
La notion de sensation double démontre que la peau est habilitante : elle nous permet à la fois de sentir et de percevoir nos milieux de vie et d’être sentis et perçus par eux. Mais la peau peut également être handicapante, en particulier quand on a l’impression qu’elle nous trahit. Une peau défaillante est très souvent une peau qui nous déçoit, voire nous dégoûte quand elle n’agit pas comme nous aimerions qu’elle le fasse. La peau devient ici une peau étrangère ou une peau qui ne semble pas nous appartenir : elle nous irrite, nous échappe et nous préoccupe pendant des jours, des semaines, voire des années. Il n’est donc guère surprenant que cet organe soit à la base d’une économie commerciale en plein essor et qu’elle soit à l’origine de pratiques de consommation allant de l’usage quotidien de savons et de cosmétiques au recours à des technologies plus complexes comme les greffes, les injections, les chirurgies et les transplantations. La facilité d’accès et l’abordabilité de la culture de la peau à partir de cellules souches, de l’impression 3D et d’un vaste éventail de procédures médicales peuvent nous donner l’impression que la peau est pratiquement invincible. Pourtant, lorsqu’on traite la peau comme si sa malléabilité et sa plasticité ne connaissaient aucune limite, on constate rapidement son extraordinaire fragilité. Nous pouvons utiliser les techniques les plus innovatrices à notre disposition, mais les tentatives de faire de la peau quelque chose qu’elle n’est pas rencontrent souvent une certaine résistance.
La peau peut être handicapante tant à un niveau individuel que collectif. Il est ainsi attendu que les femmes montrent plus de peau que les hommes. Dans la publicité, la télévision, le cinéma ou la pornographie, les femmes exposent souvent leur peau. Par ailleurs, comme l’illustre clairement l’histoire des normes de beauté occidentales, il n’est pas inhabituel qu’elles soient jugées sur ce critère. On s’attend bien plus à ce que les femmes prennent soin de leur peau par des routines de nettoyage complexes et onéreuses, l’épilation, l’application de lotions et, dans un nombre croissant de cas, les injections de Botox et les liftings. On incite par ailleurs les femmes à « améliorer » l’apparence de leur peau en utilisant des fonds de teint, des produits anticernes, des fards, des ombres à paupières et des rouges à lèvres. Alors que les hommes ayant une peau rêche ou marquée sont généralement considérés comme plus masculins, les femmes dont la peau n’est pas douce, lisse et exempte d’imperfections sont perçues comme étant moins féminines. On s’attend ainsi à ce qu’elles mettent en valeur leur peau en utilisant des produits comme du brillant à lèvres et du vernis à ongles et en portant des accessoires comme des boucles d’oreilles, des colliers et des bracelets. Finalement, la peau des femmes doit sentir bon : elle doit être propre, fraîche et parfumée en tout temps.
La peau racialisée est elle aussi marquée par les rapports de force et traitée comme un objet par les stéréotypes oppressifs, contrairement à la peau non racialisée. Trop souvent, elle est victime des violences d’État. La peau noire, par exemple, est souvent vue à travers le prisme de ce que le psychiatre afro-caribéen Frantz Fanon appelle « le schéma épidermique ». Dans Peau noire, masques blancs, Fanon soutient que ce schéma réduit les individus noirs à leur peau à travers la création, la perpétuation, la rigidification et la sédimentation d’un « regard blanc ». Ce regard met l’accent sur les différences de couleur de peau tout en insistant sur les distinctions dites naturelles qu’elles permettent supposément d’établir entre les groupes raciaux. Et si Anzieu et Merleau-Ponty évitent les spécificités racialisées de la peau en supposant que tous les individus partagent un « moi corporel » ou un « schéma corporel » semblable, Fanon s’attarde quant à lui longuement sur ces spécificités et montre que la racialisation de la peau noire est caractérisée par ce que l’on pourrait appeler un « jeu de surfaces ». En d’autres mots, la race n’a aucune profondeur : la première surface (le masque blanc) ne cache rien d’autre qu’une seconde surface (la peau noire). Certains experts — comme Anzieu et Montagu, son prédécesseur — affirment que la peau est un élément que nous avons tendance à oublier dans la vie de tous les jours, mais il est bon de rappeler que tout le monde n’a pas ce luxe. Cet oubli est, à de nombreux égards, un privilège dont jouissent rarement les individus dont la peau est racialisée.
Les complexités de genre, de sexe et de race démontrent dans quelle mesure la peau est partagée par l’individu et la collectivité. Cela est d’autant plus vrai de nos jours avec la multiplication des plateformes en ligne — les médias sociaux et les sites de pornographie hardcore, par exemple — qui donnent à la peau une plus grande visibilité. La peau matérielle est ainsi projetée dans la virtualité grâce à l’accélération des développements technologiques, qui repoussent les frontières de la corporéité. De la même façon, les méthodes de transformation de la peau actuellement employées dans la recherche médicale et la production bio-artistique remettent en cause notre compréhension de la place de cet organe dans l’ordre des choses. Des scientifiques ont par exemple réussi à prélever des cellules cutanées de patients souffrant d’insuffisance cardiaque et à en faire des tissus cardiaques qui pourraient un jour être utilisés pour soigner cette pathologie (Kelland, 2012). Les bio-artistes ont eux aussi testé des techniques d’hybridation en cherchant à fusionner la peau humaine avec celles d’animaux ainsi qu’avec des objets de tous les jours (Solon, 2011). Cela dit, il est cependant important de rappeler que ces expériences ne sont pas toujours réussies. Elles le sont dans certains cas, mais, dans d’autres, la peau et son agentivité souvent mystérieuse résistent, donnant lieu à des expériences médicales ratées et à des résultats artistiques inattendus.
Malgré les transformations complexes qu’on lui fait aujourd’hui subir, la peau reste l’un des éléments les plus fondamentaux et indispensables de notre identité. Elle constitue à la fois le fondement de notre système sensorimoteur et notre premier instrument d’engagement et d’échanges interpersonnels. Les mécanismes de la peau semblent en outre suggérer — comme l’ont d’ailleurs fait remarquer certains auteurs du XXe siècle comme James Joyce et Paul Valéry — que la surface du corps est la partie la plus profonde de l’être humain (Anzieu, 1989 ; Connor, 2004)[2].
La peau nous permet d’occuper une place dans l’espace et dans le temps. Elle nous permet d’avoir une perspective sur le monde et permet à celui-ci d’avoir une perspective sur nous. La peau est une archive des expériences passées, une cartographie de l’identité, un lieu de plaisirs vulnérables, une carapace de douleurs souvent impitoyables et un écran dynamique sur lequel nous-mêmes, les autres et les sociétés projetons des sentiments d’amour, de haine et tout ce qui se trouve entre les deux. Pour ces raisons, le domaine des études de la peau mérite une plus grande reconnaissance. Comme nous le verrons, ce domaine s’éloigne des hypothèses courantes qui présentent la peau comme un simple contenant, un écran à une face ou un bouclier impénétrable. Il considère plutôt la surface du corps comme fondamentalement « co-constituée, co-représentée et co-évolutive » (Blackman, 2010 : 4) dans les contextes multiples de l’expérience, du pouvoir et de la technologie.
L’émergence des études de la peau
Les études de la peau sont encore en pleine émergence, mais elles sont suffisamment établies pour revendiquer ce que l’on pourrait appeler un « canon » de textes clés. Pour décrire adéquatement ce corpus, il convient de présenter d’abord l’ouvrage révolutionnaire de Jay Prosser sur la corporéité transsexuelle. Publié en 1998, Second Skins: The Body Narratives of Transsexuality a contribué de façon cruciale au domaine qui nous intéresse. Prosser tente d’opérer un retour critique sur les spécificités matérielles du corps vécu et, ce faisant, d’offrir aux experts une alternative aux travaux poststructuralistes qui constituaient la norme à l’époque de la parution de son ouvrage. Il se tourne vers les travaux d’Anzieu pour chercher à répondre à la question suivante : « Quel est le statut de la surface du corps que le transsexuel cherche à reconfigurer lorsqu’il change de sexe ? » (65). Il s’appuie plus particulièrement sur le modèle du moi-peau, largement méconnu à l’époque dans le contexte anglo-américain, pour développer une théorie de la corporéité transsexuelle qui est considérée encore de nos jours comme l’une des plus lucides sur le sujet (65).
Si l’ouvrage de Prosser sur le changement de sexe a contribué à en faire une figure clé des études trans, un domaine aujourd’hui en plein essor, c’est surtout son engagement critique avec l’approche psychanalytique d’Anzieu et les applications imaginatives qu’il en fait qui ont fait de ses travaux des références dans le domaine des études de la peau. Louant le « littéralisme merveilleusement simple » d’Anzieu, Prosser organise son ouvrage autour de l’un des principaux arguments du psychanalyste, à savoir que le développement du moi est ancré d’abord et avant tout dans l’expérience de la peau (65). Anzieu fondait cet argument sur les remarques sur le moi corporel faites par Freud dans Le moi et le ça. Freud (2010) y affirme en effet que le moi peut être considéré comme « la projection d’une surface » de la psyché, car il est « dérivé de sensations corporelles » (66). S’appuyant sur l’interprétation des réflexions de Freud faite par Anzieu, Prosser affirme que « la surface ou l’enveloppe physique du corps fournit un soutien anaclitique à l’appareil psychique : l’ego, le sentiment du soi, résulte de l’expérience de la peau matérielle » (65). Prosser conclut que le modèle du moi-peau proposé par Anzieu peut être utile aux chercheurs dans la mesure où il « s’efforce de reconstituer et de présenter le corps matériel » comme un objet de questionnement critique (66).
L’ouvrage de Prosser a eu une double influence sur les études de la peau. Il a en effet incité les chercheurs du domaine à prendre au sérieux l’expérience vécue de la peau, mais aussi à continuer d’accorder une importance particulière aux travaux d’Anzieu. Ainsi, l’ouvrage de Prosser a en quelque sorte ouvert la voie à la publication du premier recueil édité sur le thème de la peau : Thinking Through the Skin, dirigé par Sara Ahmed et Jackie Stacey. Publié en 2001, cet ouvrage fait partie intégrante du corpus des études de la peau. Dans une introduction passionnante qui est aujourd’hui largement citée, Ahmed et Stacey suggèrent que l’adoption d’une pensée critique au sujet de cet organe peut permettre de développer des « moyens nouveaux et différents de considérer la corporéité vécue et imaginée » et « présente le potentiel de défaire les dichotomies qui opposent intérieur et extérieur ; surface et profondeur ; et soi et autre, des dichotomies qui imprègnent souvent les récits de subjectivité incarnée » (1). Les auteures font référence à un certain nombre de penseurs, notamment Anzieu, Merleau-Ponty et Fanon, dont les travaux semblent avoir été particulièrement utiles pour les chercheurs critiques qui cherchaient à « défaire [ces] explications dichotomiques » en vue de reconsidérer et, ultimement, de reconceptualiser les vies individuelle et collective de la peau. Comme l’ouvrage de Prosser, le recueil d’Ahmed et Stacey peut être considéré comme une réponse imaginative aux récits « désincarnés » de pouvoir et de subjectivité « amenés au-devant de la scène par les modèles dominants du structuralisme et du poststructuralisme, qui, littéralement et métonymiquement, ont placé le langage au cœur des théories de la culture » (4).
Même s’il a été publié il y a plus de ١٥ ans, l’ouvrage d’Ahmed et Stacey reste encore aujourd’hui un modèle pour les chercheurs qui s’intéressent aux études critiques de la peau, et ce, pour au moins trois raisons. Il s’agit tout d’abord d’un ouvrage transdisciplinaire, dans la mesure où il s’appuie sur un vaste éventail d’approches analytiques, notamment la philosophie continentale, la psychanalyse contemporaine, l’historiographie culturelle, les études des médias populaires et l’anthropologie sociale. Le recueil s’attarde par ailleurs aux complexités publiques et privées de la corporéité et propose une réflexion critique sur la façon dont elles sont vécues sur et à travers la peau. Finalement, il se caractérise non pas par l’orthodoxie théorique, mais par une vaste variété de perspectives qui se combinent pour donner lieu à une interprétation élégante et éclectique des aspects psychiques, somatiques et sociaux de la peau. On peut ainsi considérer qu’Ahmed et Stacey, inspirées de diverses manières par les principes fondamentaux des études du corps, ont joué un rôle important dans l’émergence des études de la peau.
En 2002, un an après la parution de Thinking Through the Skin, Claudia Benthien publie un ouvrage intitulé Skin: On the Cultural Border Between the Self and the World. Cette première étude approfondie de la peau depuis une perspective critique reçoit un accueil très chaleureux. Mêlant l’anthropologie historique avec ce qu’elle appelle le « constructivisme culturel », Benthien tente de donner un sens aux « principaux topoï, métaphores et représentations mentales » qui ont façonné les compréhensions occidentales modernes de la peau (ix). Ce faisant, elle teste l’hypothèse selon laquelle « le tégument du corps est devenu une frontière de plus en plus rigide, et ce, en dépit du fait que la médecine a pénétré la peau et exposé l’intérieur du corps » (1). En s’appuyant sur des œuvres artistiques et littéraires et sur des travaux scientifiques, elle découvre que « même au XVIIe et au début du XVIIIe siècle, [la peau] était encore considérée comme une surface poreuse, non fermée » (14). Cette perspective a cependant commencé à changer au XVIIIe siècle, avec l’émergence de la bourgeoisie et de ses conventions sociales et culturelles. Selon Benthien, la peau est tout sauf une frontière « superflue » dans l’imagination collective ; elle croit même que les fonctions et les structures de la peau « ont acquis une importance encore plus marquée » (11).
En jetant des ponts entre la recherche historique méthodique et l’analyse culturelle originale, l’ouvrage de Benthien offre un exemple clé de la façon dont les études critiques sur la peau doivent être considérées dans un contexte littéraire et visuel. Benthien n’est cependant pas la seule à aborder le sujet sous cet angle. En fait, deux ans après la parution de cet ouvrage, Steven Connor (2004) publie une étude approfondie de la surface du corps qui s’appuie elle aussi largement sur la culture littéraire et visuelle. Dans The Book of Skin, Connor construit son analyse autour des innombrables manifestations littérales ou métaphoriques de la peau, de la langue de tous les jours à la littérature épique. Ses chapitres traitent de sujets comme le teint, l’exposition, le défigurement, l’empreinte, les stigmates, la couleur, l’onction, l’odeur et la démangeaison. Au fil des chapitres, Connor réussit à montrer que la peau ne doit plus simplement être considérée comme une frontière, un contenant ou une membrane, mais qu’elle doit, au contraire, être vue comme une écologie globale dans et à travers laquelle prennent forme les relations avec soi-même, les autres et la société.
Dans son ouvrage, Connor (2004) présente une histoire culturelle de la surface du corps. Ce faisant, il soutient que « si l’on devait interpréter l’histoire culturelle de la peau en des termes médicaux seulement, trois phases devraient être distinguées » (2004 : 26). Pendant la première phase — qui inclut les périodes classique et médiévale —, la peau était souvent considérée comme un écran ; elle était, en d’autres mots, « cet élément invisible à travers lequel le corps doit être vu, la toile de fond contre laquelle le corps est projeté » (2004 : 26). Pendant la deuxième phase, toutefois, la peau était surtout perçue comme une membrane. Cette conception typique de la période des Lumières « s’intéressait surtout à l’élimination des déchets [organiques] » (2004 : 26). Finalement, à l’époque moderne — la troisième phase —, les métaphores de la peau comme écran et comme membrane ont été remplacées par une autre métaphore : celle de la peau comme milieu. Empruntant le concept de « milieu » de Michel Serres (1998), Connor décrit la peau comme n’étant ni active ni passive, ni intérieure ni extérieure, ni sujet ni objet. Il soutient qu’elle est, au contraire, au cœur d’un vaste éventail de relations changeantes et imprévisibles avec le reste du monde. Pour Serres et Connor, la peau est le lieu de rencontre entre le monde et le corps ; elle est, en d’autres mots, ce qui « intervient dans les choses du monde et fait en sorte qu’elles se mélangent » (Connor, 2004 : 97).
Les travaux précurseurs de Jay Prosser (1998), Sara Ahmed et Jackie Stacey (2001), Claudia Benthien (2002) et Steven Connor (2004) ont profondément changé le paysage académique de l’étude de la peau. Ensemble, ces quatre ouvrages ont donné aux spécialistes de nouveaux outils pour mener une réflexion critique sur la surface du corps et pour la considérer non plus seulement comme une métaphore, mais aussi comme un phénomène psychique, somatique et social. Après la publication de ce corpus restreint mais significatif, il y a un peu moins de 20 ans, le domaine des études de la peau a commencé à prendre son essor parmi les chercheurs anglo-américains. Un deuxième recueil intitulé Re: Skin est publié en 2006. L’ouvrage, édité par Mary Flanagan et Austin Booth, étudie les relations entre la peau, le corps et la technologie à une époque où nous sommes non seulement capables de modifier notre peau plus que jamais, mais aussi de « croiser les peaux par la fusion avec d’autres corps » (1). L’ouvrage aborde une diversité de sujets et inclut des réflexions poussées sur la peau ainsi que des projets créatifs et des œuvres de fiction. Les auteurs du recueil se penchent sur une multitude de sujets, y compris les interfaces informatiques, la fausse fourrure, la grossesse, les sensations sexuelles et la race à l’ère du numérique. Dans l’ensemble, l’ouvrage offre une réflexion sur les implications de la vie dans une culture technologique et, ce faisant, « [propose] une étude multidisciplinaire des frontières et des limites des surfaces […] en incorporant et en impliquant la métaphore, la présence physique et les récits culturels de la peau » (2-3).
Peu de temps après, en 2008, la revue English Studies in Canada publie un premier numéro spécial sur la peau[3]. Le numéro est édité par Julia Emberley, qui signe également une introduction qui présente l’étude critique de la peau en des termes biopolitiques et examine de quelle façon « la peau réagit au pouvoir » (6). Elle parle notamment des experts médicaux qui, dans les années 1950, se sont approprié la peau d’enfants inuits pour mener des expériences de greffes de peau. En montrant que la peau inuite a simultanément servi de site de règlementation et de résistance, Emberley pose les bases de la présentation des différents articles du numéro qui, comme elle l’affirme, « [tentent] d’explorer les contestations et les régimes dans et autour des vérités historiquement inscrites sur la peau, géopolitiquement, psychanalytiquement, matériellement et poétiquement » (6).
Un an plus tard, en 2009, la revue Body and Society publie un dossier spécial présentant les travaux de Marc Lafrance, d’Erin Manning et de Dee Reynolds. Lafrance présente une étude critique des travaux réalisés par des psychanalystes contemporains comme Esther Bick et Thomas Ogden, qui ont selon lui donné aux théoriciens du corps des approches novatrices pour donner un sens à la relation entre la peau et le moi (3). Reynolds répond à l’article de Lafrance en examinant les travaux de Bick et d’Ogden dans le contexte de la danse. Elle soutient ainsi que ces travaux ouvrent la voie à des réflexions sur la façon dont « [la danse] peut donner lieu à une conscience accrue de la surface du corps et à une contiguïté sensorielle » (30). Finalement, Manning présente une critique des travaux examinés par Lafrance, et en particulier de l’importance accordée à « la capacité de la peau à servir de contenant pour l’expérience », en affirmant que la peau doit être considérée comme une « surface topologique multidimensionnelle qui s’incorpore et se replie à travers des espaces-temps d’expérience », donnant ainsi lieu à une « forme dynamique de présence au monde qui refuse toute catégorisation » (42).
Quatre ans plus tard, en 2013, une conférence intitulée Probing the Skin: Cultural Representations of Our Contact Zone s’ouvre à l’Université Friedrich Schiller, à Jena, en Allemagne. Les organisateurs, Caroline Rosenthal et Dirk Vanderbeke, souhaitent que la rencontre soit l’occasion de mener des « réflexions artistiques sur des thèmes liés à la peau dans la littérature, l’art, les études des médias et l’anthropologie[4] ». L’objectif est de rassembler des universitaires issus de diverses disciplines pour aborder le thème de la peau et remédier à sa faible présence dans la recherche sur le corps. La conférence donne lieu à la publication d’un recueil du même nom en 2015. L’ouvrage collectif, dirigé par les organisateurs, porte sur divers sujets dans les domaines de l’histoire médicale et politique, la littérature moderniste et post-moderniste, le cinéma et les beaux-arts. Comme la majeure partie des ouvrages qui tentent de « [traiter] la peau comme un sujet à part entière », le recueil considère la surface du corps comme « un organe sensuel, une interface, un marqueur d’identité, un espace de mémoire, un support et un objet d’investigation et de représentation » (3).
Finalement, en 2016, la Society for the Humanities de l’Université Cornell envoie un appel à propositions pour des projets de recherche interdisciplinaire en lien avec la peau. Les projets proposés peuvent s’inscrire dans une multitude de « périodes historiques, [de] disciplines, [de] territoires géographiques et [de] contextes sociaux[5] ». Plus concrètement, l’appel à propositions encourage les chercheurs à soumettre des propositions abordant des sujets aussi variés que les travaux mythologiques, les traditions religieuses, les réflexions philosophiques, la théorie psychanalytique, les perspectives intersectionnelles et les impératifs biopolitiques, pour n’en nommer que quelques-uns. La multitude de projets potentiels évoqués dans le document suggère que l’étude critique de la peau est de plus en plus importante dans le milieu académique contemporain.
À mesure que les études de la peau ont émergé comme un domaine d’étude à part entière, la recherche sur le sujet est devenue plus variée et plus volumineuse. Je vous présente ci-dessous des textes importants du corpus en lien avec quatre sujets clés, soit la modification du corps, la racialisation, la psychanalyse et les sens. En présentant un résumé critique de certains des travaux qui caractérisent le domaine des études de la peau, j’espère encourager les échanges intellectuels dans ce domaine émergent.
Un aperçu des études de la peau
Lorsqu’on examine les travaux de sciences humaines et sociales réalisés actuellement, on constate que la recherche sur la peau est à la fois mieux établie et plus abondante que nous pourrions le croire. L’aperçu qui suit est loin d’être exhaustif : l’objectif est de présenter une introduction générale aux études de la peau et non de dresser un portrait définitif de l’état des connaissances. J’y présenterai les travaux qui m’apparaissent comme les plus pertinents pour les spécialistes des études du corps et je mettrai l’accent sur ceux qui se caractérisent par une approche critique et une orientation réflexive.
Modification du corps. Un certain nombre d’études évocatrices sur la façon dont la peau est impliquée dans les projets de modification du corps sont apparues au cours des dix à quinze dernières années. Patricia MacCormack (2006) cherche par exemple à présenter le corps tatoué, en particulier le corps féminin, comme « un exemple des complexités philosophiques associées au fait de considérer la surface du corps comme une frontière entre soi-même et la culture » (57). Affirmant que la peau est « une série de plans qui marquent la race, le sexe, l’âge et ainsi de suite » (57), MacCormack étudie de quelle façon le tatouage altère ces plans « à travers les affects qu’il évoque » (59). Elle s’appuie non pas sur la phénoménologie ou la psychanalyse, comme le font souvent les chercheurs qui étudient la peau, mais sur la notion de « corps sans organes » de Deleuze et Guattari et celle de « grande pellicule éphémère » de Lyotard. Elle conclut que « [le tatouage] et la peau elle-même s’inscrivent dans un interstice équivalent, formant et forçant la déconnexion entre la matière et la pensée, l’intérieur et l’extérieur, soi-même et l’autre et la philosophie et l’affect » (80).
Comme MacCormack, Maurice Patterson et Jonathan Schroeder (2010) s’intéressent aux corps tatoués, en particulier aux corps féminins tatoués, et à la façon dont ils peuvent être lus sur et à travers la peau (254). Les réflexions de Patterson et Schroeder suggèrent que « [la peau] incarne parfaitement les principales tensions qui règnent dans la culture de consommation, en particulier entre la libération, la célébration et l’agentivité, d’une part, et la répression, la disciplinarité et la conformité, d’autre part » (263). En dépit du fait que la surface du corps a été « étrangement périphérique » à la recherche sur la culture de consommation par le passé, les auteurs soutiennent que sa « liminalité, son caractère d’entre-deux et son ambiguïté […] se combinent pour en faire un moyen puissant permettant d’explorer plus avant la consommation et l’identité incarnée » (254). S’appuyant sur la théorie féministe, la théorie de la culture de consommation et la recherche existante sur les tatouages, ils utilisent les trois métaphores de « la peau comme contenant, la peau comme surface de projection et la peau comme enveloppe pouvant être modifiée » comme des « cadres » (framing devices) leur permettant de mieux comprendre les relations entre la féminité, la peau et la consommation (257).
Comme MacCormack (2006) et Patterson et Schroeder (2010), Emily Grabham explore de quelle façon la peau est porteuse de sens dans les pays occidentaux modernes. Grabham ne s’intéresse pas aux tatouages, mais plutôt aux technologies chirurgicales qui semblent parfois être utilisées pour « marquer » la peau en lui donnant une signification politique en fonction du contexte. Elle soutient que « tout comme la nation est imaginée et produite par les cartes et la rhétorique de tous les jours, elle est aussi bâtie sur la peau, et à travers les corps, par différents types de “marquages” corporels » (64). Grabham s’appuie sur la recherche critique en lien avec l’appartenance, la propriété, la peau et les somatechniques et présente deux cas de marquage de la peau. Elle traite d’abord « des chirurgies réalisées au Royaume-Uni pour aligner les corps blancs avec une nation blanche » et aborde ensuite « la façon dont les médias américains parlent des vétérans de l’invasion en Irak qui portent des membres prosthétiques », qui sont conçus pour « créer une appartenance corporelle grâce à la transcendance technologique » (64). Grabham montre que les procédures chirurgicales qu’elle étudie « inscrivent la nation dans la surface de la peau » tout en offrant aux spécialistes des exemples fascinants de « la façon dont les surfaces, les formes et les capacités des corps en arrivent à avoir une signification nationaliste » (66).
Rachel Hurst adopte une approche différente d’un même sujet en s’intéressant aux chirurgies cosmétiques et à ceux et celles qui s’y soumettent. Dans une étude approfondie intitulée Surface Imaginations: Cosmetic Surgery, Photography and Skin, Hurst montre de quelle façon les surfaces de la photo et de la peau sont mises au service d’un ordre symbolique qui présente la première comme « une surface prometteuse, pleine de possibilités transformatrices infinies » et la seconde comme « une surface moins prometteuse qui, bien que capable de transformations miraculeuses, impose des limites à ce que la chirurgie peut accomplir » (xv). S’appuyant sur les travaux psychanalytiques d’Anzieu et de Lacan, les ouvrages de Prosser, Benthien et Connor sur la peau ainsi que les approches féministes contemporaines de la chirurgie cosmétique, Hurst suggère que les cultures occidentales modernes sont caractérisées par une « imagination de surface », c’est-à-dire par une croyance collective selon laquelle la modification de la surface du corps entraîne une transformation à grande échelle de nos vies publique et privée (xviii). L’étude de Hurst constitue un apport novateur au domaine des études de la peau, car elle propose de nouvelles façons de penser la relation entre la surface de la peau et celle de la photo.
Racialisation. De nombreuses études critiques ont été réalisées au sujet de la race et de la racialisation[6]. La majeure partie de ces travaux s’inspirent de l’ouvrage de Fanon intitulé Peau noire, masques blancs et abordent les thèmes du colonialisme, de la diaspora, de l’hybridité et de la performativité depuis divers angles. Près d’une douzaine d’ouvrages publiés au cours des 20 dernières années portent des titres qui font directement référence au livre de Fanon et au jeu de surfaces racialisé qu’il évoque. La plupart de ces ouvrages traitent de la peau de groupes raciaux marginalisés ou de groupes ethniques, comme les Africains noirs (Heaton, 2013) ; les Africains-Américains (Gubar, 1997) ; les Asio-Américains (Yang, 2013) ; les Moyen-Orientaux (Dabashi 2011) ; les Africains britanniques (Tate, 2005) ; les Afro-Caribéens (Beriss, 2004 ; Mielants, 2007 ; Verges, 1997) ; et les Autochtones (Coulthard, 2014). D’autres traitent de populations blanches et de la façon dont la blanchitude est créée et maintenue (Alexander, 2004 ; Goldsmith, 2003). Pris ensemble, ces travaux montrent que les travaux de Fanon ont contribué durablement à la réflexion critique sur la façon dont les structures du pouvoir façonnent et sont façonnées par la relation entre la peau, le soi et le social.
Si le racisme peut être considéré comme un jeu de surfaces racialisé, comme le soutient Fanon, il vaut la peine de réfléchir à la façon dont ces surfaces sont vécues et comprises dans les cultures contemporaines. C’est précisément ce que tentent de faire les chercheurs qui s’intéressent au blanchissement de la peau. De nombreux spécialistes étudient par exemple la façon dont cette pratique est commercialisée et consommée dans une multitude de pays différents, en particulier ceux de l’hémisphère sud (par ex., Ayu Saraswati, 2010 ; Glenn, 2008 ; Leong, 2006 ; Mire, 2001). Deux publications sur le sujet sont particulièrement intéressantes : premièrement, le numéro spécial du Journal of Pan African Studies intitulé « Skin Bleaching in the Context of Global White Supremacy », édité par Yaba Blay et Christopher Charles (2011) ; et, deuxièmement, l’étude approfondie de Shirley Tate (2016) intitulée Skin Bleaching in Black Atlantic Zones: Shade Shifters. Les articles du numéro spécial édité par Blay et Charles mettent l’accent sur le fait que « [dans] le contexte de la suprématie blanche mondiale, la couleur de la peau indique la position de l’individu au sein de la structure de pouvoir dominante » tout en s’attardant à la façon dont « ceux qui, historiquement, ont été soumis à la domination, à la colonisation et à l’asservissement par les Blancs ont internalisé des notions projetées selon lesquelles leur couleur de peau est le fondement de leur condition inférieure » (Blay, 2011 : 37). Tate adopte pour sa part une approche différente. Elle s’intéresse à ce que signifie le fait d’avoir « une peau noire plus pâle dans le monde “post-racial” du XXIe siècle » (3). Contrairement à celle de Blay et Charles, son « analyse va au-delà de l’impact de la suprématie blanche mondiale et de ses économies de marché, qui perpétuent la blanchitude comme un idéal et introduisent la pathologie noire » (3). Elle cherche en effet à « [présenter] le changement de teint comme un choix et une amélioration esthétique “post-raciale”, une forme d’auto-affirmation, plutôt qu’une réaction à la suprématie blanche et à la discrimination fondée sur la couleur de la peau » (4).
Dans Second Skin: Josephine Baker and the Modern Surface (2011), Anne Anlin Cheng cherche, comme Tate, à apporter des nuances à l’hypothèse selon laquelle la peau noire est simplement un site de domination et de subordination. Cheng parvient à faire dialoguer les études de la peau et les études post-coloniales et explore « le rêve moderniste d’une seconde peau » (1) à travers l’histoire de Joséphine Baker, une artiste noire qui a marqué le XXe siècle. Cheng ne considère pas seulement la peau comme une surface épidermique ; elle la voit aussi comme une surface architecturale, filmique, photographique et théâtrale. Ces surfaces constituent ce que Cheng appelle « des modes d’affichage moderniste ». Elles servent de contextes dans et à travers lesquels l’auteure « [relate] des histoires différentes au sujet de la peau racialisée, des récits qui nous obligent à reconceptualiser les notions de corporéité racialisée et de façades modernistes idéalisées » (7).
Psychanalyse. Les travaux psychanalytiques sur la peau se sont multipliés entre 2008 et 2014[7]. L’un d’eux, l’ouvrage d’Alessandra Lemma intitulé Under the Skin: A Psychoanalytic Study of Body Modification, s’intéresse aux modifications corporelles et à leur importance psychique, somatique et sociale. Publié en 2010, il s’inspire des travaux de psychanalystes comme Freud et Anzieu, mais également de ceux de théoriciennes culturelles comme Elizabeth Grosz et Susan Bordo. Dès le début, Lemma souligne l’importance des premières expériences sensorielles en lien avec la surface du corps. « On ne peut trop insister sur l’importance des premiers regards et du contact peau-à-peau dans la relation entre la mère et son bébé », écrit Lemma. « Le toucher et la vue sont inséparables, [ils forment] un axe unique sur lequel se fondent les premières expériences physiques. […] Ces premières expériences physiques et sensorielles avec autrui sont inscrites somatiquement et posent les bases du développement du moi corporel, et donc du moi » (6).
En 2014, Nicola Diamond publie Between Skins: The Body in Psychoanalysis. L’étude interdisciplinaire de Diamond « [remet] fondamentalement [en cause] les dualismes persistants » et « propose un modèle alternatif du corps qui est potentiellement plus viable » (3). Diamond s’intéresse d’abord et avant tout aux symptômes corporels et à la façon dont les psychanalystes devraient les interpréter. Elle croit en effet qu’« il faut développer une compréhension plus relationnelle de la formation des symptômes corporels [en tenant compte du fait que] l’expression somatique est un message dont le sujet n’est pas conscient » (3). Comme Lemma, Diamond insiste sur l’importance du contact peau-à-peau et sur la façon dont « il devient un espace relationnel dans lequel [se crée] une connexion affective entre des personnes et le monde extérieur » (3-4). Elle s’appuie en outre sur la phénoménologie, la psychanalyse, la philosophie et la neurobiologie pour explorer de quelle façon « les autres pénètrent sous notre peau, littéralement et métaphoriquement, vivent dans nos sensations et affectent nos expériences et nos processus corporels » (4).
Si les textes que j’ai évoqués ci-dessus mettent surtout l’accent sur l’aspect clinique, ceux que je présenterai ci-après sont essentiellement axés sur la dimension culturelle. Citons d’abord l’ouvrage de Naomi Segal intitulé Consensuality: Didier Anzieu, Gender and the Sense of Touch. Dans ce qui est sans doute l’ouvrage le plus complet réalisé jusqu’à présent sur les travaux de Didier Anzieu, Segal soutient, comme Diamond, que « le corps n’est pas seulement un objet vécu dans l’espace » et qu’il communique à travers « sa capacité à toucher » (4). Le livre de Segal, organisé autour du concept de « consensualité » d’Anzieu, décrit la peau comme une sorte de sensore commune, c’est-à-dire comme un site sur et à travers lequel « la perception de tous les sens » est « réunie […] en un seul endroit » (5). L’ouvrage comporte deux volets. L’auteure propose d’abord une réflexion critique sur l’histoire personnelle d’Anzieu, ses travaux théoriques et les implications genrées de son approche analytique. Elle applique ensuite ces réflexions critiques à « un ensemble d’objets, de moments, de figures ou d’angles culturels à partir du début du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui » (5). Le résultat offre un exemple convaincant de la façon dont le travail d’Anzieu peut servir de fondement à une étude de la culture centrée sur la peau et à une étude de la peau axée sur la culture[8].
Le recueil intitulé Skin, Culture and Psychoanalysis et édité par Cavanagh, Failler et Hurst est publié en 2012. L’ouvrage « offre une contribution unique à la littérature en utilisant simultanément les méthodes de recherche des études culturelles et de la psychanalyse pour théoriser la peau » (13). Parce que la peau a « une vie biologique, une vie sociale, une vie imaginaire, une vie somatique, une vie politique, une vie esthétique, une vie dans le “corps vécu” et une vie culturelle », les auteurs du recueil adoptent une approche interdisciplinaire en vue de « [placer] la peau au cœur de la recherche au lieu de l’utiliser comme point de départ pour explorer des questions “plus profondes” ou “plus complexes” » (3). En associant la surface du corps à des phénomènes comme la mode, la chirurgie esthétique, les tatouages et la mutilation, les différents chapitres du recueil suggèrent que la peau doit être interprétée en tant que processus, à savoir comme un élément qui est toujours « enveloppant ». Cette notion d’« enveloppement » — qui suggère un repli simultané vers l’intérieur et vers l’extérieur — constitue l’une des principales contributions de cet ouvrage. Elle nous permet de réfléchir de façon critique à l’importance accordée à la peau via l’« interimplication » de la « culture, de la vie psychique et de la corporéité » (2).
Études sensorielles. L’étude critique des sens a fortement progressé au cours des 30 dernières années. Certains des travaux les plus intéressants de ce domaine s’intéressent à la peau et à sa vie sensorielle. Citons par exemple l’ouvrage novateur de Laura Marks (2000) sur la peau dans le contexte du cinéma interculturel et de l’expérience de la diaspora. Dans The Skin of the Film, Marks montre que ce genre de cinéma « [évoque] des souvenirs individuels et culturels en faisant appel aux connaissances non visuelles, au savoir incarné et aux expériences associées à des sens comme le toucher, l’odorat et le goût » (2). Plus précisément, Marks affirme que ces expériences sensorielles s’apparentent à ce qu’elle appelle « la visualité haptique », un mode de visualité qui peut servir et sert souvent de peau multisensorielle. En appliquant la notion de visualité haptique au cinéma interculturel, elle montre de quelle façon les rencontres cinématiques provoquent souvent une multitude d’autres rencontres sensorielles qui, pour certains membres de communautés de la diaspora, peuvent rappeler l’expérience incarnée de leur pays d’origine.
Peu de temps après Marks, Constance Classen a publié un recueil intitulé The Book of Touch. Cet ouvrage contient des articles en lien avec le sens du toucher dans les cultures non occidentales. En effet, comme l’explique Classen, « l’Occident peut difficilement prétendre avoir le dernier mot au sujet du toucher alors qu’il existe un si grand nombre de traditions tactiles remarquables dans le monde » (2005 : 4). L’une des réflexions sur le thème de la peau est celle de David Howes. S’appuyant sur un éventail de données transculturelles, Howes explore le phénomène de la « connaissance de la peau » (skin knowledge), c’est-à-dire « la connaissance du monde que l’on peut acquérir par la peau, à travers la sensation du soleil, du vent, de la pluie et de la forêt » (27). La connaissance de la peau telle qu’on l’observe dans les cultures non occidentales étudiées par Howes « [attribue] une certaine forme d’intelligence au corps sensible » (27), contrairement aux épistémologies dualistes caractéristiques des cultures occidentales. Les Cashinahua de l’est du Pérou croient par exemple à la « connaissance » de la peau, de l’œil et de l’oreille (28-29). L’article de Howes ne traite cependant pas seulement de la peau humaine. Le chercheur s’intéresse aussi à la croyance selon laquelle la terre a une peau. Il soutient par exemple que dans certaines traditions mythologiques, il est clair que « les peaux servent au toucher et que la peau de la terre appelle dès lors une réponse tactile » (31). Howes poursuit : « Dans le domaine du mythe, nous avons une relation peau à peau avec la terre : quand nous sommes allongés sur elle, notre peau touche la peau du monde et se mêle à elle » (31). Il fait cependant aussi remarquer que les cultures occidentales modernes ont tendance à ne pas mettre l’accent sur la relation entre la peau du corps humain et celle de la terre. La science continue plutôt de « décoller » cette peau et, ce faisant, la remplace par une multitude d’interfaces technologiques, certaines devenant « étrangères à notre toucher » et d’autres devenant « des deuxièmes [peaux] » (37).
Plusieurs années après la parution de The Book of Touch, Classen a publié une étude intitulée The Deepest Sense. L’un des chapitres de l’ouvrage porte sur la peau animale. Classen s’intéresse ainsi à la façon dont la peau des animaux était ressentie, appréciée et exploitée tout au long du Moyen Âge. Elle montre que la distinction entre l’humain et l’animal a longtemps été floue : après tout, les humains mangent des animaux, portent leurs peaux et vivent avec eux. De plus, nombre d’entre eux aiment les animaux. Les animaux domestiques, en particulier, remettent en cause l’opposition binaire entre la bête et l’humain, dans la mesure où les contacts entre les deux sont fréquents. Nous les caressons, nous les laissons dormir sur nos genoux et nous utilisons un éventail de communications tactiles pour les dresser. Mais si « les modes de communication potentiellement partagés […] par les humains et les animaux » étaient souvent considérés comme socialement utiles à l’époque médiévale, cela a commencé à changer lorsque l’écriture est devenue le mode de communication dominant (110). Classen explique : « Jusqu’au XIXe siècle, de nombreux textes étaient écrits ou imprimés sur des peaux d’animaux transformées en parchemins ou en vélins. […] L’inscription des codes de l’autorité humaine sur des peaux d’animaux était un symbole puissant de la domination exercée par la force par l’humain sur les animaux » (111).
Sheryl Hamilton (2017) aborde quant à elle un sujet plus actuel, soit l’interdiction de la poignée de main de fin de match à une époque où l’on craint les pandémies. Son article constitue un autre exemple de la façon dont les études sensorielles complètent et sont complétées par les études de la peau. Hamilton s’intéresse à la manière dont la poignée de main est devenue un sujet de préoccupation et de contestation dans des contextes biopolitiques caractérisés par « la menace d’une pandémie virale mondiale et la conscience permanente [de l’existence] de cette possibilité » (54). Dans ces contextes, la peau est présentée comme « contaminée et contaminable » et l’on présume que les mains, et en particulier les paumes, sont sales et dangereuses (54). La poignée de main de fin de match est donc de moins en moins populaire. Dans certains cas, elle a été remplacée par « d’autres gestes distants ou qui créent une distance ou par des formes de contacts moins intimes (non cutanées) » (54). Hamilton décrit la poignée de main de fin de match comme un « geste légal haptique et incarné » et soutient que la préoccupation collective au sujet de cette forme autrefois habituelle d’échange épidermique « met fortement en évidence certaines des tensions et des contradictions de nos anxiétés corporelles contemporaines » (64).
Comme je l’ai déjà mentionné, l’aperçu présenté ci-dessus est loin d’être exhaustif. J’ai en effet dû exclure un certain nombre de travaux intéressants parce qu’ils ne s’inscrivaient pas dans l’un des quatre domaines de recherche identifiés. Il se pourrait par exemple que les lecteurs de ce numéro soient intéressés par les travaux ambitieux qui ont été réalisés dans les domaines de l’architecture (Lupton, 2002) ; du cinéma (Laine, 2007 ; Pile, 2009) ; de la littérature anglaise (Curtin, 2003 ; Schneider, 2014) ; des beaux-arts (Fend, 2017) ; de la littérature française (Kay, 2006 ; Walter, 2013) et de l’histoire (Chaney, 2017).
De nouvelles contributions aux études de la peau
Le récent numéro double de la revue scientifique Body and Society sur le thème de la peau contient un éventail de nouvelles contributions à ce domaine émergent. Alors que certaines s’appuient sur des recherches existantes, d’autres ouvrent des perspectives entièrement nouvelles. Le numéro commence avec cinq articles originaux. Le premier s’intéresse à la surface du corps dans le contexte de l’automutilation. Le sociologue et anthropologue David Le Breton étudie de quelle façon la mutilation est utilisée par les jeunes pour gérer le sentiment d’impuissance qui accompagne souvent la transition vers l’âge adulte. S’appuyant sur plus de 20 années de travail sur le terrain, Le Breton explique que les coupures auto-infligées peuvent être considérées comme une sorte d’« homéopathie symbolique » dans laquelle « l’usage délibéré et contrôlé de la douleur […] agit comme un moyen de défense contre une souffrance imposée de l’extérieur ». Le Breton soutient que la mutilation peut être considérée non pas comme une activité dangereuse et destructrice, mais commeRéférences une technique de survie qui, paradoxalement, permet au jeune de ressentir moins de douleur.
Le deuxième article poursuit dans la même veine et s’intéresse lui aussi à la signification de la souffrance parfois associée à la peau. Les sociologues Marc Lafrance et R. Scott Carey se penchent sur l’acné vulgaire, le plus commun des troubles cutanés, et sur le « travail sur la peau » (skin work) qui y est souvent associé. D’après leur étude, qui s’appuie sur une analyse thématique de plus de 200 fils de discussion du groupe de soutien électronique acne.org, les individus souffrant d’acné pratiquent essentiellement trois formes de travail sur la peau : la dissimulation, la médication et les soins. Loin de s’en tenir à la littérature clinique et à ses récits souvent réducteurs sur la souffrance liée à l’acné, Lafrance et Carey examinent concrètement ces pratiques de travail de la peau et la manière dont elles façonnent et sont façonnées par les catégories identitaires comme le genre et la sexualité.
Le troisième article, rédigé par la théoricienne littéraire Naomi Segal, présente une réflexion critique sur la démangeaison et sa représentation dans divers textes, de la Bible aux travaux de psychanalyse contemporains en passant par des textes de fiction du XXe siècle. Comme les deux premiers, son article met l’accent sur la souffrance associée à l’expérience quotidienne de la peau. Pourtant, comme le montre Segal, le grattage compulsif de la peau est rarement considéré comme une source réelle de détresse. On a plutôt tendance à le voir comme une habitude comique. « La douleur est tragique », explique-t-elle, alors que « la démangeaison est comique ». Elle soutient elle-même qu’il ne devrait pas en être ainsi, affirmant qu’« il y a quelque chose de très sérieux dans la tentation de se gratter ». Cette obsession n’entraîne pas seulement l’apparition sur la surface de la peau de ce qui est perçu comme d’« horribles hiéroglyphes », elle peut aussi donner lieu à des expériences de profonde aliénation sociale. Dans l’une des rares réflexions existantes sur la démangeaison, Segal montre que le grattage compulsif constitue un moyen complexe de défaire et refaire les limites du corps[9].
Dans le quatrième article, les spécialistes des communications Janet Borgerson et Jonathan Schroder nous font passer du domaine de l’expérience à celui de la représentation. Ils soutiennent qu’en dépit de sa visibilité radicale, la peau a été étrangement invisible dans les ouvrages contemporains sur le branding et le marketing. Pourtant, comme ils le font remarquer, « la peau est appelée à faire des choses » dans le monde de la culture de consommation. En s’appuyant sur les notions de schéma épidermique et de fétiche, Borgerson et Schroeder expliquent que l’imagerie de la culture de consommation présente la peau comme la « pierre d’assise de l’identité et de la possibilité ». La culture visuelle de la publicité et du branding peut en fait être associée à un vaste éventail de pratiques photographiques racistes, car elle réduit les personnes dépeintes sur les images à leur peau.
Dans le cinquième et dernier article, l’historienne de l’art Heidi Kellett explore « un mode de représentation qui privilégie des images de la peau quasi anonymes, fragmentées, magnifiées et anatomisées ». Elle utilise le terme « portrait de la peau » (skin portraiture) pour décrire ce type de représentation, qui réoriente les frontières entre soi-même et l’autre ainsi qu’entre le sujet et l’objet, tout en remettant en cause les conceptions culturelles dominantes au sujet de l’intégrité corporelle. Pour Kellett, les œuvres bio-artistiques contemporaines qui élargissent le champ visuel et, ce faisant, permettent le développement d’une conscience aigüe de l’empathie, de la réflexivité et de la relationnalité constituent de bons exemples de « portraits de la peau ». L’auteure présente ainsi la peau comme une métaphore de la technologie et explique que le bio-art provoque l’effondrement des frontières corporelles et fait émerger un mode de vision hyper haptique qui va au-delà de la peau et du sujet.
Les cinq articles originaux sont suivis d’une série de réflexions plus courtes visant à stimuler davantage les discussions transdisciplinaires sur le thème de la peau. Comme celles de Borgerson et Schroeder et de Kellett, ces réflexions portent sur la représentation de la surface du corps dans la culture visuelle et sur ce que ces représentations révèlent au sujet de la subjectivité et de la corporéité dans les sociétés contemporaines. Le premier texte est signé par la spécialiste de la philosophie et de la littérature françaises Christina Howells et aborde les réflexions de Jean-Luc Nancy sur la peau dans le contexte de la photographie ; le second, un texte de la théoricienne féministe Rachel Hurst, étudie de quelle façon la chirurgie esthétique réduit l’écart entre la surface de la peau et celle de la photographie ; et le troisième est signé par l’historienne de l’art Julia Skelley s’intéresse à la façon dont les cultures occidentales cherchent anxieusement des preuves de dépendance sur la surface du corps. Ces trois réflexions posent les bases pour l’entretien avec l’historienne de l’art Cynthia Hammond, qui remet en cause l’idée selon laquelle les vêtements servent simplement de seconde peau. Finalement, le numéro se termine avec une postface de l’anthropologue David Howes. Ce dernier nous présente une série d’observations sur la peau dans le contexte académique et sur le terrain. Il explique aussi brièvement comment la peau était étudiée avant ce qu’il appelle « le virage dermalogique ». C’est précisément ce virage que ce numéro spécial vise à souligner : l’émergence d’un domaine qui fait de la peau un objet d’étude à part entière et, ce faisant, nous permet de réfléchir de façon critique et de repenser la plus profonde de nos surfaces.
Références bibliographiques
Ahmed, Sara et Stacey, Jackie, « Introduction: Dermographies », dans Ahmed et Stacey (dir.), Thinking through the skin, Londres : Routledge, 2001.
Ahmed, Sara et Stacey, Jackie (dir.), Thinking through the Skin, Londres : Routledge, 2001.
Alexander, Bryant Keith, « Black skin/white masks: The performative sustainability of whiteness (with apologies to Frantz Fanon) », Qualitative Inquiry, vol. 10, no 5, 2004, p. 647-672.
Anzieu, Didier, The skin ego (trad. de Chris Turner), New Haven, CT : Yale University Press, 1989.
Anzieu, Didier, A skin For thought: Interviews with Gilbert Tarrab on psychology and psychoanalysis (trad. de Daphne Nash Briggs), Londres : Karnac, 1990.
Anzieu, Didier, Une peau pour les pensées : entretiens avec Gilbert Tarrab, Paris : Éditions Apsygée, 1991.
Anzieu, Didier, Le moi-peau, 2e éd., Paris : Dunod, ١٩٩٥.
Anzieu, Didier, The skin-ego (trad. de Naomi Segal), Londres : Karnac, 2016.
Saraswati, L. Ayu, « Cosmopolitan whiteness: The effects and affects of skin-whitening advertisements in a transnational women’s magazine in Indonesia », Meridians: Feminism, race, transnationalism, vol. 10, no 2, 2010, p. 15-41.
Beriss, David, Black skins, French voices: Caribbean ethnicity and activism in Urban France, Oxford : Westview, 2004.
Blackman, Lisa, The Body: The Key Concepts, Oxford : Berg, 2008.
Blackman, Lisa, « Bodily integrity », Body & Society, vol. 16, no 3, 2010, p. 1-9.
Blackman, Lisa et Mike Featherstone (dir.), « Special section: The skin ego », Body & Society, vol. 15, no 3, 2009.
Blay, Yaba A., « Skin bleaching and global white supremacy: By way of introduction », The Journal of Pan African Studies, vol. 4, no 4, 2011, p. 4-46.
Blay, Yaba A. et Christopher A.D. Charles (dir.), « Special issue: Skin bleaching and global white supremacy », The Journal of Pan African Studies, vol. 4, no 4, 2011.
Cavanagh, Sheila L., Angela Failler et Rachel Alpha Johnston Hurst (dir.), Skin, culture and psychoanalysis, Londres : Palgrave MacMillan, 2013.
Chaney, Sarah, Psyche on the skin: A history of self-harm, Chicago : Chicago University Press, 2017.
Cheng, Anne Anlin, Second skin: Josephine Baker and the modern surface, New York : Oxford University Press, 2011.
Classen, Constance, The deepest sense: A cultural history of touch, Indiana : University of Illinois Press, 2012.
Classen, Constance (dir.), The Book of Touch, Oxford : Berg, 2005.
Connor, Steven, The Book of Skin, Londres : Reaktion, 2004.
Coulthard, Glen Sean, Red Skin, White Masks: Rejecting the Colonial Politics of Recognition, Minneapolis : University of Minnesota Press, 2014.
Curtin, Maureen F., Out of touch: Skin tropes and identities in Woolf, Ellison, Pynchon, and Acker, New York : Routledge, 2003.
Dabashi, Hamid, Brown skin, white masks, Halifax et Winnipeg : Pluto Press et Fernwood Publishing, 2011.
Diamond, Nicola, Between skins: The body in psychoanalysis, Indianapolis : Wiley, 2014.
Emberley, Julia, « Skin: An assemblage on the wounds of knowledge, the scars of truth, and the limits of power », English Studies in Canada, vol. 34, no 1, 2008, p. 1-8.
Emberley, Julia (dir.), « Special issue: Skin », English Studies in Canada, vol. 34, no 1, 2008.
Fanon, Frantz, Peau noire, masques blancs, Paris : Éditions du Seuil, 1952.
Fanon, Frantz, Black skin, white masks (trad. de Richard Philcox), New York : Grove Press, 2008.
Featherstone, Mike, Body modification, Londres : Sage, 2000.
Fend, Mechtild, Fleshing out surfaces: Skin in French art and medicine 1650-1850, Manchester : Manchester University Press, 2017.
Flanagan, Mary et Austin Booth, Re: Skin, Cambridge, MA : MIT Press, 2006.
Freud, Sigmund, « The ego and the id », dans Strachey (dir.), The standard edition of the complete works of Sigmund Freud, vol. 18, Londres : Vintage and Hogarth Press, 2001.
Freud, Sigmund, Le moi et le ça, Paris : Éditions Payot et Rivages, 2010.
Glenn, Evelyn Nakano, « Yearning for lightness: Transnational circuits in the marketing and consumption of skin lighteners », Gender & Society, vol. 22, no 3, 2008, p. 281-302.
Goldsmith, Meredith, « White skin, white mask: Passing, posing, and performing in the Great Gatsby », Modern Fiction Studies, vol. 49, no 3, 2003, p. 443-468.
Grabham, Emily, « ‘Flagging’ the skin: Corporeal nationalism and the properties of belonging », Body & Society, vol. 15, no 1, 2009, p. 63-82.
Gubar, Susan, Racechanges: White skin, black face in American culture, New York : Oxford University Press, 1997.
Hall, Ronald E., An historical analysis of skin color discrimination in America, New York : Springer, 2010.
Hamilton, Sheryl, « Rituals of intimate legal touch: Regulating the end-of-game handshake », Senses and Society, vol. 12, no 1, 2017, p. 53-68.
Heaton, Matthew H., Black skin, white coats: Nigerian psychiatrists, decolonization, and the globalization of psychiatry, Athens : Ohio University Press, 2013.
Herring, Cedric, Verna Keith et Hayward Derrick Horton, Skin deep: How race and complexion matter in the “color-blind” era, Chicago : University of Illinois Press, 2004.
Howes, David, « Skinscapes: Embodiment, culture and environment », dans Classen (dir.), The Book of Touch, Oxford : Berg, 2005.
Hurst, Rachel Alpha Johnston, Surface imaginations: Cosmetic surgery, photography, and skin, Montréal : McGill-Queens Press, 2015.
Kay, Sarah, « Original skin: Flaying, reading, and thinking in the legend of Saint Bartholomew and Other Works », Journal of Medieval and Early Modern Studies, vol. 36, no 1, 2006, p. 35-74.
Kelland, Kate, « Scientists turn skin cells into beating heart muscle », Reuters, 2012, https://www.reuters.com/article/us-heart-stemcells/scientists-turn-skin-cells-into-beating-heart-muscle-idUSBRE84L1EK20120522 [consulté le 10 février 2018].
Kroker, Arthur (dir.), « Body digest: Fashion, skin and technology », Canadian Journal of Political and Social Theory, vol. 11, no 1 et 2, 1987.
Lafrance, Marc, « Skin and the self: Cultural theory and Anglo-American psychoanalysis », Body & Society, vol. 15, no 3, 2009, p. 3-24.
Laine, Tarja, « “It’s the sense of touch”: Skin in the making of cinematic consciousness », Discourse: Journal for Theoretical Studies in Media & Culture, vol 29, no 1, 2007, p. 35-48.
Lemma, Alessandra, Under the skin: A psychoanalytic study of body modification, Londres : Routledge, 2010.
Leong, Solomon, « Who’s the fairest of them all? Television ads for skin-whitening cosmetics in Hong Kong », Asian Ethnicity, vol. 7, no 2, 2006, p. 167-181.
Lupton, Ellen, Skin: Surface, substance, and design, New York : Princeton Architectural Press, 2002.
MacCormack, Patricia, « The great ephemeral tattooed skin », Body & Society, vol. 12, no 2, 2006, p. 57-82.
Manning, Erin, « What if it didn’t all begin and end with containment? Toward a leaky sense of self », Body & Society, vol. 15, no 3, 2009, p. 33-45.
Marks, Laura U., The skin of the film: Intercultural cinema, embodiment, and the senses, Durham et Londres : Duke University Press, 2000.
Merleau-Ponty, Maurice, Phenomenology of perception (trad. de Colin Smith), Londres : Routledge, 1965.
Merleau-Ponty, Maurice, The visible and the invisible (trad. d’Alphonso Lingis), Evanston : Northwestern University Press, 1968.
Mielants, Eric, « Black skin, white masks revisited: Contemporary post-colonial dilemmas in the Netherlands, France, and Belgium », Human Architecture: Journal of The Sociology of Self-Knowledge, vol. 5, no 3, 2007, p. 297-304.
Mire, Amina, « Skin-bleaching: Poison, beauty, power, and the politics of the colour line », Resources for Feminist Research, vol. 28, no 3-4, 2001, p. 13-38.
Montagu, Ashley, La peau et le toucher : un premier langage, Paris : Éditions du Seuil, 1979.
Montagu, Ashley, Touching: The human significance of skin, New York : Harper & Row, 1986.
Patterson, Maurice et Christopher Schroeder, « Borderlines: Skin, tattoos and consumer culture theory », Marketing Theory, vol. 10, no 3, 2010, p. 253-267.
Pile, Steve, « Topographies of the body-and-mind: Skin ego, body ego, and the film ‘Memento’ », Subjectivity, vol. 27, no 1, 2009, p. 134-154.
Prosser, Jay, Second skins: The body narratives of transsexuality, New York : Columbia, 1998.
Reynolds, Dee, « Response to ‘Skin and the self: Cultural theory and Anglo-American Psychoanalysis’ », Body & Society, vol. 15, no 3, 2009, p. 25-35.
Rondilla, Joanne L. et Paul R. Spickard, Is lighter better?: Skin-tone discrimination among Asian Americans, Lanham : Rowman & Littlefield Publishers, 2007.
Schneider, Ana-Karina, « Skin as a trope of liminality in Anne Enright’s The Gathering », Contemporary Women’s Writing, vol. 8, no 2, 2014, p. 206-222.
Segal, Naomi, Consensuality: Didier Anzieu, gender and the sense of touch, Amsterdam : Rodopi, 2009.
Shilling, Chris, The body and social theory, Londres : Sage, 2013.
Solon, Olivia, « The ethics and aesthetics of using living tissue as a medium », Wired, 2011, https://www.wired.com/2011/07/bioart/ [consulté le 10 février 2018].
Tate, Shirley Anne, Black skins, black masks: Hybridity, dialogism, performativity, Aldershot : Ashgate, 2005.
Tate, Shirley Anne, Skin bleaching in black Atlantic zones: Shade shifters, Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2015.
Turner, Bryan, The body and society, Londres : Sage, 2008.
Ulnik, Jorge, Skin in psychoanalysis, Londres : Karnac, 2007.
Vanderbeke, Dirk et Caroline Rosenthal (dir.), Probing the skin: Cultural representations of our contact zone, Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, 2015.
Vergès, Françoise, Creole skin, black mask: Fanon and disavowal, Chicago : University of Chicago Press, 1997.
Walter, Katie L. (dir.), Reading skin in medieval literature and culture, New York : Palgrave MacMillan, 2013.
Williams, Linda Faye, The constraint of race: Legacies of white skin privilege in America, University Park : Pennsylvania State University Press, 2003.
Yang, Mina, « Yellow skin, white masks », Daedalus, vol. 142, no 4, 2013, p. 24-37.
[1] ↑ Je tiens à remercier le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) pour la bourse accordée au projet « Law and the Regulation of the Senses » (435-2015-1416), dont une partie a servi à financer mes travaux. De plus, je voudrais exprimer ma reconnaissance à Mark Doerksen, Homa Hoodfar, David Howes, Shelley Reuter et Zara Saeidzadeh pour leur soutien indispensable pendant le processus de rédaction.
[2] ↑ Classen (2011) utilise une formule semblable lorsqu’elle décrit le toucher comme le « plus profond » des sens.
[3] ↑. En 1987, la revue Canadian Political and Social Theory a fait paraître un numéro spécial intitulé « Fashion, Skin and Technology ». Le numéro n’a pas été inclus dans l’aperçu parce qu’il ne traite pas de la peau comme d’un sujet à part entière.
[4] ↑ L’appel à propositions complet est accessible à l’adresse suivante : http://www.iaa.uni-jena.de/iaamedia/Amerikanistik/Probing_the_Skin.pdf
[5] ↑. L’appel à propositions complet est accessible à l’adresse suivante : https://societyhumanities.as.cornell.edu/2016-17-skin
[6] ↑. Il existe un énorme corpus de travaux sur les liens entre la discrimination fondée sur la couleur de la peau, d’une part, et l’estime de soi, la stratification sociale, le niveau de compétence professionnelle, le potentiel de gains, les taux de criminalité et les stéréotypes raciaux, d’autre part. Ces travaux n’ont pas été abordés ici parce qu’ils n’adoptent pas une perspective critique sur la peau. Cela dit, pour ceux qui s’intéressent aux liens entre la justice sociale et la couleur de la peau, cet ensemble de travaux mérite qu’on s’y attarde. Voir Hall (2010), Herring, Keith et Horton (2004), Rondilla et Spickard (2007) et Williams (2003) pour des exemples représentatifs.
[7] ↑. L’ouvrage d’Ulnik intitulé Skin in Psychoanalysis (2008) est paru pendant la même période, mais je n’en parle pas ici, car il n’établit aucun lien avec les travaux critiques contemporains sur la subjectivité, la corporéité et la société.
[8] ↑. Les contributions de Segal aux études de la peau vont bien au-delà de son ouvrage sur Anzieu. Segal a en effet retraduit en anglais l’œuvre phare d’Anzieu, Le moi-peau. The Skin-Ego est paru en 2016.
[9] ↑. Pour une autre réflexion sur la démangeaison et le grattage, voir Connor (2004 : 227-257).