Le corps peint
Michel Thévoz
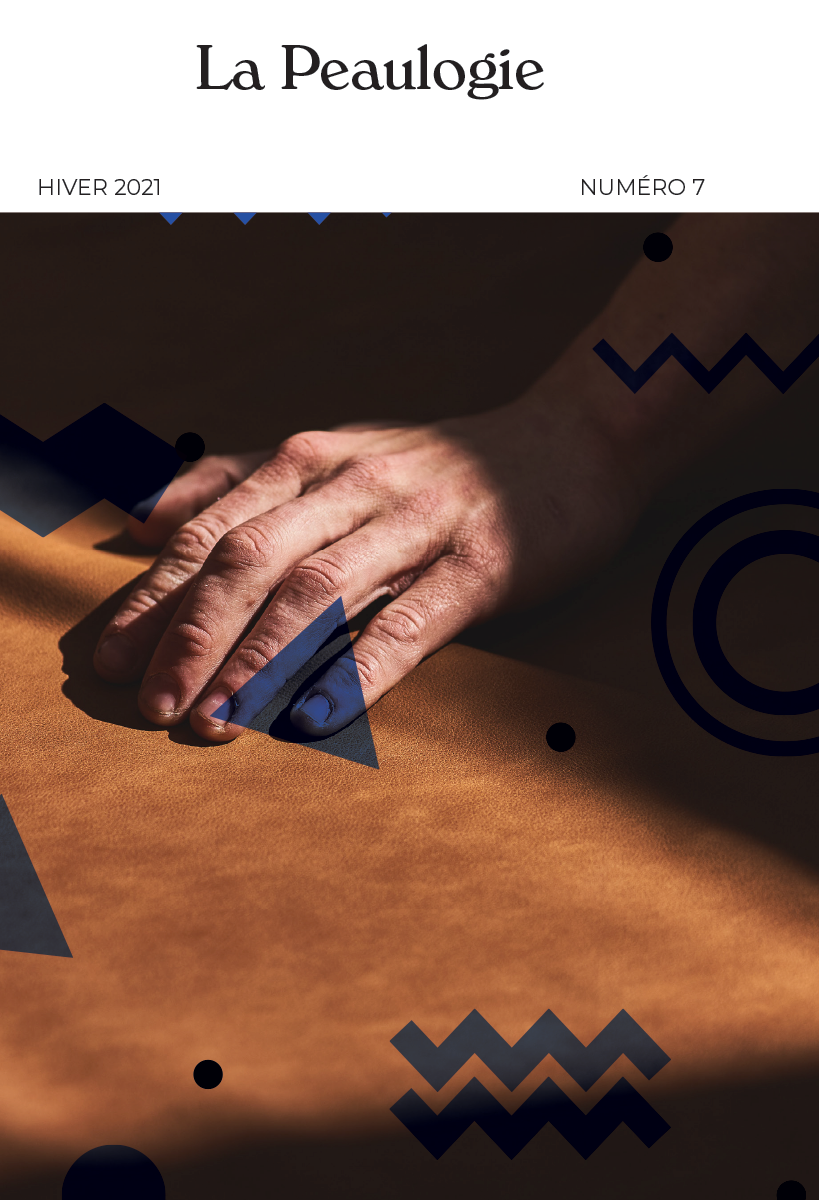

Le corps peint
Michel Thévoz
Thévoz M., (1984), Le corps peint, Genève : Skira, 138 p., ISBN : 978-2605000302
Compte rendu de Christine Bergé
Référence électronique
Bergé C., (2021), « Le corps peint », La Peaulogie 7, mis en ligne le 17 décembre 2021 [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/corps-peint
Le corps peint est un parcours multi‑cultures, des temps préhistoriques jusqu‘à nos jours, interrogeant l‘inventivité humaine lorsqu‘elle prend comme support expressif son propre corps, en l‘occurrence, la surface de la peau (épiderme, derme). Même si le discours tenu dans l‘ouvrage semble parfois désuet, à bientôt quarante ans de distance, et un peu brouillon, il témoigne d‘une approche exhaustive riche en exemples et documents visuels sur ce qu‘on peut appeller l‘auto‑plastique humaine.
Dans le monde animal, les pouvoirs de mimétisme et de métamorphose nous fascinent. Ici, au début du livre, nous voyons se déployer les arts transformatifs de l‘humain. Le lien corps anatomique / corps symbolique s‘inaugure tout d‘abord par la vénération de la fécondité dans les cultures préhistoriques. Les sculptures de corps féminins porteurs de la vie exhaussent l‘analogie formelle entre phallus, corne de taureau, croissant de lune et ventre arrondi. Michel Thévoz consacre ensuite une partie de l’ouvrage aux cultures qu’il appelle tantôt « sauvages » tantôt « primitives », et plus tard « ancestrales ». Il les aborde sous l’angle de l’incarnation et de la métamorphose, puis interroge longuement leur aptitude à lutter contre la “désintégration pulsionnelle” grâce à la médiation de conduites rituelles d’enveloppements : les peintures corporelles et faciales permettraient d’unifier (lier) dans une continuité souple les forces de dissociation du Moi. Pour l’auteur, le jeu rituel entre dissociation et unification permettant la constitution de l’humain, s’opère par une mise à distance plastique des éléments de la nature (dont les «motifs» sont peints sur la peau). La richesse des formes symbolisées ainsi que des couleurs peintes ouvre un espace d’altérité / identification (p. 28).
L’ordre des mythes, joué sur la scène (projective) des rituels lors des initiations, est ensuite à la fois marqué dans la chair et peint sur la peau. Ces cultures (Nouvelle‑Guinée, Congo) cherchent à incorporer la structure des liens symboliques par le « marquage (qui) donne accès à la visibilité sociale (en) s’ordonnant figurativement sur la face visible de la peau » (p. 30). L’exemple des caractères zoomorphes illustre pour M. Thévoz les aptitudes de « migration mentale » de ces cultures, le jeu entre humanité et animalité demeurant le pivot des identifications, capable de proposer un langage pour « formuler les conflits latents » (p. 33). Les peintures et quasi‑sculptures sur et dans la peau (peintures corporelles, tatouages, scarifications) élaborent non seulement les liens de l’individuel au collectif, mais également les « rapports de contiguité avec les puissances mythiques » (p. 34). On comprend que la dimension essentielle qui s’opère par médiation cutanée, est celle du devenir‑soi / devenir‑autre, qui au cours de ces rituels demeure ouverte.
La formule indélébile de la scarification frappe alors (comme pour une monnaie d’échange) l’appartenance sociale dans la peau jusque dans la chair, au cours d’un cérémoniel tenu par des « spécialistes ». Le rituel accomplit une forme « d’acculturation à vif » (p. 45) à l’issue duquel un nouveau nom est attribué à celui ou celle qui a enduré avec courage les souffrances du marquage. Les matières employées (l’ocre fertile, l’argile blanche purificatrice) appellent les puissances naturelles à s’incarner dans la chair. Les motifs dialoguent entre eux et font partie d’un vaste système symbolique (p. 58). L’espace des traitements corporels initiatiques impliquant le travail des peaux humaines vivantes (tatouées, scarifiées, percées, déchirées) s’ouvre alors sur une aire géographique étendue, jusqu’aux Indiens Cheyennes du Dakota.
Michel Thévoz élargit cette extension à d’autres territoires, en prenant un curieux appui iconographique (européen) sur le Sciathericon d‘Athanasius Kircher (1646) : l‘Ars Magna Lucis et Umbrae propose en effet la lecture visuelle et synthétique des correspondances qui relient intimement les puissances cosmiques, les éléments de la nature et le corps humain (p. 60).
Après avoir exploré ces deux domaines (« corps préhistorique », « corps sauvage »), le titre suivant aborde le « stade du miroir ». M. Thévoz tente des repérages historiques, pour déchiffrer une éventuelle évolution à partir de temps et lieux où le marquage symbolique concerne non plus tout le groupe social, mais quelques groupes sociaux plus ou moins marginalisés. Le sens du titre donné à cette partie ne semble cependant pas adéquat à l’ensemble du propos. Les danseuses et chanteuses de l’ancienne Egypte côtoient ici les prisonniers perses marqués par Darius, les esclaves et délinquants romains marqués au front, ces blessures au fer rouge indiquant l’appartenance aux souverains victorieux.
La question du rapport tyrannie/démocratie se donne à lire dans ce moment du parcours où M. Thévoz en vient à interroger « l’intégrité du corps grec » comme préfigurant l’idée chrétienne : tout marquage de la peau est flétrissure faite à l’image de la beauté céleste (p. 65). La production de cette lecture évolutive de l’histoire marque une faiblesse de l’ouvrage qui, dans son effort d’extension, donne une interprétation fatalement biaisée. Ainsi s’ouvre alors une quasi‑hiérarchie entre les cultures archaïques (Maghreb, Yemen) pré‑islamiques, dont les tatouages « magiques » président aux étapes cruciales de la vie, et celles des monothéismes qui interdisent les signes gravés sur la peau.
L’approche des cosmétiques tente ensuite de faire dialoguer les éléments d’une nouvelle problématique : les rapports nature / culture. Le maquillage est‑il un supplément d’être pour une nature ontologiquement défectueuse ? Que veut‑on faire apparaître / disparaître ? Faut‑il que la peau mime la nature ? Faut‑il qu’elle soit un leurre (un artifice) ? On comprend que la quête de nouvelles identifications est à l’oeuvre avec l’expansion du christianisme. Dans les sociétés occidentales, pense M. Thévoz, la marque corporelle fait désormais l’objet d’un refoulement (p. 78). Rien d’étonnant alors, si avec ce divorce des formes (extérieures, intérieures), l’avancée des transgressions (groupales, individuelles) se manifeste par une recherche de nouvelles marques. Les exclus cachent / montrent avec provocation les signes mêmes (volontairement choisis) qui illustrent leur exclusion (malfaiteurs, prisonniers, prostituées, marins au long cours). Le tatouage rebelle, comme « estampille de l’a‑sociabilité », vaut pour signe de reconnaissance locale et crée des « empathies épidermiques » (p. 82). Les usages et palettes iconographiques, version « populaire », récupèrent les motifs les plus classiques (jusqu’aux éléments floraux, dragons et samouraïs des estampes japonaises traditionnelles, ukiyo‑é).
Doit‑on comprendre ici que la peau faite peinture, peau imprimée, traduit comme un miroir l‘identité intérieure blessée des couches inférieures de la société ? Ou au contraire, la reprise de motifs à la couche sociale supérieure (comme une prise de guerre) est‑elle le miroir d‘une conquête en cours ? La projection de l’image épidermique peut‑elle agir d’une façon magique (revisitée) sur l’identité de l’homme peint ? Ou bien la projection de signes apotropaÏques sur l’espace social protège‑t‑il l’intimité des individus blessés ? Nous ne trouverons guère réponse à ces questions. Si, comme M. Thévoz le souligne, « la peinture corporelle a régressé avec la civilisation et le processus d’étatisation » (p. 85), où inscrire ces groupes marginalisés, dans quelle marge de civilisation ?
Ce ne sont pas de simples survivances, les pratiques démarquent, dénotent, pourrait‑on dire au contraire. Doit‑on comprendre ces pratiques comme des tentatives de rites privés, produits sur une scène excentrée, mais cependant efficace comme une écriture mémorielle et identifiante ? M. Thévoz suit la piste de ces motifs tatoués, en glissant maintenant le propos vers les jeux sur les « caractères » : le théâtre (japonais), scène où « le fard affiche son artifice », puis l’opéra chinois, qui produit autant de visages peints qu’il y a de personnages (codés) (p. 91). Mais on a changé d’univers. Le « décodage du drame dans la graphie du visage », pour le théâtre Kabuki, peut‑il participer de l’ « espace sacré » où les spectateurs seraient invités dans une dimension transhistorique devenue le miroir des dieux ? Devant ces visages peints, le lecteur demeure perplexe car ici, où situer le « stade du miroir » dans son acception psychanalytique ? Le chapitre se clôt sur un parallèle avec le cirque et ses clowns, qui permet que « l’enfant se délivre de sa propre ambivalence » (p. 94).
Le dernier chapitre, La résurrection de la chair, explore les avancées de la peinture moderne occidentale, au‑delà du motif, au‑delà du représentatif : lors du travail de création (le corps peint sur la toile), qu‘en est‑il du rapport du peintre avec le tégument, la matérialité de la toile ? L‘invention artistique s‘est portée vers l‘attention au grain, à la couche pigmentaire, la trace, le toucher, la touche (et non plus vers l‘exactitude du “représenté” par la touche de pinceau). Le contact avec le support fait médiation vers l‘épiderme du peintre, ou celui de l‘être représenté. La toile comme support en vient à être assimilée à une surface corporelle (p. 101). Les peintres tentent de faire apparaître le corps, ou de s’en approcher (et tendent à éliminer la toile ?). Un érotisme latent, ou manifeste parfois, guide le pinceau, ou (avec Gustave Moreau au XIXème siècle), il conduit la plume enduite d’encre de Chine, qui graphie des motifs étrusques sur le corps nu de Salomé. Désormais, la peau va s’insinuer de plus en plus entre le peintre et la toile qui s’orne de reliefs incrustés appelant le contact (pigmentation, grains et apports qui « vivifient le support »). La toile n’est plus plane, elle devient tactile, objet à toucher. Le tableau inscrit sa propre genèse dans le matériau. Le nu, en particulier le nu féminin, devient le lieu d’une quête des empreintes, jusqu’à le devenir concrètement avec Yves Klein et ses « pinceaux vivants » qui ne sont plus des modèles féminins mais des opératrices de traces (leur corps imprime directement le papier ou la toile).
Empreintes, impressions directes, le corps s’approche de plus en plus de la toile pour y entrer en force. La ritualisation entre en scène elle aussi : Klein évoque le « geste bleu » pour rejoindre métaphoriquement celui qui inscrit les traces des grottes de Lascaux ou Altamira. Est‑ce, demande M. Thévoz, « la recherche d’une sacralité perdue ? » (p. 111). L’occident s’égare‑t‑il dans une « parodie de rite ? ». La thématique ensuite introduite par M. Thévoz, celle de « l’artiste en mal de transcendance », rend ironique le titre de ce chapitre. Car est‑ce une résurrection de la chair, ou son massacre ? Les pratiques du Body Art ont, d‘après l‘auteur, imprimé à l‘art une direction impitoyable : les pratiques “iconoclastes” (celles d’Arnulf Rainer, début XXème) conduisent à des profanations plus profondes, en matière d’épiderme. C’est l’ère où l’artiste cherche les rapprochements dangereux, car il veut « opérer à vif une jonction entre la peau corporelle et la pellicule photographique », ou profaner sur une scène douteuse les fonctions vitales, brûler et taillader sa peau assez profondément comme Gina Pane, qui fait couler son propre sang sur l’image de son visage qu’elle peint sur un miroir couché (p. 119). Les mutilations transgressives de Hermann Nitsch interrogent la « panoplie des perversions » : elles nous répugnent, écrit M. Thévoz. Serait‑ce parce qu’elles « témoignent de la persistance monstreuse d’un stade infantile » ? (p. 121). Est‑ce un écho lointain et déformé des transgressions opérées par les cultures « ancestrales » ?
Le nouveau principe qui, semble‑t‑il, s’avance est celui de la « flottaison des signes » (p. 125). Peut‑il illustrer « l’art de la fin de l’art » (p. 126), une peinture de nouveaux sauvages ? L’extension du domaine suivant est celui du No future des Sex Pistols, celui des mutants cyniques, critiques désabusés d‘une « société du soft‑goulag » qui deviendra notre avenir (p. 128).