L’écriture du dieu
J. L. Borges
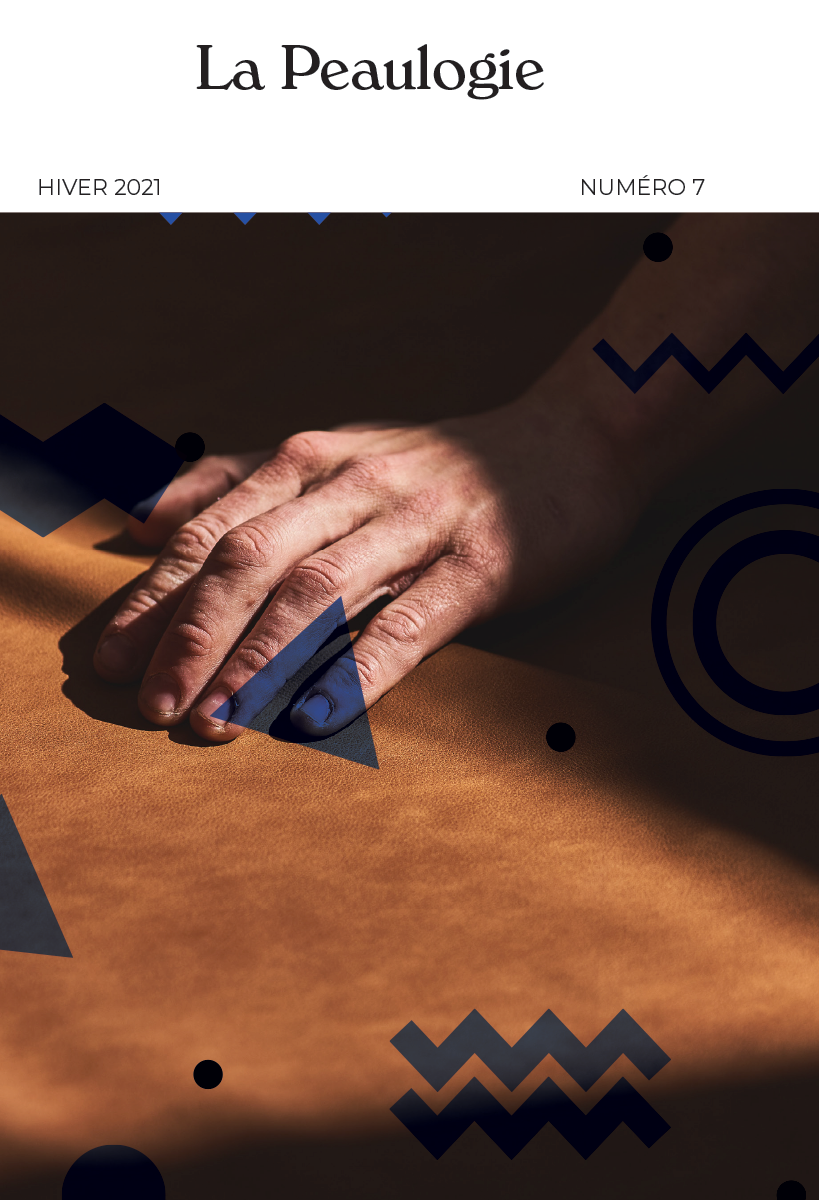

L’écriture du dieu
J. L. Borges
J. L. Borges., (1967), « L’écriture du dieu » in : L’aleph, Paris : Gallimard, 1967, 145‑152.
Compte rendu de Christine Bergé
Référence électronique
Bergé C., (2021), « Déchiffrer la fourrure du jaguar », La Peaulogie 7, mis en ligne le 17 décembre 2021 [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/dechiffrer-fourrure-jaguar
Borges fut hanté par les fauves, surtout ceux dont le pelage arbore d’énigmatiques figures. Lui qui aimait tant les livres, les bibliothèques et les labyrinthes, vécut sous l’emprise des symboles vivants, enserrés parmi les poils des félins comme des peintures sacrées, insaisissables.
Déjà dans Le Zahir il est question de déchiffrage et de fauve[1]. « Zahir, en arabe, veut dire notoire, visible : dans ce sens, c’est l’un des quatre‑vingt‑dix‑neuf noms de Dieu ; en pays musulman, les gens désignent par ce mot ‘les êtres ou les choses qui ont la terrible vertu de ne pouvoir être oubliés et dont l’image finit par rendre les gens fous’ » (p. 140). Parmi ces êtres, le tigre est placé en haut du podium. Ainsi pour signifier folie ou sainteté, on dit avoir vu le tigre… Celui qui entreprit de dessiner ce qu’il avait vu, créa un dessin‑monde «traversé et rayé de tigres», une sorte de folle mappemonde dont il resterait encore quelques vestiges un peu effrayants.
Cette histoire de fou et de déchiffrage des fourrures de fauves est intimement liée à Borges, puisqu’il pressent dans cette nouvelle un élément de son propre destin, qu’il partage avec le héros de L’écriture du dieu : « On devra me donner ma nourriture et m’habiller, je ne saurai s’il est tôt ou tard, je ne saurai qui a été Borges » (p. 143).
Déchiffrer la fourrure du jaguar est annoncé dans Le Zahir comme un destin funeste mais rédempteur. L’Ecriture du Dieu, traduite par Roger Caillois, est une nouvelle dramatique[1]. J’ai cherché à en connaître la part de réel et celle de la fiction. On sait que Borges documentait ses fictions, dont les fragments à caractère historique sont enchâssés dans des constructions oniriques. Il écrit dans Le Zahir, « Selon la doctrine idéaliste, les verbes vivre et rêver sont rigoureusement synonymes » (p. 143). Pour Borges, le sens est toujours labile, le monde est friable, ce n’est pas pour rien que les fourrures félines sont lieu de déchiffrages, car elles dessinent des frontières vouées à attiser le désir de voir, tout en brouillant les pistes.
J’ai relu cette nouvelle pendant la période de notre premier confinement, elle était, pour ainsi dire, d’actualité. Cette lecture me fît entrer dans une dimension mythologique, alors que notre monde assourdi par le confinement perdait une part de son sens…
Celui qui raconte est Tzinacán, « mage de la pyramide de Qaholom, qui fut incendiée par Pedro de Alvarado » (p. 145). Borges ne le dit pas, mais cet affreux individu a bel et bien existé. Conquistador espagnol, mort en 1541, il s’est distingué par sa cruauté lors de la conquête de l’empire aztèque, sous les ordres de Cortes. Baptisé Tonatiuh (Soleil) par les indigènes à cause de sa chevelure flamboyante, voilà un sombre soleil en vérité, qui massacra une assemblée de six cent notables aztèques et déclencha les révoltes. Dès les premières lignes de la nouvelle on apprend qu’il a jeté Tzinacán dans une profonde prison de pierre en forme de demi‑sphère coupée d’un mur en son milieu. D’un côté, le mage. De l’autre côté, dans la cellule adjacente, un jaguar ui aussi emprisonné. Le dispositif convient ici à l’esprit systématique des Aztèques.
À ce dispositif répondent les essences divines des deux protagonistes. Comme signification du nom du mage, j’ai trouvé que tzinacán signifie «chauve‑souris» en nahuatl : il naît de la semence et du sang répandus par Quetzalcoatl lorsque celui‑ci accomplit un de ses auto‑sacrifices par lesquels il recrée le monde. Quant au jaguar, il est géomètre : « il mesure à pas égaux et invisibles le temps et l’espace de sa cellule » (p. 145). Entre les deux, le mur central est percé d’une ouverture grillagée qui ne s’ouvre qu’à midi, heure où l’on descend les cruches d’eau et les morceaux de viande. « La lumière pénètre alors dans l’oubliette ; c’est le moment où je peux voir le jaguar » (p.145).
Jeune prêtre sacrificateur, Tzinacán fut sur ordre d’Alvarado « tourmenté par les métaux ardents » la veille de l’incendie de la pyramide. Il ne révéla pas la cache secrète de l’or aztèque. Maintenant c’est un vieil homme. Depuis de longues années, la vision intermittente du fauve réveille sans cesse dans sa mémoire le travail sacré qu’il peut accomplir. En effet, la tradition raconte que le premier jour de la création, le dieu entrevit la fin des temps et les malheurs qui ruineraient le monde ; aussi écrivit‑t‑il « une sentence magique capable de conjurer tous les maux » (p. 147). Il ne manqua pas de l’écrire sur un support inaltérable, qui traverserait l’histoire.
Parvenu à cette fin des temps, le mage plongé dans les ténèbres se souvient que « le jaguar est un des attributs du dieu » (p. 148). Nous savons que les divinités aztèques n’ont rien de désincarné. La production des hommes, celle du monde et celle des dieux jaillit d’un même élan. Le dieu vit dans la peau même de ses créatures : leur sacrifice rituel permet sa régénérescence. Tzinacán finit par entrevoir comment le dieu a confié « son message à la peau vivante des jaguars qui s’accoupleraient et s’engendreraient sans fin dans les cavernes, dans les plantations, dans les îles, afin que les derniers hommes le reçoivent » (p. 148).
La tâche sacrée des jaguars est aussi leur destin : conserver dans leur pelage le divin dessin qui reste à déchiffrer. Les peuples précolombiens affectionnent ce motif d’une fourrure de fauve «inscrite» par la main divine, tapissée de signes. La forme condensée des glyphes aztèques et mayas semble évoquer la trace d’une patte de félin appuyée sur le sol. Quant aux constellations peintes dans le pelage des jaguars, somptueuses empreintes, elles rappellent aux précolombiens des sceaux d’étoiles sertis dans un ciel nocturne, ou des ocelles au double regard (voir/être vu). Par ces figures, la peau des jaguars demeure liée aux écritures et aux arts de la divination.
Borges y ajoute sa touche personnelle, la passion du déchiffrage d’un alphabet secret. À propos de L’Ecriture du dieu, il note : « le jaguar m’a obligé à mettre dans la bouche d’un “magicien de la pyramide de Qaholon” des arguments de cabaliste ou de théologien » (p. 214). Le mage raconte comment pendant de longues années, lors la brève éclaircie de midi, il apprit « l’ordre et la disposition des taches », désespérant parfois, reprenant son labeur ; et comment il captura dans sa mémoire « les formes noires qui marquaient le pelage jaune. Quelques‑unes figuraient des points, d’autres figuraient des raies transversales sur la face intérieure des pattes ; d’autres, annulaires, se répétaient. Peut‑être était‑ce un même son ou un même mot. Beaucoup avaient des bords rouges » (p. 148).
La fourrure du jaguar ne se contente pas d’enserrer dans ses linéaments l’énigme qui excite douloureusement le mage. L’écriture du pelage n’est pas n’importe quel texte inscrit une fois pour toutes. Le message renaît sans cesse, au gré des mouvements du fauve. Cette richesse de configurations, pour tout guerrier aztèque (l’ocelotl en nahuatl), représentait la puissance du chasseur, l’intelligence à la fois rusée, combinatoire, méthodique et fluide. On écorchait les jaguars pour en porter la fourrure lors de rituels destinés à guider l’incarnation du chasseur suprême vers le corps du futur combattant. Pour le mage, dans le labyrinthe des signes s’inscrit l’univers entier, en commençant par le processus même qui engendra le félin, avec les cerfs et les tortues qu’il dévora, et la terre qui permit aux tortues de se nourrir, et le ciel qui engendra la terre… Tout cet enchaînement doit dans le message secret lové dans les poils, regrouper l’infini des temps en une forme instantanée, bougeant à même la peau féline et les déplacements furtifs. « Un dieu, pensai‑je, ne doit dire qu’un seul mot et qui renferme la plénitude » (p. 149).
Le mot en lui‑même est bien‑entendu imprononçable. Il n’est pressenti que lors d’une union mystique avec la divinité. La boucle que forme l’ocelle dessinée à l’infini dans la fourrure a pour écho celle du bouclier de guerre. La prison de pierre, par sa forme, rappelle ce bouclier devenu immobile, terrassé par la colonisation étrangère. Le peuple de guerriers a été anéanti par plus « guerrier » que lui. Mais si l’on déploie tout ce qui, dans la nouvelle de Borges, demeure condensé comme dans une énigme, justement, on comprend le lien fondamental entre la guerre, l’écriture, le destin et la fourrure du jaguar.
À force de chercher dans la fourrure ondoyante, à travers les figures mouvantes, le regard de Tzinacán se brouille salutairement. Il finit par avoir son extase, sous la forme d’une vision : une Roue d’eau et de feu, infinie, « constituée de toutes les choses qui seront, qui sont et qui furent » (p. 151). Elle enserre toutes les causes et tous les effets, les « desseins intimes de l’univers ». Il est donné au mage de voir « le dieu sans visage qui est derrière les dieux » (p. 151). La Roue forme un tissage de toutes les choses de l’univers, dans lequel Tzinacán et Alvarado sont des fils de trame parmi tant d’autres. Le tissage des destins peut se déchiffrer par l’entremise d’une vision supérieure dont la peau du jaguar, lieux des divines écritures, recèle l’émergence possible. Dans le Codex Borgia, la main d’un initié a peint le dieu‑jaguar Tezcatlipoca, le plus craint des dieux mexica : le jaguar est son double animal (nahual), il préside aux guerres, il fait et défait les royaumes, il règne sur le temps et la mémoire. Son corps est noir comme la nuit, mais sur le visage il porte des rayures jaunes.
Il faut dire quelque chose des rayures, comme celles des peaux de tigres, comme les raies transversales que Tzinacán voit sur la face intérieure des pattes du jaguar. La rayure est, dans le monde aztèque, à la fois blessure et sillon : par le sang versé elle féconde, et comme sillon elle est la terre griffée par le soc de la charrue pour recevoir le grain à germer. L’attribut de Tezcatlipoca (dont le nom signifie Miroir Fumant) est le miroir d’obsidienne dans lequel il regarde le futur. L’un de ses trois frères, Xipe Totec (dit le Seigneur des écorchés), vénéré à Téotihuacan, donne rituellement sa peau pour la renaissance de la terre et de la végétation. Son corps est rouge, vêtu d’une peau humaine fraîchement arrachée, son visage est rayé de jaune, sa chevelure tressée s’orne d’une haute coiffe, et son habit comme son harnachement est celui d’un guerrier. Il s’assied parfois sur un siège tapissé d’une peau de panthère (Vié‑Wohrer, 1999 ; 2008 ; Bergé, 2016).
La chevelure dorée de l’Alvarado‑Soleil qui déchire les chairs s’invite jusque dans la mythologie aztèque. Car Xipe Totec, frère du dieu‑jaguar, est aussi le patron des orfèvres : le feu et la fonte de l’or évoquent la coulée de sang, ils s’inscrivent dans l’ensemble rituel des fêtes destinées aux divinités agraires, au cours desquelles on sacrifiait des hommes dont on écorchait la peau, après avoir offert au soleil leur coeur et leur sang.
A sa façon, Tzinacán fait partie de cet ensemble. Car par son nom (« chauve‑souris » en nahuatl), et sa naissance (issu de la semence et du sang de Quetzalcoatl, le « serpent à plumes »), il est lié à ce dieu, l’un des trois frères de Tezcatlipoca. Ceux‑ci forment un système symbolique bien serré dans lequel le tzinacán se déchiffre aussi sous les traits de Xolotl, dieu (entre autres) du passage dans le monde des morts : il accompagne les âmes des défunts, mais aussi le soleil dans sa course nocturne. Geronimo de Mendieta, dans son Historia eclesiástica indiana raconte que Xolotl part dans le monde des morts pour rapporter les ossements qui permettront de régénérer l’humanité. Il est lui‑même sacrificateur, il immole les dieux pour engendrer le cinquième soleil[3]. Quant au quatrième frère, Huitzilipochtli, il est dieu de la guerre et du soleil. Son nom en nahuatl signifie le « guerrier ressuscité », il a besoin de sang frais, donc de sacrifices humains.
En contemplant la Roue d’eau et de feu née des ocelles du jaguar, Tzinacán parvient à comprendre l’écriture du tigre » (p. 151). Borges évoque ce félin dans une nouvelle précédente du même recueil, intitulée Deutsches Requiem (p. 105‑115) où il est aussi question de guerre. L’écrivain parle d’un poème dont le titre est Tse yang, peintre de tigres. Un poème « qui est comme rayé de tigres, comme chargé et traversé de tigres transversaux et silencieux (p. 110). Dans la nouvelle Le zahir, un inconnu a peint le pelage du tigre sur les murs d’un palais de Mysore, et dans cette même région de l’Inde, un fakir musulman jeté dans une prison à Nittur, a peint sur le sol, les murs et le plafond de sa cellule « une espèce de tigre infini (lui‑même) traversé, rayé de tigres, qui contenait des mers et des Himalayas et des armées qui ressemblaient à des tigres » (p. 141). Le pelage du tigre revient comme une obsession.
Mais il traduit une autre obsession : celle du tragique de l’histoire et des destinées humaines. Dans la fourrure du jaguar, Tzinacán déchiffre d’un seul coup « une formule de quatorze mots fortuits (ou qui semblent fortuits) » (p. 151). Le jaguar promène silencieusement sa fourrure, avec la formule magique sans pouvoir la lire. Grâce à la fenêtre qui s’ouvre entre eux à l’heure du soleil zénithal, il est question du passage du silence à l’oral. Car, encore faudrait‑il énoncer cette suite de quatorze mots « pour devenir tout‑puissant », « pour que le tigre déchire Alvarado, pour que le couteau sacré s’enfonce dans les poitrines espagnoles, pour reconstruire la pyramide, pour reconstituer l’empire » (p. 152). Mais il s’agit maintenant d’un peuple sans voix. La peau du fauve en fait un passeur secret, parce que le mage ne lira pas à haute voix le chiffre de l’histoire : ce qu’il vient de comprendre est lisible dans un monde où la magie n’a plus de sens. Le félin a fait traverser le mage au‑delà d’une frontière où la mémoire personnelle n’est plus nécessaire : « Qui a entrevu l’univers, qui a entrevu les desseins de l’univers ne peut plus penser à un homme, à ses banales félicités ou à ses bonheurs médiocres, même si c’est lui cet homme » (p. 152).
On imagine alors le fauve poursuivant sa marche silencieuse dans sa cellule, dans sa fourrure de porte‑signes. Quant à Tzinacán, il se tait pour toujours : « Je laisse les jours m’oublier, étendu dans l’obscurité » (p. 152).
Bergé C., (2016), L’écorchement. Limite et trangression, Dijon : Le Murmure, 17‑22.
Mendieta G., (1997), Historia eclesiástica indiana, Mexico : Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Pecci A., (2007), Le monde des Aztèques dans le Codex de Florence, Lyon : Mandragora.
Vié‑Wohrer A.‑M., (2008), « Hypothèses sur l’origine et la diffusion du complexe rituel du Tlacaxipehualit‑zli », Journal de la Société des Américanistes (en ligne). https://journals.openedition.org/jsa/10602
Vié‑Wohrer A.‑M., (1999), Xipe Totec, notre seigneur l’Écorché. Étude glyphique d’un dieu aztèque, Mexico, 2 volumes.