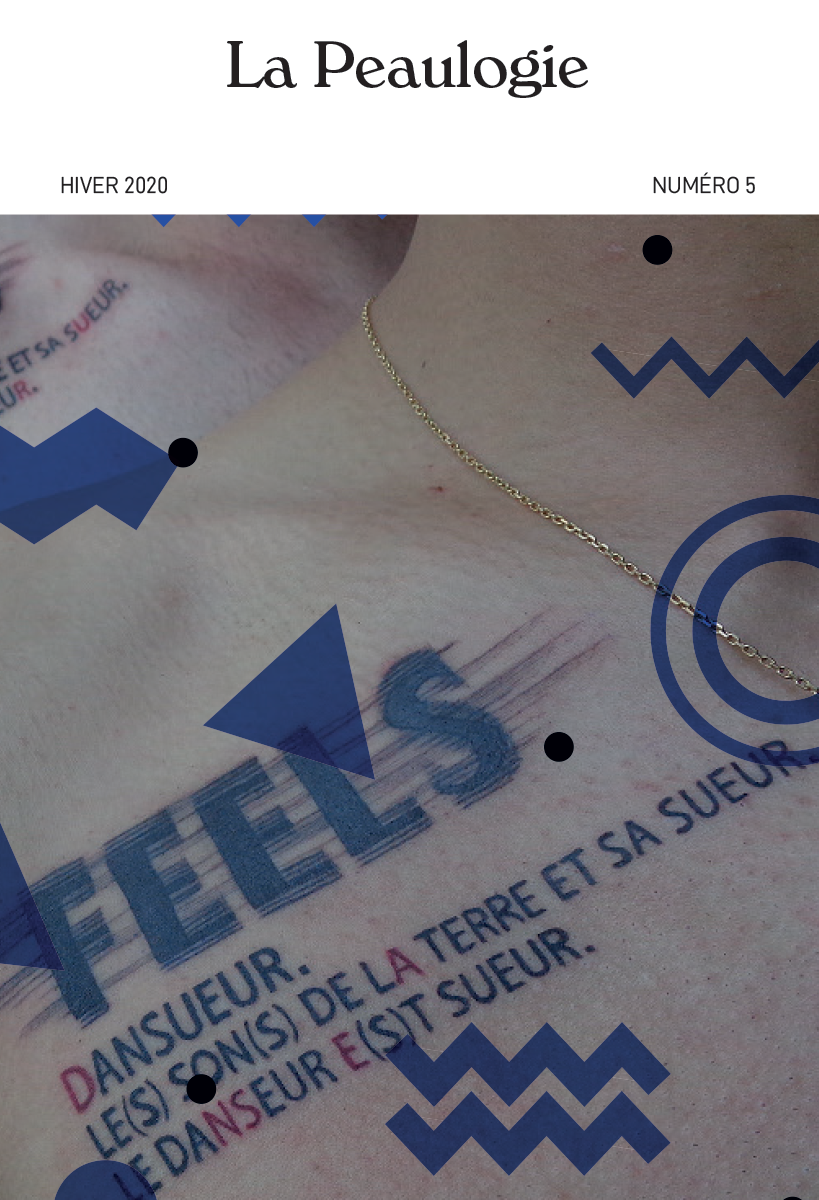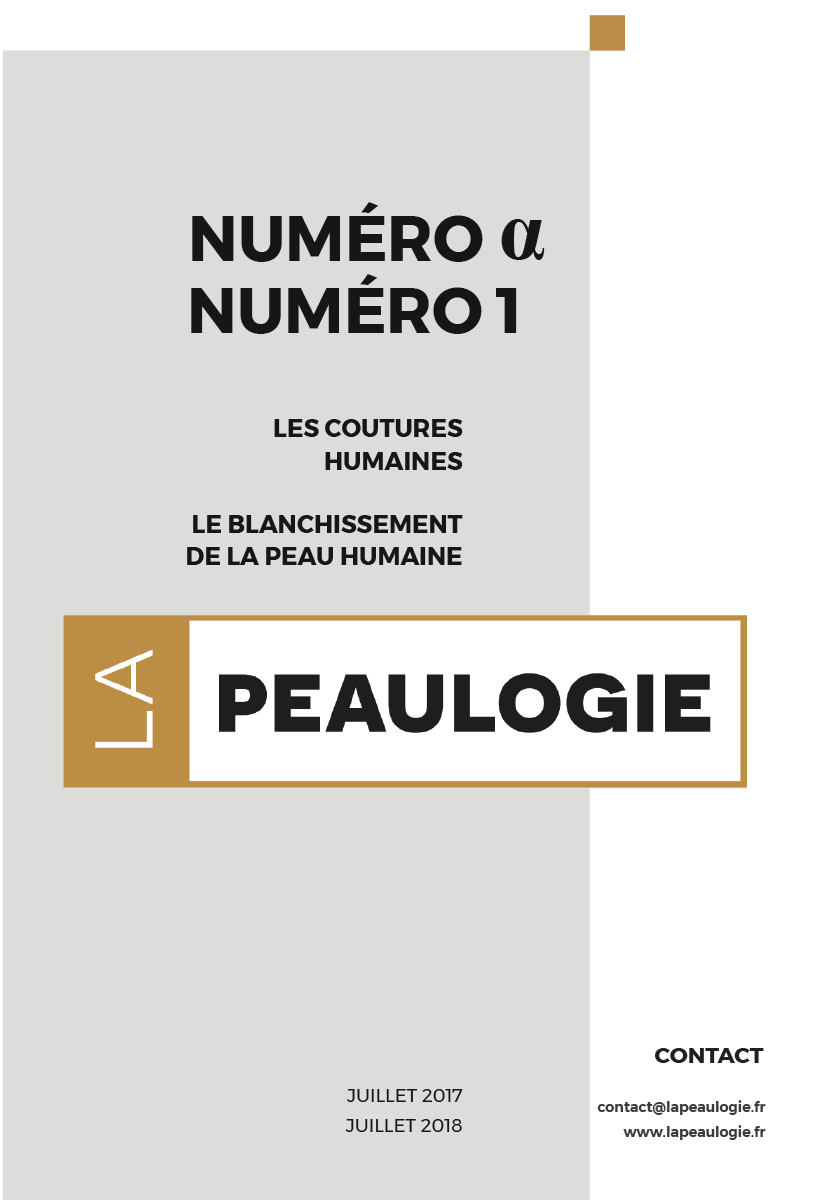Référence électronique
Lechevalier-Bekadar N., (2020), « Her other Bodies: a Travelogue de Brian Evenson. Rituels d’une écriture au scalpel. », La Peaulogie 4, mis en ligne le 5 mai 2020, [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/her-other-bodies-a-travelogue

Her other Bodies: a Travelogue de Brian Evenson. Rituels d’une écriture au scalpel.
-
Description
Nawelle LECHEVALIER-BEKADAR
PRAG, laboratoire ACE (Anglophonie : Communautés, Écritures) Université Rennes 2.
Résumé
Dans sa nouvelle intitulée « Her Other Bodies: a Travelogue » issue du recueil Altmann’s Tongue (1994), Brian Evenson propose d’appréhender le geste d’écriture comme acte de cruauté. Dans un mouvement qui rappelle « La Colonie pénitentiaire » de Kafka, le texte met en scène les rituels d’un meurtrier qui grave des étoiles sur le corps des femmes qu’il rencontre et tue au gré de ses pérégrinations dans le Sud Ouest américain. De façon très frappante, l’instrument utilisé est un canif (« a pen-knife »), soit un outil qui, dans la langue anglaise, offre un lieu de rencontre particulier entre écriture et cruauté. La nouvelle fantasme une pratique du tatouage qui serait vidée de toutes ses propriétés initiatiques pour devenir le parangon de l’objectification morbide d’autrui. Loin de permettre au sujet de s’approprier son histoire en la faisant affleurer sur son corps, la nouvelle imagine le tatouage comme un acte de (dé)possession ultime rappelant la chair à sa matérialité pure. Ce faisant, Evenson consacre un nouveau rapport de l’écriture au corps qui, dans sa violence, fait signe vers les pouvoirs terrifiants du langage.
Mots-clés
Brian Evenson, nouvelle, tatouage, rite, cruauté, littéralisation, figure, mormonisme
L’expression « écrire au scalpel » fait partie des lieux communs de la critique dès qu’il s’agit de traiter d’un texte, d’une œuvre qu’on qualifie volontiers d’incisive, de violente, ou pour souligner sa précision chirurgicale. Elle est toujours immédiatement comprise dans son sens métaphorique, si courant qu’elle est maintenant devenue un poncif de l’analyse littéraire. Or, dans la nouvelle « Her Other Bodies: a Travelogue », issue d’Altmann’s Tongue de Brian Evenson, la formule reprend toute la force de sa littéralité première[1]. Une écriture au scalpel ne fait d’abord signe vers aucun au-delà symbolique : il s’agit ici d’écrire, de tracer des symboles avec un couteau dans la chair des victimes que massacre le protagoniste. Il s’agira donc de voir en quoi la nouvelle permet justement de retremper cette image à la source de sa violence originaire.
Bien qu’Altmann’s Tongue ne soit pas à proprement parler un réquisitoire anti-mormon[2], la nouvelle « Her Other Bodies: a Travelogue » porte déjà en germe la critique virulente que Brian Evenson fait de sa confession d’origine dont la violence, à la fois historique et liturgique, irrigue les textes de façon manifeste. La nouvelle campe l’errance d’un personnage mormon anonyme qui sillonne le Sud Ouest des États-Unis dans son pickup décrépi pour s’adonner, dans chaque nouvel État, à un meurtre rituel dont les modalités nous intéressent tout particulièrement ici. Le texte nous met précisément sur la piste d’une esthétique de la cruauté au sein de laquelle se confondent geste d’écriture et geste de mutilation.
On remarque d’emblée l’étrangeté d’un titre dissonant, qui met en perspective le texte, fragmenté en différentes scènes de torture, avec les entrées d’un récit de voyage. « Utah », « Wyoming », « Colorado », « New Mexico », « Texas » : tous les sous-titres des fragments de la nouvelle correspondent aux États que le protagoniste traverse lors de son périple, à la fois meurtrier et suicidaire. En ce sens, le travelogue, c’est d’abord ici le logbook, c’est-à-dire les entrées ou les traces d’un récit de voyage à la violence hyperbolique. Chaque étape du trajet s’articule de façon sensiblement similaire. Si le personnage s’enfonce à chaque fois plus avant dans la déréliction physique et psychologique, sa façon d’appréhender chaque État et de s’y comporter opère de façon très ritualisée. Le texte se présente ainsi sous la forme d’une fugue qui re-brasse des phrases thèmes qui sont redéployées dans le texte et mises en relation avec de nouveaux segments qui affluent constamment. Dans chaque section, le personnage parcourt les routes enténébrées du Sud-Ouest des États-Unis, discute brièvement avec des individus aux stations-services dans lesquelles il s’arrête, harcèle de coups de téléphone cette femme qu’il dit aimer et qui lui résiste, tente d’approcher d’autres femmes et se voit rabrouer, prend son démonte-pneu, défonce le crâne de ces mêmes femmes, puis trace des étoiles non pas sur, mais dans leur corps. La mise en perspective systématique des appels déçus et du meurtre laisse entendre un lien de causalité entre les deux actes. Le corps de l’amante est ainsi saisi dans la constellation de ses avatars (« her other bodies ») ; elle devient, par ses refus, l’objet d’une obsession qui confine au délire :
He put a quarter in the slot, dialed, shouted a few words, hung up, picked up the receiver, put in a quarter, dialed again, shouted some more, hung up, picked up the receiver, put in another quarter, dialed again, got a busy signal, picked the quarter out of the coin return, put in the quarter, dialed again, busy signal, dialed, busy, dialed, busy, dialed, dialed, dialed, dialed got a notinservice message, dialed, not-in-service, dialed, notinservice, dialed. He dialed and dialed, moving his quarter around the purgatory of coin return and slot, until the break of day. (p. 155)
Le schéma éternellement répétitif et l’accélération rythmique du passage signalent la compulsivité croissante avec laquelle le personnage tente d’entrer en contact avec celle qui le rejette. De plus, la comparaison de la femme avec l’agneau qui intervient quelques pages plus loin (« “Baby!” the man yelled. “Honey! Lamb” » [p. 166]) introduit l’idée d’un rite sacrificiel aux accents bibliques. Comme dans tout sacrifice, l’exécution de la victime comporte un rituel dont les composantes demeurent : chaque femme tuée est ainsi installée afin de subir les mêmes scarifications en forme d’étoile que les autres, dans un mouvement à la fois désespéré et vengeur, pour atteindre et s’approprier le corps de celle qui lui résiste. C’est dans ce rituel que s’instaure l’ambivalence entre l’acte d’écrire et l’acte de mutilation :
Utah
He drove across the border, crossed into the barren northern stretches of Utah. Three miles into the state he killed his first, bashing her eyes in with his tire iron. In the back of the UHaul he carved thirty-five stars into her back, rows of seven and eight. Flesh was not so easy with a penknife, he found, raising problems far beyond oak and pine. He hacked out a few early attempts, recut them on her thighs. (p. 145)
Le texte nous confronte ainsi à une vision quasi fantasmagorique du tatouage présenté dans ses modalités les plus extrêmes. Au sein de la nouvelle, le tatouage visé comme pratique de l’écriture dans le corps n’a plus aucune vertu initiatique. Il ne consacre pas ici le lien d’un individu à sa tribu, il ne rappelle pas les hauts faits de la personne qui les arbore, il n’a même plus de visée ornementale : il est intégralement subi et mortifère. Il devient geste de cruauté pure. Rappelons, tout d’abord, l’étymologie du mot cruauté, qui vient de cruor signifiant le sang[3] ; non pas le sang qui circule dans le corps (sanguis), mais le sang répandu, le sang que l’on a versé à la suite du geste cruel. Le concept de cruauté fait donc fondamentalement référence au corps et aux sévices qu’on lui inflige. C’est la peau considérée par Didier Anzieu dans Le Moi-peau comme « donnée originaire à la fois d’ordre organique et d’ordre imaginaire, comme système de protection de notre individualité en même temps que comme premier instrument et lieu d’échange avec autrui » qui est d’abord visée par le geste cruel, en ce qu’il est, dans son acception première, synonyme de déchirure (Anzieu, 1995, 25)[4]. S’attaquer à cette surface qu’est la peau – comme instance d’individuation et interface de communication –, c’est donc paradoxalement s’attaquer à ce qui il y a de plus profond et de plus intime en l’individu. Le geste cruel, en ce sens, se présente comme étant le paroxysme du mal infligé au corps et à la personne.
Ainsi, cette pratique dévoyée du tatouage en tant que geste meurtrissure artistique est menée à bien à l’aide d’un instrument qui en résume toute l’ambiguïté : le « pen-knife » souvent traduit par les mots « cutter » ou « canif[5] », mais qui est à entendre ici littéralement comme une plume-lame[6]. Le pen-knife offre un lieu de rencontre saisissant entre assassin et écrivain dont les pratiques se confondent en un seul et même geste. La nouvelle explore ce fantasme d’un geste créatif s’inscrivant profondément dans la chair pour démontrer les effets d’une écriture toute-puissante. Le commentaire portant sur la difficulté de travailler le corps comme on travaillerait le bois, signale que le corps n’est plus considéré comme cadavre, c’est-à-dire comme lié à un sujet humain. Il devient, à ce moment, pure matière de projection, il devient une toile, un bloc de pierre, une page blanche sur laquelle l’artiste va pouvoir exécuter sa pratique. Ces corps ne sont pas seulement réifiés comme dans d’autres nouvelles[7] d’Altmann’s Tongue (un objet est intentionné : il se donne comme une forme délimitée par des contours), ils sont véritablement matérialisés – au sens où ils sont transformés en matière première sur laquelle le personnage exerce sa pratique. Cette matière n’a rien de singulier ou de sacré, elle supporte les erreurs, peut se faire brouillon, ou palimpseste, pour être par la suite jetée :
« Shining the light told him that he had been cutting stars in the wrong girl. He scraped the cut skin away, mutilated out the stars. He felt around for the freshest flesh, began to cut. » (p. 162)
Kafka, dans « La Colonie pénitentiaire » (1919), mettait déjà en scène cette machine à torture qui permettait de tatouer la sentence des prisonniers dans leur chair jusqu’à la mort, transformant de ce fait le corps en support scriptible de la faute. Evenson semble ici reprendre le dispositif kafkaïen pour en proposer une variante toute aussi horrifique. Les corps ne se voient pas ici infligés le dessin d’une sentence comme dans le système punitif kafkaïen, mais celui d’étoiles dont la symbolique semble particulièrement intéressante dans la mesure où elle condense et met en tension les deux univers qui sont réverbérés dans toute la nouvelle.
Ces étoiles tatouées par rangées évoquent immédiatement celles du drapeau américain qui ne flotte plus fièrement sur la nation mais s’est rigidifié pour le pire sur le dos inerte de cadavres. On objectera que le protagoniste n’en tatoue pas toujours le même nombre sur le dos de ses victimes qui en comptent parfois cinquante, parfois trente-cinq, voire une seule, comme c’est le cas dans la toute dernière section. Mais il faut se rappeler que le drapeau américain lui-même n’a pas toujours arboré le même nombre d’étoiles, et que ces dernières se sont elles aussi rajoutées progressivement au fil de la construction du pays. Ces étoiles gravées au canif figurent ainsi peut-être en creux la violence de la construction d’un pays qui s’est élaborée au gré de massacres successifs.
Le dessin de ces étoiles obéit d’autre part à une logique de littéralisation qui n’est accessible qu’en ayant à l’esprit la liturgie mormone. Le Livre des doctrines et Alliance, l’un des ouvrages canoniques du mormonisme, consigne toutes les révélations que Dieu aurait faites au père fondateur du mormonisme qu’est Joseph Smith. L’un des passages du livre, lui-même inspiré de l’Épître aux Corinthiens[8], traite de ce que Joseph Smith a appelé « le corps céleste » (« the celestial body »). Le corps céleste fait ici d’abord référence aux astres dans son acception biblique classique, mais il caractérise aussi, par extension métaphorique, le corps glorieux des Mormons dont la vertu leur permettra d’accéder à la résurrection dans le royaume céleste[9]. Le personnage central de la nouvelle, dont l’appartenance au mormonisme est suggérée subtilement à travers l’hymne mormon (« the spirit of God like a fire » [p. 162]) qu’il fredonne à la fin du texte, propose donc ici d’incarner, de rendre charnelle, une image religieuse pour la restituer dans toute la violence de sa littéralité. Ce tatouage abject des étoiles dans le corps des victimes permet ainsi de rendre à la métaphore toute sa puissance figurale. Il s’agit de retrouver le dessin derrière la lettre, et de mettre en exergue tout le pouvoir d’une écriture qui rend leur chair aux mots.
De façon surprenante, les deux univers convoqués par ce dessin cruel, l’Amérique iconique déchue d’une part à travers la création de ce drapeau macabre, et la liturgie mormone de l’autre, se trouvent également superposés, à la façon d’un palimpseste encore une fois, à échelle de la nouvelle entière :
He pulled over at an old Sinclair Station and turned off his lights. The pumps were torn out, except for a few pieces of pipe sticking out of the cement. The windows of the station were broken out, the asphalt cracked by weeds. He sat on the edge of a raised cement slab. He stared out at the deserted roads. Feet on the ground, he lay down on the slab, staring into the moonlit clouds, his arms spread out, against the cold concrete. He closed his eyes, lay still. (p. 150)
Le texte nous offre la vision post apocalyptique d’un monde détruit au sein duquel les infrastructures des Hommes, envahies par les mauvaises herbes, ne sont plus que les vestiges d’un temps révolu. La dalle sur laquelle s’allonge le protagoniste avant de fermer les yeux et de s’immobiliser fait surgir des images de mort que tout le paysage inspire. L’Amérique qui nous est présentée au sein du texte est une Amérique décomposée, celle des stations-service délabrées et des rednecks de la Harley Fest :
The cement front of the store was decorated with slanted shakewood strips. He searched through rows of boot mugs, cowboyboot belt buckets, tiny tin spoons with bronco rider handles, until he found a packet of No Doz. (p. 153)
Des boucles de ceinture en forme de bottes aux petites cuillères imitation selle de cheval, ce qui reste du Grand Ouest américain se voit commodifié sous la forme d’objets au kitsch consommé. Ainsi la mention systématique des slogans associés à chaque État (« Up with the sun, this here is Wyoming » (p. 155) / « This is Colorado, people watch out for each other » (p. 159) souligne de façon ironique la perte d’une Amérique authentique ici étouffée sous ou remplacée par ce que Baudrillard appelle « l’excroissance cancéreuse du parc des pseudo objets » (Baudrillard, 45) ; soit des objets qui ne sont plus que des signes vides, les témoins ridicules de la rupture de cet univers avec une culture américaine originelle, aussi fantasmatique qu’elle puisse être.
He took long empty farm roads out into the fields and past the occasional dark house. He flushed two men, naked but for their boots and Stetsons out of the bush, and they pursued him down a deep rutted road, giving over the chase when he reached the edge of town and street lights. (p. 154)
De la même façon, le mythe viriliste du lonesome cowboy domestiquant les espaces sauvages du nouveau continent se voit quelque peu mis à mal à travers la mention de ces deux hommes, vêtus uniquement de leurs bottes et de leur mythique Stetson, qui détalent d’un buisson, pris sur le vif d’une rencontre licencieuse.
Sous cette première surface d’une Amérique, à la fois factice et désolée, affleure un monde bien plus ancien encore que celui du grand Ouest mythologique, celui de l’Ancien Testament. La nouvelle est intégralement modelée par un jeu de clairobscur constant dont les contrastes dramatiques entre lumière et obscurité rappellent le manichéisme de la Bible :
On the straightaways they passed him, darting over the double yellow line, their headlights glaring in hard at him then vanishing. The mountain heaved itself up on his left, in the darkness inching its way closer to the road. […] Beyond, in the flat stretches on the other side of the river, a rim of light outlining the rails. (p. 147)
De manière frappante, la nouvelle elle-même essaime les indicateurs troublants d’une géographie morale que parcourt le personnage qui tourne a « Devil’s Slide », bifurque à « Desmoines » et dont tout le discours est cousu d’expressions religieuses (« “What in hell?” he said » [p. 157]/ « Goddam you for this! » [p. 157]) ; des expressions dont la récurrence les présente comme moins anodines ou insignifiantes qu’il pourrait y paraître à première vue. Ainsi, en plein cœur du Nouveau Mexique, le personnage, insomniaque depuis des jours, s’abyme dans un délire messianique au sein duquel il s’érige comme nouveau prophète élu de Dieu :
He turned off the headlight, tried to divine the approach of morning […] He was on his way to heaven. He traced his name into God’s prayer book with his cigarette coal. (p. 162)
Sous l’étendue de cette Amérique moribonde convulse l’enfer de l’Ancien Testament, d’un monde où la parole divine est toute créatrice et toute destructrice. À l’instar du dos étoilé des victimes du protagoniste, le texte se présente sous la forme de surfaces mythologiques violentes, elles-mêmes traversées par le camion du protagoniste qui dans sa trajectoire fend le pays du nord au sud. Ainsi l’usage marginal du verbe « wind » dans la phrase suivante « he wound the tight exit ramp down into Perry » (p. 145) renvoie directement à l’image de la blessure que trace le camion dans son embardée folle.
Il semble plus globalement que, dans la nouvelle, tout ce qui fait trace fait blessure. Ce voyage qui nous est présenté comme ne laissant que des meurtres barbares dans son sillage est la première ligne sanglante tracée à même le sol américain, une trace qui se voit déclinée en permanence dans la nouvelle :
« He dragged her by her heels out the back way, in stages, her pulped head leaving a bloody swath » (p. 164). Cette ligne tracée au sol par la tête ensanglantée de l’une des victimes trainée par terre est à réfléchir comme l’une des figurations, a minima, de cette trajectoire meurtrière exécutée par le personnage. Elle rappelle aussi directement cette ligne de brûlures de cigarettes que s’imprime le personnage sur le torse :
He lit a cigarette, burnt himself with it on the stomach, drove forward a mile or two, burnt himself again, higher up. By his nipple, he was in Clayton, ten miles from the state line. He drove. (p. 165)
Le texte trace sans cesse des lignes qui se gravent douloureusement dans les différents espaces géographiques ou corporels de la nouvelle. Dans un jeu de miroir troublant, le camion lacère le corps des différents États qu’il traverse tandis que le corps brûlé du protagoniste devient lui-même la carte par le biais de laquelle il se repère dans l’espace. La nouvelle semble ainsi orchestrer une expansion des surfaces scriptibles qui prolifèrent dangereusement au sein du texte. Par un effet de mise en abîme, elles viennent rappeler au lecteur que la page elle-même est la surface tatouée par des mots qui sont à voir comme autant de lacérations. C’est du moins le fantasme activé par un texte au sein duquel toute trace, donc tout mot, fait blessure.
Cette image centrale de la nouvelle qu’est le tatouage meurtrier force évidemment le lecteur à faire retour sur le dispositif textuel auquel il est confronté pour voir que ce qui dérange à la lecture n’est pas tant la teneur sensationnelle du crime perpétré, mais bien l’extrême blancheur de la voix narrative qui se fait le relais intégralement neutre des horreurs décrites :
He told her there was cash in his truck. He went out to get the tire iron. He stumbled up the counter and swung the iron up above his head and down at her, crashing through the sign and racks and down into her temple, cigarette boxes raining down upon her. He went back behind the counter and stomped upon the woman’s skull with his heels until it went pulpy and caved in. He slipped the tire iron through a belt loop, grabbed the body under the warm, damp underarms. He pulled her up to him, squatted, folded her over his shoulder, he stood, grabbed cartons of cigarettes. (p. 163)
Aucune émotion ne vient infléchir le rythme constant de ces phrases assignées à ce « he » dont l’intériorité nous demeure interdite. C’est ainsi le dispositif d’écriture lui-même qui fait violence au lecteur confronté à une narration qui ne fait pas voix puisqu’elle est intégralement étrangère à toute forme d’affects.
En convoquant l’image du tatouage mortifère Evenson rappelle que toute trace, fut-elle scripturale, est une blessure. En ce sens, par un jeu de réversibilité horrifique, si tout corps peut faire surface scriptible, alors toute surface scriptible peut faire corps. Et c’est peut-être ainsi qu’il faut lire la nouvelle : comme une peau à vif que viennent inciser les mots d’une écriture littéralement au scalpel.
Références bibliographiques
Anzieu D., (1995), Le Moi-peau, Paris : Dunod, coll. « Psychismes ».
Baudrillard J., (1996), La Société de consommation [1970], Paris : Gallimard, coll « Folio Essais ».
Erman M., (2009), La cruauté. Essai sur la passion du mal, Paris : PUF, coll. « La Nature humaine ».
Evenson B., (1994), Altmann’s Tongue, Lincoln : University of Nebraska Press. Evenson B., (2014), La langue d’Altmann [trad : Claro], Paris : Le Cherche Midi.
Kafka F., (1990), La colonie pénitentiaire [1919], Paris : Gallimard.
Smith J., (2013), The Doctrine and Covenants of The Church of Jesus Christ of Latter day Saints (1835), Salt Lake City, https://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/132 (consulté le 3 juin 2019).
Société Biblique Française (éd.), (1996), La Bible : l’Ancien Testament et le Nouveau Testament (traduction œcuménique de la Bible), Paris : Le Livre de Poche.
[1].↑ Il existe une traduction française d’Almann’s Tongue réalisée par Claro : Brian Evenson, La langue d’Altmann [trad : Claro], Paris : Le Cherche Midi, 2014.
[2].↑ C’est le cas de Father of Lies (1998), le premier roman de l’auteur qui présente l’Église des Saints des Derniers Jours comme une matrice infernale de destruction des femmes et des enfants.
[3].↑ Voir l’ouvrage de Michel Erman, La cruauté : Essai sur la passion du mal, Paris : PUF, 2009, qui esquisse ces distinctions étymologiques essentielles dans l’introduction de l’ouvrage.
[4].↑ Didier Anzieu, Le Moi-peau, Paris, Dunod, 1995, p. 25.
[5].↑ C’est la traduction qu’a retenue Claro dans sa traduction, La Langue d’Altmann, Paris : Le Cherche Midi, 2014.
[6].↑ Dans « The Wavering Knife » nouvelle issue du recueil éponyme (2004), l’image du couteau tremblant est considérée par le narrateur (un critique doublé d’un assassin) comme la pierre de touche du travail fascinant de l’autrice Eva Gengli. L’image devient la signature d’un travail qui met une fois de plus en réseau le couteau et la plume.
[7].↑ « A Conversation with Brenner » met en scène Ernst Jünger qui soliloque tout en prétendant discourir avec ce qui semble être le cadavre de Brenner. Dans « Stung » le personnage observe l’intérieur de la gorge de son beau-père qu’il a préalablement tué en remplissant sa gorge d’abeilles puis en lui cousant les lèvres. Le personnage principal de « Eye » fait ses adieux à son amante après avoir gobé ce qui finalement n’était pas un œil de verre.
[8].↑ « Il y a des corps célestes et des corps terrestres ; mais différente est la gloire des célestes, et différente celle des terrestres ; autre la gloire du soleil, et autre la gloire de la lune, et autre la gloire des étoiles, car une étoile diffère d’une [autre] étoile en gloire. » (Le Nouveau Testament, « L’Épître aux Corinthiens » I:39). L’analyse cosmologique de l’Épitre aux Corinthiens entend « les corps célestes » dans leur acception purement astronomique.
[9].↑ « These [the exalted beings] are they whose bodies are celestial, whose glory is that of the sun, even the glory of God, the highest of all, whose glory the sun of the firmament is written of as being typical. » ( Joseph Smith, The Doctrine and Covenants of The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints, 76, 70). Ici Joseph Smith s’inspire directement de l’Épître aux Corinthiens pour fonder l’un des éléments théologiques distinctifs du mormonisme : les degrés de gloire. Le prophète ne postule pas un paradis, mais trois (téleste, terrestre et céleste), le paradis céleste constituant degré de gloire suprême, accessible uniquement aux Mormons les plus fervents : « Faithful members of the Church will come forth in the morning of the First Resurrection and receive a glorified, celestial body » (Doctrine and Covenants, 88, 28)