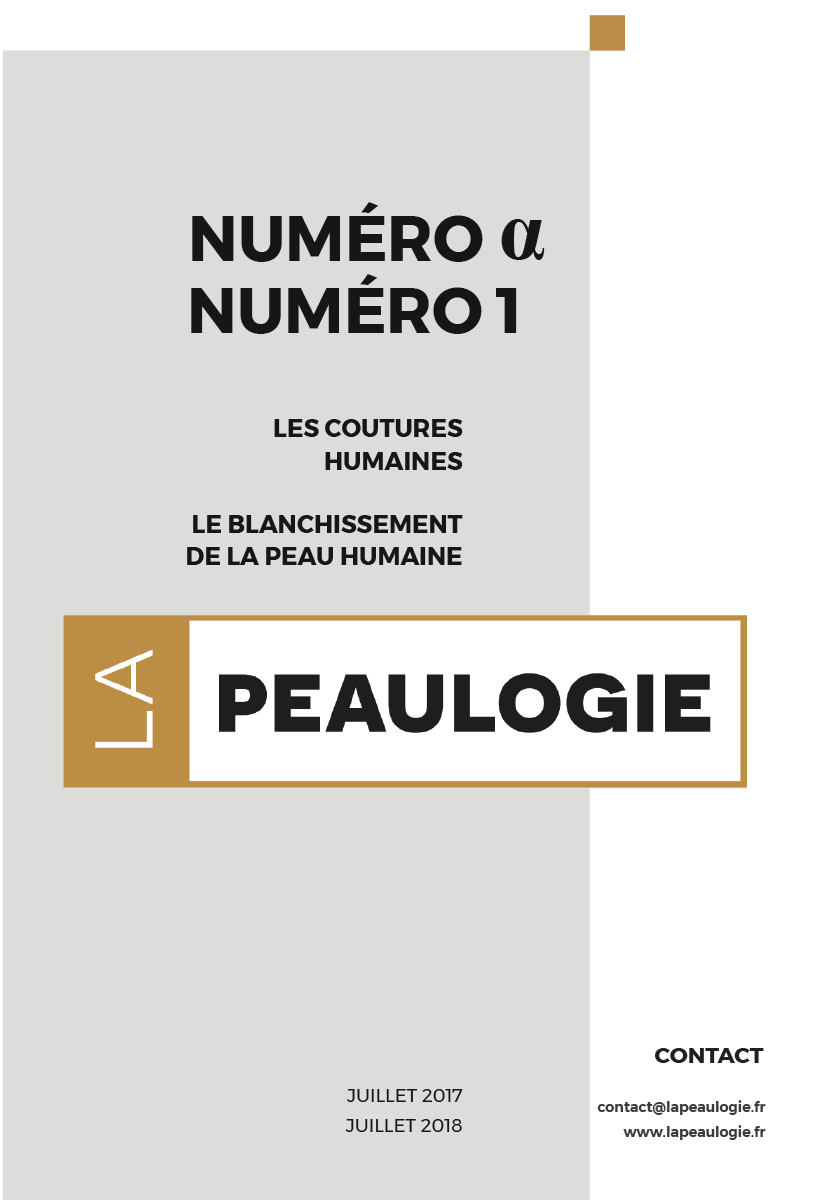
Les gueules cassées de la « Grande Guerre »
-
Description
Christophe DARGÈRE
La convergence des intérêts entre un progrès technique (toujours plus asservi à un modèle de modernité rationaliste) et la Grande Guerre (en quête perpétuelle de trouvailles technologiques les plus stratégiques et destructrices qui soient pour son auto-alimentation) eu pour effet de donner à l’être humain des moyens inédits dans les actes barbares qu’il décida de commettre contre lui-même. Jamais, à ce stade précis de notre processus de civilisation[1], il n’aura autant mobilisé la science à des fins morbides. Le conflit de 14-18 a cela de particulier qu’il produit la transition entre les guerres anciennes dites de « corps à corps » et les guerres modernes où l’acte de tuer n’est plus lié à un mouvement, un geste humain direct. Il est ainsi possible de se situer à des centaines de mètres de ses victimes lorsque l’on tire un obus. Manière de se retrancher derrière la mécanique technique pour se déresponsabiliser et se déculpabiliser face aux conséquences psychiques que pourraient provoquer l’acte de mettre l’autre à mort… Si les assauts voués à annexer les tranchées adverses restèrent des tactiques incontournables dans le grignotage des territoires ennemis, moins de 1% des décès étaient dus à l’utilisation des armes blanches.[2]
Soumis à des conditions météorologiques extrêmes (canicule, grand froid), à l’inconfort des tranchées et de la zone armée d’une manière générale, à l’absence d’hygiène, au manque d’eau, de nourriture et de médicaments, à la cohabitation avec des insectes et animaux indésirables, les hommes devaient par-dessus tout subir les effets désastreux des combats eux-mêmes. Sur le front, forts des nouveaux moyens technologiques mis à disposition par la science, les soldats avaient à disposition un panel conséquent d’armes diverses pour donner la mort : fusils, revolvers, obus, mitrailleuses, lance-flammes, grenades, gaz, poignards, baïonnettes. Les corps, exposés à ces armes, se déchiquetaient, se broyaient, se transperçaient, se brûlaient, se déchiraient, se coupaient…[3] Tout était destiné à anéantir, à détruire l’enveloppe charnelle du combattant, sa qualité de sujet, de personne morale, de structure psychologique ayant déjà fait l’objet, préalablement, d’une forme de négationnisme de la part des Etats-Majors des deux bords, friands de « chair à canon » pour instrumentaliser leur soif de pouvoir et de conquête.[4]
Dans ce contexte, une nouvelle population de blessés va apparaître et symboliser la barbarie du conflit puisque, en quelque sorte, ces blessés vont autant représenter la violence commise que la souffrance endurée. Cette population concerne les « gueules cassées » qui sont les victimes des configurations innovantes du conflit 14-18 que nous venons de décrire. Environ 15 %[5] des soldats blessés l’ont été au visage et près de 15 000[6] d’entre eux furent considérés comme des gueules cassées, au sens propre, avec des séquelles fonctionnelles et esthétiques irréversibles. La vulnérabilité des visages s’explique par l’utilisation d’un type spécifique d’armement (projectiles d’artillerie, éclats d’obus) et notamment les shrapnels (obus de balles). Faiblement protégés, les soldats subissaient cette technique de guerre qui reposait sur un saupoudrage aléatoire des zones de front par les canons situés en retrait des lignes. Les hommes, cantonnés dans les tranchées, étaient des cibles faciles qui ne pouvaient que subir le pilonnage de ces espaces maudits, sans avoir les moyens ni le droit de fuir.
La prise en charge médicale des gueules cassées n’a pas été anticipées par la médecine militaire (comment aurait-elle pu d’ailleurs, la guerre n’était-elle pas censée être « courte et propre » ?).[7] De ce fait, le corps médical s’est trouvé confronté à une nouvelle catégorie de patients, une population inattendue et méconnue qu’il dut soigner massivement et dans l’urgence. Les deux premières années furent particulièrement critiques, puisque les infrastructures de l’arrière n’avaient pas de lieux dédiés à l’accueil des gueules cassées. Fréquemment les brancardiers laissaient agoniser les blessés de la face, agissant sur ordre ou considérant par eux-mêmes qu’il n’était pas envisageable de les soigner.[8] Ce n’est qu’à partir de 1916, et des batailles de Verdun et de la Somme que le système de santé militaire consacre une partie de ses services à l’accueil des gueules cassées. Dans ce contexte, l’enjeu était double : il fallait restituer les configurations fonctionnelles et vitales de la face (la respiration, la mastication, …), tout en veillant à la dimension esthétique du visage, une des rares parties du corps que l’on ne saurait cacher en société. Relevant le défi de cette situation critique, la chirurgie maxillo-faciale a fait des progrès exceptionnels en fort peu de temps, en dépit du fait que nombre de victimes furent des cobayes, la médecine découvrant ses malades en même temps que les maux dont ils souffraient.
Le soldat défiguré a perdu son visage, celui avec lequel il a construit sa vie relationnelle. Le stigmate de la guerre éclipse la référence d’un soi commun et inaperçu, jusqu’alors validée par la conformité d’un visage ordinaire.[9] Cette réalité implique une reconstruction identitaire par défaut, destinée à parer les assauts des interactions de la vie quotidienne. Une nouvelle donne redistribue les enjeux du contexte communicationnel. Elle se traduit par un chamboulement existentiel considérablement marqué par l’émergence du pouvoir de l’autre, de celui qui scrute et dé-visage.[10] Chaque rencontre devient une négociation où planent des projections inhérentes au « visage de l’arrière »[11] : « À quoi ressemblait donc cet homme auparavant ? ». Celles-ci s’entrecroisent avec des spéculations relatives au visage mutilé qui se présente dans l’interaction : « Comment cet homme s’est-il blessé, souffre-t-il physiquement, psychologiquement ? ». L’irréversibilité de la perte d’une partie de soi, aussi fondamentale que le visage, se corrèle donc avec les situations sociales biaisées par ce fait. Les apparitions en public se manifestent par l’imposition à l’autre d’un visage meurtri, élément central d’une apparence qui symbolise l’horreur de la guerre, et plus concrètement, de ce que l’homme est capable d’infliger à l’homme. Nombre de gueules cassées se sont rassemblées en association, telle celle du Colonel Picot[12], pas simplement pour faire valoir leurs droits de victimes. Ils aiment à se réunir dans des espaces de discussion qui avaient la véritable fonction de groupes thérapeutiques où pouvaient s’évoquer et se partager les traumatismes liés à la guerre, mais aussi ceux qui concernaient « la mort de l’apparence » et le deuil du « visage d’avant ».
De nombreux artistes se sont penchés sur la condition des gueules cassées. En peinture, l’expressionniste allemand Otto Dix qui a lui-même participé au conflit a réalisé un chef d’œuvre en s’inspirant d’une scène vécue et observée dans un bar de Dresde. Cette peinture, Les joueurs de skat[13], met en scène trois soldats allemands atrocement mutilés qui jouent aux cartes. La configuration formelle du jeu est elle-même soumise aux handicaps des anciens soldats : l’un tient les cartes avec sa bouche, l’autre avec ses orteils et le troisième avec une main mécanique. Leur apparence entremêlant appareillage métalliques, corps morcelés, visages brûlés, cisaillés et difformes tranche avec une attitude désinvolte, presque ridicule. Ce tableau, marquant de réalisme, est une profonde critique d’un conflit qui a grandement influencé la vie et l’œuvre de Dix. C’est aussi une illustration criante de la souffrance et de l’absurde condition des soldats, qui sont marqués au plus profond de leur chair, par les effets de la guerre, toute aussi absurde.
En littérature, le roman de Marc Dugain, La chambre des officiers[14], retrace le destin d’un jeune officier, Adrien, qui est blessé au début de la première guerre mondiale. De cette blessure au tout début du conflit à la fin de la seconde guerre mondiale, cet ouvrage, bienveillant et profondément humain traite le sujet de la défiguration avec justesse et finesse en croisant le destin d’autres soldats, blessés à la face tout comme Adrien. Les situations sociales qui convoquent le stigmate d’un visage détruit au milieu des relations ordinaires sont éloquentes et révèlent sans doute la proximité du romancier avec la thématique, puisque Marc Dugain accompagnait fréquemment son grand-père dans une institution pour Gueules Cassées. Notons l’évocation du destin d’une jeune infirmière volontaire, gueule cassée féminine, qui vit encore plus violemment l’exclusion sociale que les soldats défigurés.
Au cinéma, le film de François Dupeyron, La chambre des officiers, est une adaptation très réussi du roman de Marc Dugain. Les scènes sont fréquemment des huis clos qui décrivent les espaces de soin. L’ensemble est particulièrement réaliste. Il montre à quel point l’univers des soldats défigurés est initialement protecteur et bienveillant, afin de leur permettre de vivre au mieux la déconstruction identitaire dont ils sont les objets, ainsi que leurs souffrances psychiques et physiques. Ce premier stade laisse alors place à une terrible épreuve qui consiste à affronter une autre vie sociale, entièrement reconfigurée par une nouvelle apparence qui repose sur leur visage atrocement mutilé.
Les gueules cassées, si elles bénéficièrent d’un « capital sympathie » considérable auprès de l’opinion publique d’après-guerre, ont pourtant été constamment soumises à un malaise qui dépasse les subtilités communicationnelles du face à face ordinaire des rencontres de la vie quotidienne. Bien plus que cela, elles furent les ambassadrices maudites d’une guerre qui, certes a été gagnée, mais au prix d’une douleur incommensurable pour ses protagonistes et leur famille. En ce sens, le symbole culturel du visage, tel que Le Breton le propose se combine à la conception ontologique d’Emmanuel Levinas pour dépasser sa fonction purement communicationnelle et atteindre une dimension réellement anthropologique dans toute sa complexité et toute sa globalité.[15] Ces visages meurtris vont rester à tout jamais souillés doublement : par les cicatrices qui les cisaillent et par les regards qui les scrutent.
Les gueules cassées représentèrent ainsi un miroir funeste, un reflet sordide, une manifestation concrète de ce que l’être humain est capable de s’infliger à lui-même. En cela, elles demeureront perpétuellement une illustration épouvantablement réaliste d’un épisode de notre modernité qui entérine une phase de déchéance et de régression de la civilisation occidentale.
[1] ↑ Norbert Elias, La dynamique de l’Occident, [1939], Calmann-Lévy, Paris, 1975, p. 273.
[2] ↑ Stéphane Audoin-Rouzeau, préface à l’ouvrage de Sophie Delaporte, Gueules Cassées. Les blessés de la face de la Grande Guerre, Noésis, Paris, 1996, p. 19.
[3] ↑. Christophe Dargère, Je vous écris de mon hôpital… Destins croisés de six soldats ligériens blessés pendant la Grande Guerre, Paris, 2011, L’Harmattan, p. 137.
[4] ↑ Christophe Dargère, Si ça vient à durer tout l’été. Lettres de Cyrille Ducruy, soldat écochois dans la tourmente 14-18, Paris, 2010, p. 276.
[5] ↑. Sophie Delaporte, Gueules Cassées. Les blessés de la face de la Grande Guerre, Noésis, Paris, 1996, p. 30.
[6] ↑. Ibid.
[7] ↑. Jean-Yves Le Naour, La Grande Guerre, First, Paris, 2008, p. 37.
[8] ↑. Sophie Delaporte & Christophe Dargère, « En attendant le Stigmate : portrait d’un jeune homme défiguré de la Grande Guerre », in Stéphane Héas & Christophe Dargère (dir.), Les porteurs de stigmate, Paris, L’Harmattan, 2014, p. 71.
[9] ↑. Erving Goffman, Stigmate. Les usages sociaux des handicaps, [1963], Éditions de Minuit, Paris, 1975, p. 31.
[10] ↑. David Le Breton, Des visages. Essai d’anthropologie, Paris, Métailié, 1992, p. 296. Voir aussi « Visage et formes de défiguration », in Christophe Dargère & Stéphane Héas (dir.), La chute des masques, de la construction à la révélation du stigmate, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2015, p. 230.
[11] ↑. Gabriel Chevallier, La peur, [1930], Le Dilettante, Paris, 2008, p. 127.
[12] ↑. Noële Roubaud & R.N Brehamet, Le colonel Picot et les gueules cassées, Nouvelles Éditions Latines, Paris, 1960.
[13] ↑. Otto Dix, Les joueurs de skat, Huile et collage sur toile, 110 x 87, Neue Nationalgalerie, Berlin, 1920.
[14] ↑. Marc Dugain, La chambre des officiers, Jean-Claude Lattès, 1998.
[15] ↑. Emmanuel Levinas, « Visage et éthique », in Totalité et infini. Essai sur l’extériorité, [1971], Paris, Le Livre de Poche, 1987, pp. 215-220.




