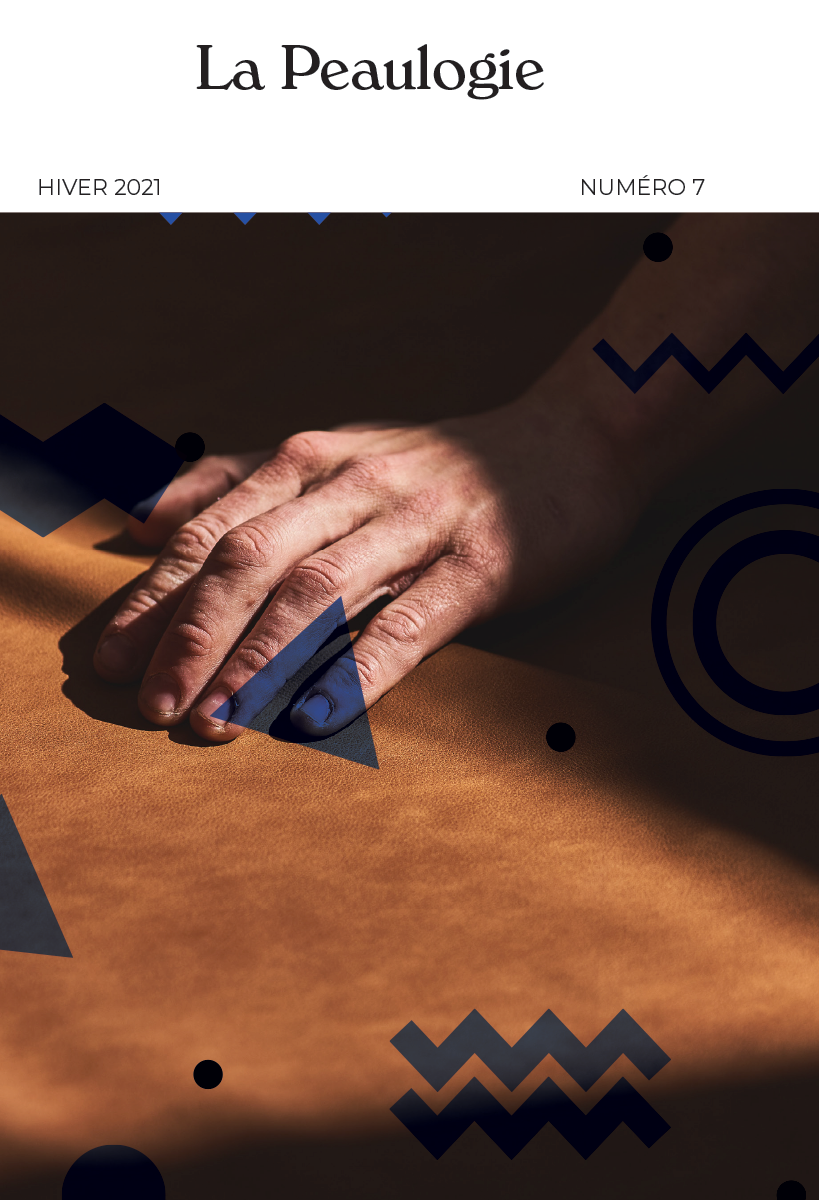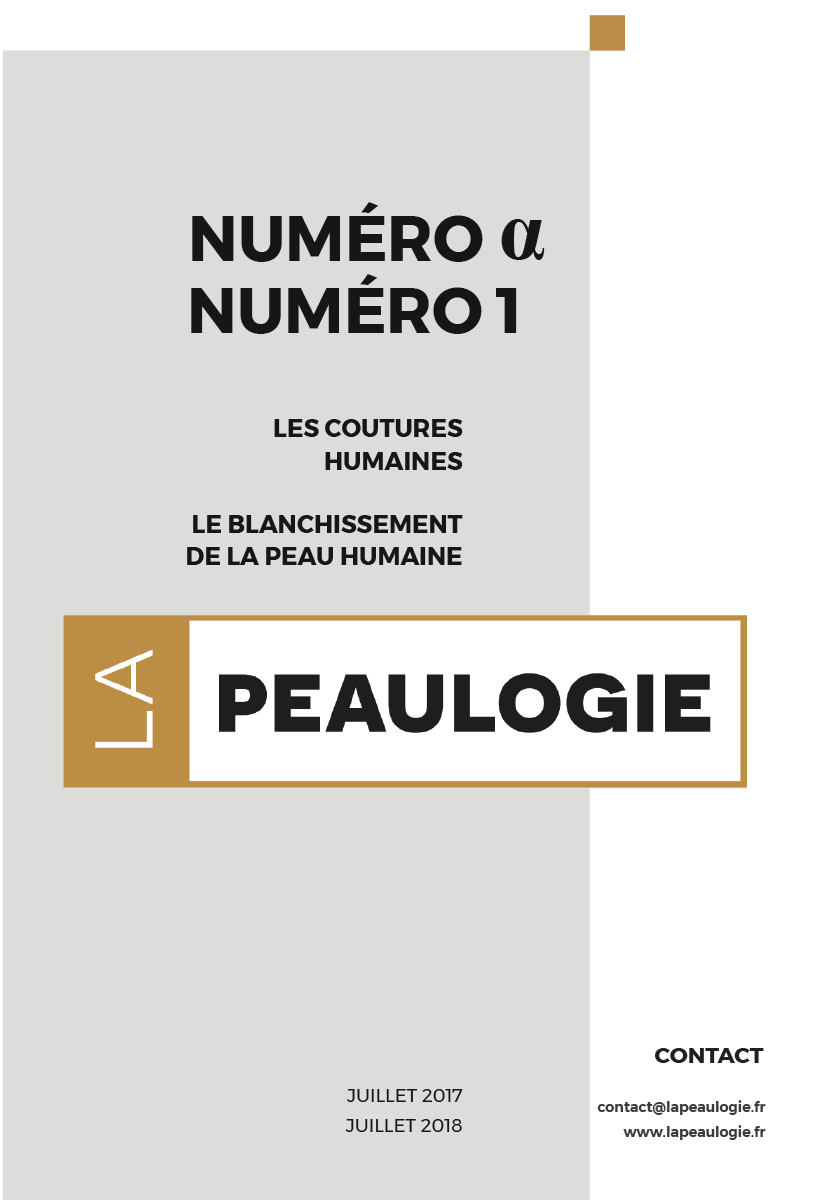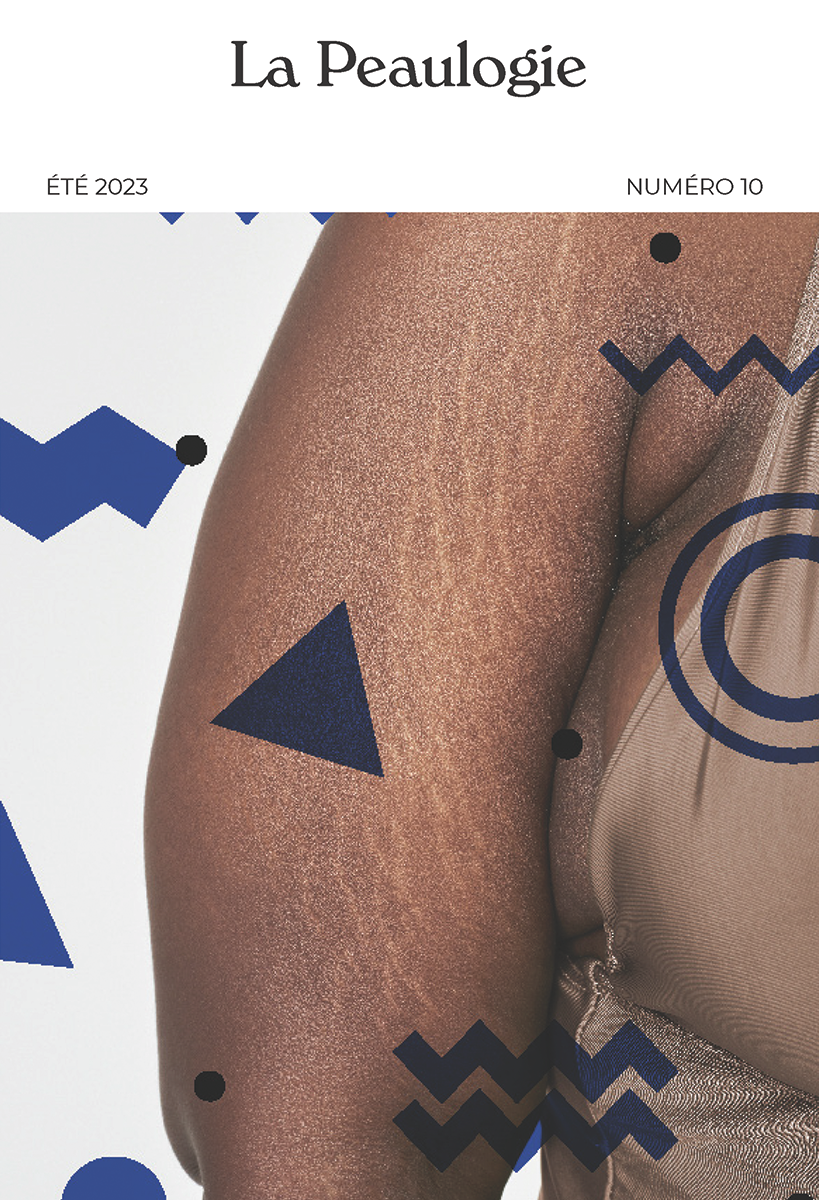Référence électronique
Augris M., (2024), « Pores et prose d’une putréfaction manifeste. L’œuvre littéraire de Brian Evenson », La Peaulogie 11, mis en ligne le 28 octobre 2024, [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/pores-prose-putrefaction
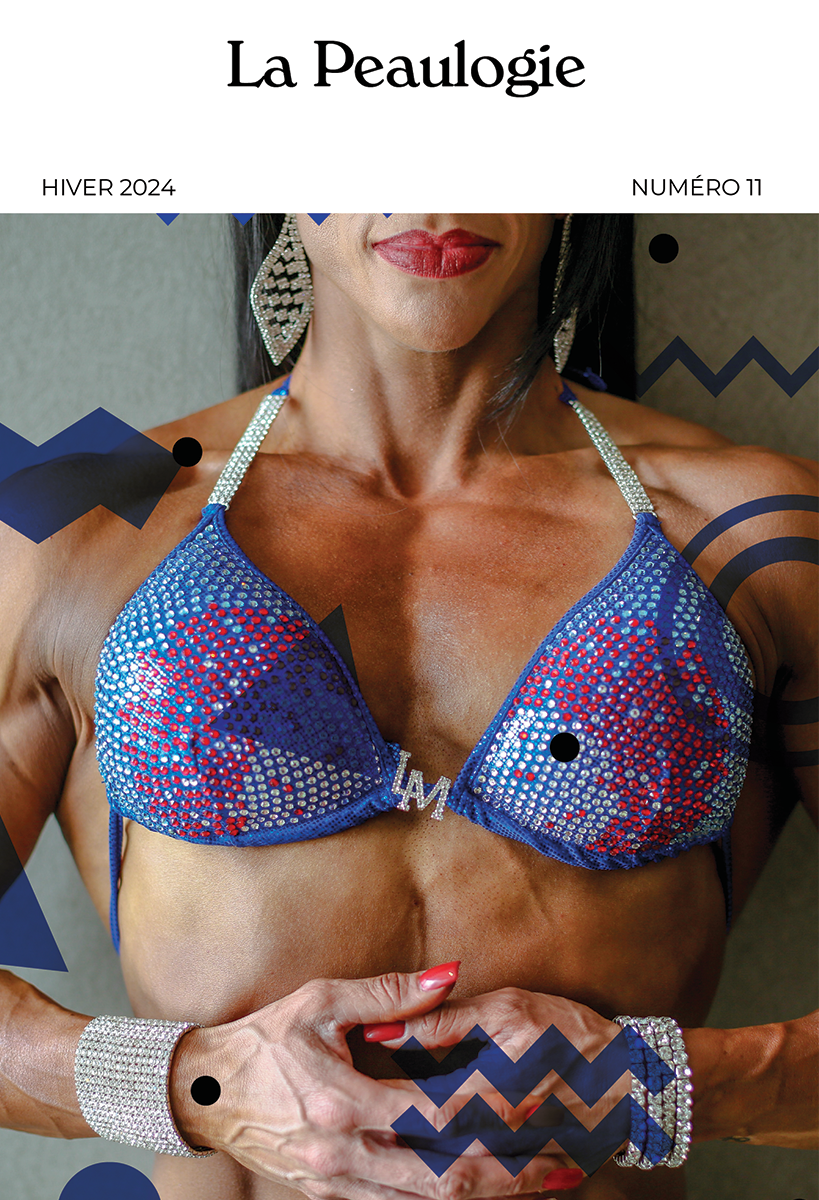
Pores et prose d’une putréfaction manifeste. L’œuvre littéraire de Brian Evenson
-
Description
Morgane AUGRIS
PRAG à l’université d’Orléans, docteure en littérature américaine, I.C.D. (EA 6297).
Résumé
À la surface de la peau, à la fois barrière et interface, se façonnent nombre de discours et de représentations de pouvoir. Le double‑sens de l’anglais « pore », renvoyant tout autant à ses minuscules orifices qu’à l’activité d’un lecteur absorbé par un texte, rend compte du rapport singulier que la peau entretient avec l’enveloppe langagière, cette « peau de mots » évoquée par Didier Anzieu. La thanatomorphose, spectacle abject dont l’œil se détourne spontanément, cristallise par conséquent des enjeux figuratifs aux portées tant politiques qu’esthétiques. La poétique de l’écrivain américain contemporain Brian Evenson faisant la part belle dans la novella Dark Property aux archaïsmes langagiers, elle est souvent assimilée à l’entreprise du culte de la résurrection dont elle conte les expérimentations. Cette prose ouverte, débarrassée de toute transcendance, de toute médiation et de tout au‑delà susceptibles d’empêcher une expérience directe du corpus, intensive et sensorielle, peut‑elle toutefois réellement être rapprochée de ces instances religieuses, scientifiques et politiques imposant une frontière infranchissable entre la vie et la mort, reflétée par le sort qu’elles réservent aux dermes abîmés ? À travers la putréfaction manifeste qu’il nous livre dans sa prose depuis la publication de son premier recueil de nouvelles en 1994, l’auteur ne propose‑t‑il pas davantage une poétique de la porosité et de la diffé‑rance ?
Mots-clés
Brian Evenson, Littérature américaine contemporaine, Peau, Putréfaction, Représentation, Sensation, Grotesque
Abstract
At the surface of skin, both barrier and interface, a considerable amount of discourses are being fashioned and projected. The double‑meaning in English of the term “pore,” referring to its minute openings and the activity of a reader absorbed in a text, accounts for the skin’s relation to linguistic signs and echoes Didier Anzieu’s “skin of words.” Thanatomorphosis being in addition what the eye cannot stand to look at, it raises major issues in terms of figuration, with political and aesthetic implications. As the poetics of contemporary American writer Brian Evenson resorts to dead, archaic words in his novella Dark Property, it has often been associated with the resurrection cult whose experiments it narrates. His prose however is characterized by open‑endedness as well as the absence of transcendence, conventional mediation and any beyond likely to jeopardize a direct, sensorial and intensive experience of the corpus. As a result, can it really be compared to those religious, scientific and political figures imposing an impenetrable frontier between life and death, reflected through their treatment of damaged skins? Through a prose devoted to putrefaction, has not the writer actually been offering a poetic manifesto of porosity and “diffe‑rancid” since the publication of his first collection of short stories in 1994?
Keywords
Brian Evenson, Contemporary American literature, Skin, Putrefaction, Representation, Sensation, Grotesque
INTRODUCTION
La peau nue, bien trop souvent réduite à son au‑delà que constitue la chair, se prête sans surprise à nombre de fantasmes. Tous cependant ne relèvent pas d’Eros, loin de là. C’est davantage l’influence de Thanatos qui s’expose dans la tradition évoquée par Didier Anzieu de ces « fantasmes de mutilation de la peau [qui] s’expriment librement dans la peinture occidentale à partir du XVe siècle, sous couvert d’art anatomique ». Il cite à titre d’exemples un « personnage de Jean Valverde port[ant] sa peau à bout de bras » (1995, 42), « de Joachim Remmelini (1619) [dont la] peau [est] enroulée autour du ventre comme un pagne », ou encore de Felice Vicq d’Azy (1786) et de Van Der Spieghel (1627), dont respectivement « le scalp pen[d] sur le visage » et la peau se détache des fémurs pour servir de guêtres (p. 42). L’auteur américain contemporain Brian Evenson n’est pas étranger à ces représentations : dans la nouvelle « Prairie » (2015), il met en scène un homme dont la peau du dos, écorchée, est nouée en ceinture. Il transporte en outre dans son sac le reste du visage de son persécuteur, réduit à une étendue de peau battue par le vent (p. 61). La malléabilité de la peau la rend apparemment apte à figurer jusqu’à l’impensable. Ce palimpseste où s’impriment tous les mouvements de la vie en vient naturellement à incarner, dans la nouvelle « Leaking Out » (2019), l’art même du conteur : une fois son récit achevé, une mystérieuse créature enveloppe puis piège le pauvre auditeur sous son derme.
Comment expliquer alors, face à la puissance narrative sans commune mesure de la peau, que Flaubert, à la vue d’une femme nue, ne rêve qu’à son squelette (Ferrari et Nancy, 2002, 101) ? Le corps décharné semble littéraliser l’idéal flaubertien du « livre sur rien », « sans attache extérieure », « qui se tiendrait de lui‑même par la force interne de son style », telle une carcasse : comme l’indique l’écrivain, « [l]es œuvres les plus belles sont celles où il y a le moins de matière ». Brian Evenson, moins préoccupé par la représentation que par l’affect, partage ce rêve d’un « livre qui n’aurait presque pas de sujet ou du moins où le sujet serait presque invisible » (Flaubert, 1974‑1976, 158). L’incarnation en est toutefois radicalement différente : l’attention prêtée à la peau sous toutes ses formes viendrait chez l’auteur américain souligner le travail du matériau langagier, cette enveloppe verbale censée venir toucher le lecteur dans sa chair. Le statut accordé à la peau au moment singulier où le vivant, accomplissant son destin, se rapproche de la mort, semble critique en termes d’enjeux figuratifs : que se joue‑t‑il donc sur le plan discursif à la surface d’une peau en pleine thanatomorphose ? Si le cadavre s’assimile étymologiquement à une chute, alors doit‑il signifier la fin de toute histoire ? La composition artistique ne peut‑elle s’accommoder de cette étape insolite que constitue la décomposition ? Le dessèchement de la peau est‑il nécessairement synonyme d’imaginaire à sec ?
Le stade de la putréfaction catalyse non seulement changements mais échanges. Or toute l’ambiguïté de la peau réside dans sa qualité à la fois de barrière et d’interface. La langue anglaise en témoigne par la grande polysémie du terme « peel » : expression relative au mouvement utilisée par Evenson dans le roman The Open Curtain (2006, 149)[1], ses homonymes renvoient au contraire aux notions de « fixation » et de « forteresse ». Il faudra donc se pencher sur ces deux tendances opposées conditionnant la vision de la peau. L’une consiste, selon les formulations de Federico Ferrari et Jean‑Luc Nancy, à « [r]echercher une structure, un fond capable de fixer la mobilité perturbante des lignes changeantes et éphémères du corps » en faisant d’un corps vivant un « corps d’éternité », un « corps devenu pierre » ; et l’autre, au contraire, à « porter la nudité “vers ce qui se dérobe sans pose à une représentation distincte” (Georges Bataille) » (2002, 101), et prend alors tout son sens, ses sens, au contact de l’indifférenciation de la charogne, où semblent se mêler tout le cosmos et tous les possibles sans distinction. Si le caractère hypomnésique de l’écriture a maintes fois été souligné, alors la littérature peut‑elle réellement jouer le jeu exclusif de la préservation du corps et de la peau par une mise à distance figurative, celle‑là même que Daniel Arasse lit en peinture dans la réduction du corps du spectateur à « un acte de présence incorporel » annonçant « le domaine de la science moderne […] qui ne voudra plus connaître des corps que dans un étalement qui les supprime » (1996, 254) ?
« TOUCHY » : LA PEAU, UNE FRONTIÈRE À RESPECTER
Dans la nouvelle « Torpor » (2016), Brian Evenson présente à son lecteur les conséquences inattendues de l’amputation d’un mari sur le sommeil de son épouse : sujette à des douleurs lancinantes dans les mains, la protagoniste avait pris l’habitude de dormir en les reposant sur le bras de son époux, allongé de côté. Cette position surélevée, la seule ayant finit par soulager sa souffrance, devient impossible lors du retour au foyer de son époux au bras amputé des trois quarts :
When he first came home, the stump wrapped in gauze, she had of course understood that she couldn’t touch it, that it would hurt him to do so. She had respected that, kept her distance. But then the wound had annealed, the scar tissue had thickened and then hardened […]. By that time, it felt as if she hadn’t slept for a year. It hadn’t of course been that long, but that was what it felt like, and that was what she meant when she’d said it to him. But, touchy, he’d misunderstood. The tragedy here, he’d claimed, is not whether you can sleep. This, he said, shaking the stump in her face, is the tragedy. Stump, he claimed, trumps stabbing hand pain. (p. 146)
Face au corps meurtri de son compagnon, l’épouse garde ses distances afin de ne pas lui infliger un mal supplémentaire : la plaie, la peau endommagée, passe alors de zone de contact à frontière inatteignable. Ainsi que l’intime le verbe « respect », la limite ainsi mise en place n’est pas seulement physique, mais morale, ce que confirme le ton culpabilisant utilisé par le mari à qui elle fait part de son mal‑être. Une fois la phase cicatricielle passée, l’espoir est revenu : l’utilisation d’une homéotéleute entre « thickened » et « hardened » suggère par la répétition des syllabes finales que l’extrémité du bras a selon elle désormais retrouvé une forme d’intégrité. Les terminaisons répétées confèrent par la langue une impression de durcissement similaire au processus subi par la plaie. Le tissu cicatriciel est le signe que les liens du couple peuvent à leur tour être retissés par un contact peau à peau. Un astucieux polyptote permet à l’écrivain de glisser de « touch », au sens concret, à « touchy », dénotant le caractère du personnage : dans le toucher et dans la peau se jouent bien davantage que des rapports physiques. Comme le dit Artaud, « [c]’est par la peau qu’on fait rentrer la métaphysique dans les esprits » (Baudrillard, 1976, 163). Le double‑sens de « touchy » rend compte de la façon dont l’abstrait gagne du terrain sur la matière par sa dévitalisation. La distance à « respecter » est lourde d’implications, puisque l’expression consacrée implique qu’on « tienne en respect » : l’isolation prescrite au corps et à la peau, même en contexte médical, tend à témoigner de la soumission qui leur est imposée sous prétexte de préservation, l’esprit ayant dans la tradition philosophique et religieuse occidentale peu à peu assis sa supériorité sur la matière. Il est pertinent que la peau de l’époux vienne se substituer aux attelles précédemment utilisées, et ce d’autant plus que le nom « splint » (p. 145) renvoie étymologiquement à une section d’armure : beaucoup se joue à la surface de la peau, qui ne sert pas seulement de support à des corps physiques mais à des représentations discursives, recouvrant la matière. Jean Baudrillard constate dans le chapitre de L’échange symbolique et la mort dédié au corps en tant que « charnier de signes » :
La peau elle‑même ne se définit pas comme « nudité », mais comme zone érogène : medium sensuel de contact et d’échange, métabolisme de l’absorption et de l’excrétion. Cette peau poreuse, trouée, orificielle, où le corps ne s’arrête pas et que seule la métaphysique institue comme ligne de démarcation du corps, est niée au profit d’une seconde peau non poreuse […] [f]onctionnalisée comme un revêtement de cellophane. Toutes ces qualités […] sont des qualités de clôture […]. Cette vitrification de la nudité est à rapprocher de la fonction obsessionnelle de revêtement protecteur des objets […], qui vise à les remettre perpétuellement en état de propreté, d’abstraction impeccable – […] les maintenir dans une sorte d’immortalité abstraite. (1976, 162)
L’enroulement dans la gaze, puis la couche durcie du nouveau tissu cicatriciel, rejouent l’image de cette peau seconde qui n’aura désormais dans sa représentation plus grand‑chose à voir avec le corps, originellement lieu d’échanges et de métamorphoses. La mise à distance physique et symbolique de ce dernier doit éviter infections et putréfactions : en d’autres termes une corruption, au sens biologique mais également moral. La fin de la nouvelle démontre dans quelle mesure cet idéal est intenable : la protagoniste épuisée a pris un amant dans le seul but de reposer ses mains. Il s’avère, par un habile retournement, être le narrateur du récit.
Brian Evenson, élevé dans le cadre de l’Église de Jésus‑Christ des Saints des Derniers Jours, est particulièrement conscient de l’emprise des normes et des représentations sur tous les aspects de la vie. Suite à la publication de son premier recueil de nouvelles, Altmann’s Tongue (1994), une lettre anonyme est envoyée à ses supérieurs à l’université mormone de Brigham Young afin de dénoncer l’ouvrage au motif qu’il ferait la promotion de valeurs contraires au culte. Forcé de choisir entre son art et sa religion, l’écrivain finit par demander son excommunication et n’a de cesse depuis de dénoncer la violence d’un langage support d’injonctions, auquel il oppose une littérature caractérisée par l’absence de médiation conventionnelle et de tout jugement auctorial. Il s’exprime dans un entretien sur sa démarche esthétique, qu’il oppose à l’instrumentalisation systématique des récits de son enfance au service d’une morale religieuse :
[G]rowing up faithful in a religious culture, I was almost barraged with stories. Things from the Bible or from the book of Mormon […], stories in church meant to illustrate a moral lesson […]. All of that was important to forming my sense of myself as a writer, partly in terms of opposition […]. (Nolen, 2009)
Le terme « barrage » évoque en anglais non seulement l’idée d’un bombardement, mais la création d’une barrière artificielle ayant pour but le contrôle des flux, ce qui n’est pas sans lien avec la définition de la « peau seconde » offerte par Baudrillard. Proche de la notion de « gaze » cette fois‑ci, Evenson reprend cette image de frontière, de mise à distance imposée par des récits totalisants, sous les traits cette fois‑ci d’une « zone tampon » :
All religion proceeds from the need to channel violence and to give it significance‑to redeem the violent act. Religion tries to create a buffer between the individual and the meaninglessness of the world. It doesn’t do away with violence, it just attempts to contain it. […] Like religion, language does violence to the immanent world by forcing the objects of that world to be understood in terms of generalities, by stripping them of their specificities and categorizing them. (Marcus, date non communiquée)
Le verbe « strip », utilisé par ailleurs dans l’œuvre d’Evenson en référence à l’écorchement[2], met en lumière la dénaturation de la matière même de la peau subie lors de telles projections discursives. Dans la recherche d’un corps propre et propre à tout dire proprement, les stigmates doivent être contenus. Ainsi que le rappelle Julia Kristeva, « [l]e corps ne doit garder aucune trace de sa dette envers la nature : il doit être propre pour être pleinement symbolique » (1980, 121). Evenson s’en amuse dans la nouvelle « The Prophets » (2004), où le protagoniste renoue littéralement avec le passé de son Église en déterrant le cadavre du prophète Ezra Taft. Les traits du visage jusque‑là préservés s’effondrent. Le personnage décide d’y remédier par quelques interventions sinon cosmiques au moins cosmétiques. Le temps ne doit avoir aucune prise sur le message comme sur le corps religieux. La résurrection symbolique impose d’avoir l’air en forme et plein de vie :
I decided to see what I could do about making him look a little perkier. I went into the house and got some of the beauty supplies my wife had left a few years back when she had seen fit to leave me so suddenly for no worthwhile or explicable reason. There was some bright neon‑red lipstick and some peach‑colored powder with a puff and some mascara […]. (162)
Dans cette hagiographie grotesque, baumes et onguents sont remplacés par de la vaseline et du papier toilette, le masque funéraire par du mascara. La mention du départ de l’épouse, alors que le narrateur décide de faire revenir le prophète, n’est pas sans implications : la religion vient pallier l’absence de justification et de sens à laquelle la séparation l’a exposé. Pour Nietzsche, le problème de l’être humain n’est pas tant la souffrance que le « problème de son sens » :
[U]n énorme vide entourait l’homme […]. C’est l’absence de sens de la souffrance et non celle‑ci qui était la malédiction jusqu’ici répandue sur l’humanité, – et l’idéal ascétique lui offrait un sens ! […] [L]’énorme lacune paraissait comblée […]. On ne peut absolument pas se cacher ce qu’exprime précisément toute cette volonté qui a reçu sa direction de l’idéal ascétique : cette haine de l’humain, plus encore de l’animalité, plus encore, de la matérialité, cette répulsion devant les sens, […] cette exigence d’échapper […] à tout changement, à tout devenir, à la mort […]. (2002, 180‑181)
Tous les pores, les orifices, les plaies et les béances en surface de la peau se doivent d’être comblés par du sens dans une entreprise de mise à distance du corps réel et matériel au profit du spirituel et du transcendant. L’enjeu s’en voit nécessairement redoublé à l’approche de la mort.
Dans la novella Dark Property, Evenson suit dans un univers désertique postapocalyptique le cheminement mouvementé d’une mère jusqu’à un culte de la résurrection, où elle compte bien faire ressusciter l’enfant décédé qu’elle transporte dans son sac à dos. Or, Baudrillard met en garde contre « tous ceux qui triomphent de la mort », car la renaissance implique de jouer la vie contre la mort (1976, 204). Prenant l’exemple des Canaques pour qui il n’existe « pas de distinction, sur le plan symbolique, entre les vivants et les morts », le philosophe explique que « le vivant/non‑vivant est une opposition distinctive que nous seuls faisons, et sur laquelle nous fondons notre “science” et notre violence opérationnelle » (1976, 205). Il voit dans « [l]’émergence de la survie […] l’opération fondamentale de naissance du pouvoir », dont ont d’abord bénéficié les castes de prêtres : « Briser l’union des morts et des vivants, briser l’échange de la vie et de la mort, désintriquer la vie de la mort, et frapper la mort et les morts d’interdit, c’est là le tout premier point d’émergence du contrôle social » (1976, 200). Le traitement accordé à la peau, où se lit en premier lieu le mouvement du vivant vers la mort, sera donc incomparablement soumis aux exigences du pouvoir. Le rituel de résurrection dans Dark Property consiste ainsi à coudre la bouche d’où pourraient s’échapper des protestations, à se débarrasser des dermes abîmés qui laisseraient penser à une continuité entre la vie et la mort, et à combler toutes les béances des corps, que le pouvoir est désormais prêt à investir : « Using tar, they stopped her gaps. They peeled the skin back from the man’s temple, chipped away the fissured bone. […] Screwing metal plates into his head, they stretched skin across them. They sewed the mouths shut » (2002b, 131‑132).
La procédure relève de différentes instances de pouvoir. Si le religieux y occupe une place centrale, le médecin, aux allures d’ingénieur, n’est pas en reste. Baudrillard note que « [l’]irréversibilité de la mort biologique […] est un fait moderne de science » : « notre idée moderne de la mort est commandée par [le] système de représentation […] de la machine et du fonctionnement. Une machine marche ou ne marche pas. Ainsi la machine biologique est morte ou vivante » (1976, 243). La transformation dans Dark Property du bébé en machine au terme d’un embaumement robotique ne dit pas autre chose (2002b, 81‑82). Durant l’entretien médical avec la mère, le médecin se voit lié par un réseau d’images à son cartable et à sa poubelle, aux puissantes mâchoires (79‑80)[3] : il est présenté comme simple rouage d’une structure disciplinaire plus large. Les gants dont il se débarrasse à l’issue de l’examen sont assimilés à des bouts de peaux (79). L’enveloppe corporelle, objectifiée par son rapprochement avec l’équipement jetable du médecin, n’existe que pour servir le système. Or, l’emprise sur les corps est aussi administrative, et au vu de la paperasse et des nombreuses feuilles remplies (106‑108)[4], on ne peut s’empêcher de mettre peau et documentation papier en relation : « La peau se pèle facilement, comme si l’on enlevait du papier », écrit Sylvia Plath (citée par Anzieu, 1995, 42). Stigmates et expériences sont similairement prélevés pour que s’impose le pouvoir disciplinaire[5]. La peau en définitive matérialise cette « barre » que tient le pouvoir, cette coupure entre la vie et la mort qui préfigure toutes les autres selon Baudrillard (1976, 200‑201).
Que la peau, sacrifiée lors du rituel de la résurrection, ne joue plus le rôle d’interface mais de barrière, jusqu’entre la vie et la mort, est préfiguré lors de l’arrivée de la mère au lieu abritant le culte : forteresse imprenable, cette frontière annonce les autres. Le protocole langagier exigé à l’entrée rend compte des discours qui s’entremêlent désormais à la surface de la peau : la mère est violemment repoussée à de multiples reprises tant qu’elle ne répond pas à la question du garde « What is wanted ? » le simple mot « Admission » (2002b, 76). La polysémie du nom est plus significative qu’il n’y paraît : elle dénote à la fois le passage dans un lieu autre, l’accueil dans la sphère hospitalière, la confession d’une faute morale ou criminelle, et la validation d’un propos tenu pour vérité. Les différentes figures d’autorité ainsi enchevêtrées sont pourtant celles que Ferrari et Nancy tiennent à bonne distance de « la peau des images », procédant d’une « peau comme vérité : ni l’au‑delà de la peau que cherche le désir, ni son dessous que vise la science, ni le secret spirituel d’une chair dévoilée ». En dehors de toute projection et de toute dissection, la peau est par essence « ce paraître qui ne fait rien apparaître que le paraître lui‑même » : « [c]’est pourquoi l’image est son élément, et sa peau toujours la peau d’une image » (2002, 6‑7). Qu’en est‑il alors de l’esthétique à fleur de peau d’Evenson ? Le style archaïsant très particulier employé dans Dark Property a souvent été rapproché, y compris par l’auteur, du culte de la résurrection de la diégèse : tous deux semblent ramener les morts à la vie. Le credo de l’ordre religieux repose toutefois sur une vision de la peau comme frontière étanche et totalisante, qui s’avère difficilement conciliable avec l’écriture grotesque, résolument ouverte et hybride, de l’écrivain.
EXPÉRIENCES TACTILES ET VISUELLES DE LA POROSITÉ : PROSE DES PORES, PORES DE LA PROSE
Interrogé sur la présence dans Dark Property d’un vocable absent des dictionnaires, Brian Evenson revient sur la genèse de la novella, dont l’histoire est inspirée des archaïsmes sélectionnés par l’auteur pour sa rédaction :
I did a degree in 18th century literature and read a lot of obscure 18th and 17th century texts. I started making lists of words that had fallen out of the language, and then began wondering about why the words had died. And then I started thinking, too, about how those words might mutate or adapt to other usages. […] Dark Property has a lot of odd words but tries to put them into a very clean context, a context where one can quickly guess their meaning. For me, it was a way of trying to resurrect these dead, really intriguing words, and the story of the novella, which involves a resurrection cult and a very permeable line between life and death, sprang from that. (Goodwin, 2005)
Le terme de résurrection, comme on l’a précédemment vu, ne rend pas justice à la démarche d’Evenson, qui insiste parallèlement sur la perméabilité entre vie et mort. Il n’oppose pas dans la langue les morts aux vivants suivant la ligne de démarcation étanche qu’implique la vision religieuse de la résurrection, il les fait cohabiter. Suivant l’exemple de Philippe Forest, il est bienvenu de renoncer à cet « imaginaire orphique ou dantesque solidaire au mieux d’une vision religieuse assez convenue de la littérature (l’écrivain comme prophète ou messie ressuscitant le monde par le seul charme de sa parole) » en « renvers[ant] un peu les rôles » : « [c]onsidérer le romancier non pas comme un vivant descendant parmi les morts mais comme un mort revenant chez les vivants » (2007, 102‑103).
Cette conception que Forest qualifie de « revenance » est saillante dans la nouvelle « Prairie ». Il n’est pas aisé d’y distinguer les morts des vivants : « I wander among the dead, awaiting the moment when I shall pass imperceptibly from the stumbling of the living into the stumbling of the dead. Avaunt », commente le narrateur (2015, 64). L’univers qui accueille la diégèse, la Frontière mouvante et sauvage de l’ouest américain, reflète la perméabilité au cœur de l’œuvre evensonienne : vie et mort s’entremêlent dans le récit, tout comme le western, le fantastique et le postapocalyptique se rencontrent au plan générique. La langue confirme cette hybridité. Le « paroch » (60), néologisme de « pasteur » difficile à différencier d’un lexème archaïque et déchu, incarne d’autant mieux le statut de l’écriture chez Evenson que le protagoniste est un scribe. Il note les noms des êtres que le groupe croise sur des parchemins enroulés, « wound scrolls » en anglais (61). Or la polysémie de l’anglais « wound » fait aussi de cette feuille une plaie, une peau abîmée. Cet enroulement, cette circularité dont il est question, est commune au tissu du vivant et à l’écriture. La novella Dark Property, elle‑même située dans le désert, en livre un exemple éloquent par l’enchevêtrement constant de l’origine et de la mort. Avant le début de la première section officielle de l’ouvrage, l’œuvre met implicitement en abyme sa naissance et sa démarche créative originale en mentionnant l’action féconde de la poussière : « coition of dust » (2002b, 2). L’expression donne à entendre tout le potentiel séminal de la poussière, ce revenant de la peau traduisant notre matérialité fondamentale. L’œuvre nait paradoxalement de mots poussières, résidus de putréfaction errant parmi les vivants : dans ces grains Michael Marder voit l’incarnation suprême du nomadisme, traversant toutes les frontières de l’espace, du temps, et des sens (2017, 4). Ainsi que le suggère le dernier terme de la nouvelle « Prairie », « Avaunt », Evenson suspend toute clôture : celles de l’œuvre, de la langue et du sens y compris. Il privilégie l’incertitude et la confusion. Les phrases sont manipulées jusqu’à ouvrir sous les pieds du lecteur un vertigineux abîme, au‑dessus duquel le langage permet d’osciller. La dimension communicative de la langue s’incline devant son pouvoir intensif et expérientiel, rendant palpable sa dangerosité (Peak, 2021)[6].
Plus de barrière étanche donc, le lecteur se voit proposer une expérience de la porosité : les mots morts‑vivants inconnus ouvrent des abîmes dans le texte, qui n’empêchent aucunement le lecteur d’en jouir. Au contraire, ils rendent le tissu textuel à sa qualité tactile étymologique en jouant le rôle de punctum, « piqûre, petit trou, petite tache, petite coupure » que Roland Barthes identifie dans la photographie comme « ce hasard qui, en elle, me point (mais aussi me meurtrit, me poigne) » (1996, 47‑49). Le langage est pour Evenson l’enveloppe à partir de laquelle nous percevons le monde (Peak, 2021) : le texte est une peau, « peau de mots » dirait Anzieu (1995, 231). Or, cette peau est loin d’être aseptisée ou synonyme d’immortalité : elle est marquée, perforée, abîmée. Barthes affirme « qu’il existe un autre punctum (un autre “stigmate”) » que le détail qui trouble. C’est « le Temps, c’est l’emphase déchirante du noème (« ça‑a‑été »), […] c’est : il va mourir » (1996, 148‑150). Le texte evensonien ne saurait se débarrasser du moindre stigmate, de la moindre détérioration apportée par le temps : ils sont la source même de l’expérience de lecture intensive qu’il souhaite proposer. Que chaque chapitre de la novella Dark Property s’ouvre sur une citation en allemand est lourd de sens. L’irruption des langues étrangères vient contaminer le corpus depuis ces entrées, ces orifices, ces pores que constituent les sections du livre, traces d’un découpage. C’est l’arrivée de l’Autre qui se voit ainsi célébrée, l’immixtion du dehors telle qu’elle se joue à la surface d’une peau lésée en voie de putréfaction. Influencé par le concept deleuzien de défamiliarisation, Evenson ne résout pas l’étrangeté mais l’invite : à la différence du culte de la résurrection, il ne se sépare pas des dermes infectés.
Baudrillard explique que « [l]e plus inquiétant n’est pas qu’on refasse une beauté au mort et qu’on lui donne un air de représentation » : cela a toujours été fait. Ce qui l’alarme dans nos sociétés, c’est que la thanatopraxie relève de la sémiurgie et « s’analyse donc comme volonté […] d’empêcher que subsiste, dans la chair asociale du mort, quelque chose qui ne signifie rien » (1976, 274)[7]. Comme nous l’avons vu, Evenson s’oppose à cette tendance du religieux depuis son tout premier recueil, Altmann’s Tongue. Plus aucune barrière ou zone tampon ne sépare chez lui corps et corpus de l’insignifiance du monde (Marcus, date non communiquée). Comme l’écrit Philippe Forest, le réel « ouvre un espace dans le tissu censé suffisant du langage. Et c’est autour de cette béance […] que le roman dispose ses mots […]. Non pas pour colmater la brèche ainsi suscitée […] mais précisément afin que ne se referme pas l’espace ainsi ouvert de l’expérience » (2007, 59‑60). L’écriture hérétique et intensive d’Evenson se passe désormais de tout au‑delà et de toute « instance intermédiaire »[8], même auctoriale. Il s’oppose ainsi à ce que la mimesis offre une distance sécurisante au lecteur : les cadres volent en éclats, et le lecteur est attiré au cœur même du texte et de ses transgressions. L’œuvre de sensation prend le pas sur la tradition représentative :
The problem facing me in assembling the stories of Altmann’s Tongue was how I might use style to allow readers to feel that they were entering into a relatively unmediated experience. […] Traditional mimetic representation has a certain safety to it – one has a sense of frame, as if standing at a distance from an object. I was interested in offering up an affective artistic object that used sound, rhythm, and other subcomponents of language as a means of rupturing that frame. I wanted to move the reader away from something mimetically depicted, toward feeling […] that they are being drawn into the artistic object, into the transgressions therein. (2002a, 271‑272)
Dans cette prose du contact et du toucher, le texte prend la forme d’une peau abjecte, la plus à même de traverser toutes les frontières[9]. Ce statut se donne à voir dès la première ligne de la nouvelle « South of the Beast » (2012), où Evenson mobilise la polysémie du mot « pore », désignant tant les minuscules orifices de la peau que l’activité d’un lecteur absorbé par un texte :
South of the Beast he pored through the bodies, searching for occasions where, in the membrane still integumented between flesh and bone, language had become caught and not yet worked free of a corpse. In one body, he found a fluster of wronged syntax, knotted in the cartilage of the knee; in another, the slick pulse of a word that, at a touch, split apart and grew cold before he could swallow it. He could feel the words leaking from his own body as well, and he himself grown faint and speechless, a dark grammar weeping from his side. (109)
Occupé à fouiller des corp(u)s immondes et putrescents, il se pourrait bien que le protagoniste ait paradoxalement mis la main sur un beau livre, qui s’écrit toujours selon Proust dans une sorte de langue étrangère (1954, 297). Les termes sélectionnés pour rendre compte de cette langue née des corps, pour les corps, fait étroitement écho à la littérature mineure chère à Deleuze. L’écrivain « invente dans la langue une nouvelle langue », qui ne respecte aucune frontière. Comme le personnage libérant les mots par la désarticulation des carcasses, l’écrivain « met à jour de nouvelles puissances grammaticales ou syntaxiques » en « entraîn[ant] la langue hors de ses sillons coutumiers » : « quand une autre langue se crée dans la langue, c’est le langage tout entier qui tend vers une limite “asyntaxique”, “agrammaticale”, ou qui communique avec son propre dehors » (1993, 9). Les corps abjects incarnent à la perfection l’insoumission de cette nouvelle langue, défamiliarisée, qui parce qu’elle surprend le lecteur, est d’autant plus apte à le prendre au corps. Le toucher est en effet au cœur de l’expérience du personnage, qui voit les débordements de cette langue, de ce sang d’encre, le contaminer puis affecter intensivement sa propre chair. La langue altérée, incarnée dans des corps abjects, permettrait à l’auteur de dépasser l’obstacle fondamental qui se présente à lui : celui d’un toucher direct inenvisageable. La mort étant par excellence auréolée de l’interdit social du contact avec le corps, sa présentation dans le texte a beaucoup à nous apprendre sur les moyens dont dispose l’écriture afin de pallier cette impossibilité consubstantielle de la communication tactile directe avec le lecteur, pourtant indispensable à une œuvre de sensation.
Deleuze le rappelle : « le problème d’écrire ne se sépare pas d’un problème de voir et d’entendre […]. C’est à travers les mots, entre les mots, qu’on voit et qu’on entend » (1993, 9). Premier contact avec le texte, la vue joue un rôle central dans la lecture. Le moment de la veillée funéraire est donc riche d’implications métafictionnelles sur les stratégies mises en place par l’écriture pour affecter le lecteur et lui offrir l’expérience d’un contact qui devra toujours nécessairement être indirect. L’expression française rend bien moins compte que l’anglais « viewing » de la nature éminemment visuelle de cet événement, auquel est confronté Rudd dans le roman The Open Curtain (2006). Le parallèle entre les expériences de vision du texte et de la mort est d’autant plus saillant que la femme qu’il vient saluer pour la dernière fois se trouve être sa professeure de lettres :
[…] his English teacher, Mrs. Frohm […] was dead from an overdose of sleeping pills. […] The gist apparently was that Mrs. Frohm was going to Hell. Rudd’s essay had been praised by someone going to Hell. Did that mean he was going to Hell too, or just his essay ? Rudd didn’t know what to wear to the viewing, settled on a red tie and a white shirt, his church pants. He stood in line to get to the body, hands in pockets, wondering what he would feel when he saw her corpse. Her face was pale under the rouge. He got his head down close enough to see the pores of her skin. Her eyelid, he could see, was just slightly open, two or three strands of cotton visible between the lashes. If there hadn’t been people behind him, he would have touched her skin. (15‑16)
Le texte, comme Rudd, trouve dans la vision le moyen de contourner l’interdit tactile pour s’approcher au plus près de la peau et en percevoir tout le potentiel. Maurice Blanchot constate dans l’Espace littéraire que la fascination exercée par les images tient justement à ce que le voir « suppose la distance », tout en « signifiant que cette séparation est devenue cependant rencontre » : quoique à distance, ce qu’on voit « semble vous toucher par un contact saisissant, […] comme si le regard était saisi, touché, mis en contact avec l’apparence » (1955, 28‑29). Ainsi préparé et préservé, le corps de Mrs Frohm relève de la pratique aseptisée des « funeral homes » que Jean Baudrillard juge « absurde » (1976, 275). Les détails toutefois garantissent implicitement une matérialité telle que l’expérience physique peut avoir lieu. La typographie rend palpables sur la page les rapports étymologiques entre textes et tissus, qu’ils soient textiles ou cutanés, faisant de la littérature une expérience épidermique. Lorsque Rudd s’approche jusqu’à apercevoir les pores de sa professeure, les lettres <o> et <e> démultipliées les impriment en retour sur la rétine du lecteur. Le seul moyen de parvenir à effleurer le corps de Mrs Frohm consiste à recourir au langage et à son pouvoir d’incarnation : Roland Barthes n’affirme‑t‑il pas que « le langage est une peau, […] comme si j’avais des mots en guise de doigts, ou des doigts au bout de mes mots » (1977, 87) ? L’expression « going to Hell » devient à force de répétition frottement irritant matérialisant dans la langue une touche à laquelle Rudd ne peut se livrer en public. La logique qui se tisse autour du syntagme frôle le syllogisme, dont le terme central pris en tenailles n’est autre que l’enseignante. L’interrogation de Rudd quant aux vêtements qu’il va porter est loin d’être superficielle. L’insistance sur les tissus clame que cette cérémonie autour de la vision ultime du corps est toucher par procuration : les couleurs de la cravate et de la chemise correspondent à celles de la défunte, le blanc et le rouge suggérant en outre au‑delà du maquillage artificiel les attributs de la charogne. Le double‑sens spatial de « settle » dépasse la référence au choix de la tenue pour souligner que Rudd épouse la surface des vêtements, substituts à la peau de Mrs. Frohm sur laquelle il se dépose par procuration. Lorsqu’il se demande ce qu’il va ressentir en voyant le corps, c’est donc au sens physique qu’il faut entendre « feel », écho textuel à cette sensation qu’Evenson souhaite communiquer au lecteur par l’écriture (2002a, 272). Ce sont les caractères imprimés qui vont permettre le contact le plus immédiat : l’apposition « hands in pockets » rend possible un affleurement du « corps » qui la précède à travers le mouvement de la virgule. L’extrait se fait célébration du pouvoir tactile synesthésique offert par la simple vision des tissus, peaux et textes. Art du détail par excellence, invitant à s’approcher au plus près des caractères imprimés, le texte evensonien touche par sa typographie minuscule tout aussi bien que la peau. Nulle surprise donc à ce que Rudd soit symboliquement doté de mains disproportionnées et de lunettes à forte correction censées compenser sa myopie. Les paupières de la professeure de lettres, parce qu’elles sont en grande partie maintenues closes par des fils de coton, font écho au détournement du regard habituel au moment de la putréfaction insupportable du corps, mais aussi de la lecture : le lisible proscrit en effet que l’on s’attarde sur les lettres, qui ne sont en réalité jamais vraiment vues. L’expérience qu’Evenson propose est toute autre : il s’agira pour le lecteur de réapprendre à voir, à travers les manipulations stylistiques d’une écriture happant son regard.
Les yeux, comme les orifices de la peau, doivent être maintenus ouverts. Cette volonté de déciller les yeux du lecteur, en vue de stimuler ses pores, se lit dans l’identification de l’auteur à un œil imperturbable, facilitée en anglais par la proximité phonétique entre « eye » et « I » :
[I] had annealed into […] an unblinking eye […]. All observed experience, I was convinced, was useful […]. I saw the story as a catalyst whose effect and whose success would be determined by the reader’s ability to interact with it. […] I wanted […] to depict murder, violence, and absence of human response in a way that allowed readers, if they were willing to keep their eyes open, to perceive violence not as symbolic, not as meaningful, but as a basic and irrecoverable act […]. (2002a, 271)
Le titre de la nouvelle « The Father, Unblinking » (2002), dont la structure apparemment tronquée donne une impression de gros plan, fait explicitement écho à cette posture manifeste face à la putréfaction. Contrairement au « respect » de la nouvelle « Torpor » qui correspond étymologiquement à un « regard en arrière », il s’agit ici de littéralement voir la mort en face : de s’y confronter sans la moindre visée morale, téléologique ou transcendante, de reconnaître la place qu’elle occupe dans la vie et dans le vivant. Un père trouve dans la boue le corps de sa fille probablement décédée de la fièvre, qu’il n’a d’autre choix que de retourner et de confronter. C’est là selon Philippe Forest le « cadavre vrai, celui de la personne aimée dans le moment insoutenable de la perte ». C’est tout le propre du roman, contrairement au « travail du deuil [qui] doit en faire progressivement se dissoudre le souvenir », de « lui conserve[r] son caractère déchirant de “reste”. Il ne renonce pas à ce “réel” dont la société ne veut rien savoir. Il répond à son appel » (2007, 49). Opposé au « calcul du savoir », le réel est « ce dont cette opération ne rend pas compte, ce dont elle ne vient pas à bout : le donné “hétérogène” que ne dissout pas en elle la langue du travail, de l’utile, de la signification » (2007, 50). La toute fin du récit, en procurant une nouvelle justification au titre, rend compte de ce nouveau rapport à la vision né du moment critique. Le père n’a pas informé la mère de sa triste découverte, de sorte qu’elle envisage de prévenir le shérif de la disparition de sa fille :
“You think we give the sheriff a call?” she said.
“No,” he said. […]
“You going to look for her?” she said.
He did not answer. He looked at what the sun was doing through the aspens. He looked at the way the stoop had grown worn underfoot, and at the difference in how the sun shone off the rough spots.
“Will you look for her?” she said.
“I will not,” he said.
“Look at me to tell me,” she said.
He turned to face her, turned all the way around, feeling his boots drag hard over the rough patches until he was facing straight at her. He opened his eyes all the way open and stared her in both eyes. He looked at her in the eyes and looked at her, and looked at her, without blinking, until it was she who blinked and turned away. (2002a, 8)
Le père ne compte ni appeler le shérif ni regarder partout dans l’espoir de retrouver sa fille, non seulement parce qu’il sait, mais parce qu’il a appris de la mort, de la confrontation avec le cadavre de l’enfant aux yeux grands ouverts, du corps charogne gisant au dehors des frontières de l’institution, du fonctionnel et de l’utile, à regarder et à voir réellement : à « look for » se substitue « look at », inlassablement répété pour mieux rendre compte de l’intensité de ce geste de résistance consistant à accepter la vision de la vie pour elle‑même sous toutes ses formes et dans toute sa différence. Car celui capable de soutenir la vision de la mort au début de la nouvelle est également celui qui ne cille pas face à la vie, sa dimension créatrice et régénératrice s’incarnant dans la figure de cette mère occupée à découper de fines lamelles nourricières dans la chair morte d’une biche. Et de là provient la possibilité de dire réellement : l’exigence de la mère « Look at me to tell me », plus qu’une simple façon de parler, est l’impératif qui fonde l’écriture du réel et de l’impossible[10]. Soutenant le regard de la mère jusqu’à la faire céder et dévier, sans hésiter à la souiller de son mensonge, la posture de ce père figure celle de l’écrivain, qui trahit sans ciller sa langue maternelle, défigurée par des mots morts‑vivants. La poétique evensonienne demeure du côté de l’insignifiance de la charogne et de l’abject, offerts à la vision et non plus à la réduction discursive. Dans son introduction au recueil, le philosophe Alphonso Lingis fait allusion à ce cadeau empoisonné, rappel du pharmakon, qui n’est autre que l’œuvre d’un voyant : « [t]he poisoned gift of a seer » (2002a, xi).
POÉTIQUE DE LA DIFFÉ‑RANCE
La thanatomorphose est un défi sans commune mesure lancé à la mimesis, l’œil cherchant inexorablement à se détourner de cette vision abjecte. Une fois qu’il accepte de se confronter à ce monstrueux rappel de la matérialité humaine, reste encore la difficulté à rendre compte de ce pur devenir. À ce moment précis en effet, la vieille opposition entre vie et mort ne tient plus : seuls persistent le mouvement et le changement. Dans le système des images grotesques formalisé par Mikhaïl Bakhtine, la mort est « incluse dans la vie et, parallèlement à la naissance, détermine son mouvement perpétuel » (1970, 59). Le lexème anglais « dead », avec sa symétrie presque parfaite, ne matérialise‑t‑il pas la différance derridienne et l’instabilité consubstantielle à l’écriture comme à la vie ? Le recueil d’Evenson Fugue State (2009), dont le titre des plus pertinent suggère tant le statut d’un corps en fuite qu’une identité trouble, en livre un remarquable exemple dans la nouvelle « Bauer in the Tyrol ». Le personnage éponyme, sculpteur et dessinateur, partage une chambre avec sa femme, qu’il considère sur le point de mourir :
There was, he argued with himself in the morning, looking at his wife sprawled in the bed, no real moment between dead and not dead for the body, for the body was changing, always changing […]. As he worked, as he destroyed the slender plaster figures one after the other, then built them up again, then destroyed them again, he found himself turning to look at her, her closed eyes, her face. The structure of her face seemed to have changed, he thought, the skin wrinkling differently, and it was hard to think of her in the same way, as the same woman […]. The maid’s face, he saw, was the same as it had been yesterday […]. Only his wife’s face was changing. (130‑131)
La syntaxe de la première phrase reflète l’impossible césure entre vie et mort par des relances permanentes, jouant en particulier sur l’évolution de la nature grammaticale de « for », préposition ou conjonction de coordination : la structure répétée au mot près puis prolongée avec un sens totalement différent restitue les changements subtils mais réels ayant cours exceptionnellement lors de la thanatomorphose. La transformation de « was » en « sprawled » puis « always » dans le dernier segment de la phrase signifie le passage de l’essence à l’éternel devenir qui se cristallise autour du corps gisant. L’homme se trouve incapable de saisir les traits de sa femme. Ce qui s’approche le plus d’une figuration mimétique est paradoxalement l’alternance continue entre création et destruction de l’œuvre, captant à la perfection cette corrélation de la mort avec la naissance dans l’imaginaire grotesque. Après avoir abandonné le plâtre pour le crayon, Bauer constate sur la feuille même ces « [n]aissance‑mort, mort‑naissance [qui] sont », selon Bakhtine, « les phases déterminantes (constitutives) de la vie même » (1970, 59) :
[…] looking down at the paper he realized, through the haze of lines, that every image was being destroyed but in that destruction something was arising unlike anything he had ever seen. A bed, a harrow of lines, the many ghosts of his wife, and all of them somehow, in their erasures and obscurements, beginning to add up to his wife herself. (133)
La variation polyptotique entre « destroyed » et « destruction » rend manifeste par une élégante mise en abîme que la destruction n’est jamais un terme final, de même que « le véritable grotesque n’est nullement statique » : « il s’efforce au contraire d’exprimer dans ses images le devenir, la croissance, l’inachèvement perpétuel de l’existence ». Se retrouvent ainsi condensés « les deux pôles du devenir, à la fois ce qui s’en va et ce qui vient, ce qui meurt et ce qui naît ; il montre deux corps à l’intérieur d’un seul » (1970, 61‑62). Plus de destin biologique : le devenir s’affirme. Afin de témoigner au mieux de ce mouvement perpétuel, le corpus evensonien privilégie le flou à la linéarité. La désorientation est ainsi suscitée par les échos déstabilisants tissés entre « Bauer in the Tyrol » et le récit au titre presque anagrammatique « Traub in the City », situé une soixantaine de pages plus loin. Traub, dans une auberge, fait similairement l’expérience de la confrontation à une mort synonyme de métamorphose :
Traub continued trying to draw the profile, but the face was changing with such rapidity that he could capture it, when he captured it at all, only at several removes. He had the distinct impression that he was observing not one but several faces, coming one after another, quicker and quicker until finally, moments before death, the rush of faces was so rapid that it made Traub feel dizzy, and he forgot the paper, the pencil, and in the vast shuffle of humanity nearly caught sight of himself. Days later, […] [o]n the platform in the metro, surrounded by hundreds of people, he saw nothing but a series of heads, […] each face in the crowd part and parcel of a single face that was changing with a rapidity he could no longer comprehend – as if a progression in time had been instead smeared out over space, all the faces of the city a record of one man’s death. (2009, 191‑192)
Le vertige de Traub devient celui du lecteur, renforcé par les auto‑corrections qui induisent, dans la première phrase, de mauvaises interprétations : le lecteur est forcé, comme Traub, de constamment ajuster sa vision. La puissance du devenir est telle qu’elle déborde la temporalité et se répand dans l’espace à la fois diégétique et matériel du livre même. C’est ce qu’intime, avant même les apparitions dans le métro, le sens éminemment spatial de « removes », ce retrait que le cadavre impose à la mimesis. Michael Marder explique que la poussière, trace de la putréfaction, constitue une jauge spatiale du temps, jouant le rôle de ce que Derrida a baptisé la différance : une spatialisation du temps et une temporalisation de l’espace conjointes (2017, 38). La poussière, comme la tête changeante que voit Traub, est le débordement du temps lâché contre l’ordre statique spatial (2017, 43) : la tache que Traub envisage, cet excès qui se déverse tout à coup dans l’espace alentour[11]. De cette implacable spatialisation naît la possibilité d’un contact, d’une mise en relation, même à distance. Bauer note : « he had entered a new space […]: being with this woman who was dying had put him up against life in a different way, […] perhaps simply revealed that what he had always seen as sharp and clear – what the eye saw – was hardly clear at all » (2009, 132). Les conséquences sont considérables en termes poétiques : « It was, he told himself, the inauguration of a new aesthetic moment » (132). L’esthétique relève étymologiquement de la perception physique : la sensation a bel et bien pris le pas sur la mimesis. Soulignons toutefois que la mise en relation matérielle paradoxalement permise par la thanatomorphose est bien plus large : il s’agit, comme y fait allusion Traub, d’un contact plus profond avec l’humain, avec le vivant et le monde. La négation du verbe polysémique « comprehend » est révélatrice : la compréhension intellectuelle s’incline devant l’expérience de la réunion effrénée de tous les êtres et de tous les éléments constitutifs de la vie. En témoignent chez Evenson la multiplication de vieilles demeures dont les façades pèlent telles des peaux brûlées ou s’effritent tels des os blanchis par le soleil[12] : le redoublement anthropomorphique survenant sous la forme d’une putréfaction vient souligner l’appartenance de l’humain au tissu du monde. Ces bâtisses littéralisent la thèse de Merleau‑Ponty selon laquelle « corps et choses sont enveloppés dans une seule et même chair » (Ghitti, 2009, 294). Ainsi que le résume Jean‑Marc Ghitti, pour le philosophe Merleau‑Ponty, la « relation charnelle consiste à se retrouver soi‑même dans le monde […], si bien que voir hors de soi, c’est voir en soi » et que « c’est en elle‑même que la main touche » (2009, 295‑296). Que Traub ne voit plus des visages mais un florilège de têtes est fort significatif : cette défiguration signe le passage à un devenir animal de l’humain[13], qui rejoint à travers la putréfaction non seulement, en termes bakhtiniens, « la vie du grand corps de l’ensemble du peuple » (1970, 59), mais du vivant.
Face à ces purs devenirs qui émergent de la thanatomorphose, toute vision totalisante devient inenvisageable : à la représentation transcendante se substitue le rabaissement grotesque, « c’est‑à‑dire le transfert de tout ce qui est élevé, spirituel, idéal et abstrait sur le plan matériel et corporel, celui de la terre et du corps » (Bakhtine, 1970, 29). Le cadavre qu’approche Rudd dans The Open Curtain n’est pas sans raison celui de Mrs Frohm, homonyme de la préposition anglaise de l’origine : en attirant ses lecteurs au sein d’une œuvre célébrant la putréfaction, la prose d’Evenson nous plonge dans la matière même de nos origines, cet humus qui nous lie à l’ensemble du vivant. Comme le remarque Bakhtine, « les frontières nettes et inertes qui partagent ces “royaumes de la nature” dans le tableau habituel du monde » sont « dans le grotesque […] audacieusement violées » (1970, 41) : « [à] la différence des canons modernes, le corps grotesque n’est pas démarqué du restant du monde, n’est pas enfermé, achevé ni tout prêt, mais il se dépasse lui‑même, franchit ses propres limites » (1970, 35). L’accent étant mis sur les parties du corps soulignant une « ouvert[ure] au monde extérieur, c’est‑à‑dire où le monde pénètre en lui ou en sort, soit sort lui‑même dans le monde » (1970, 35), les orifices et les plaies de la peau jouent un rôle essentiel. Le contact que propose le livre n’est ainsi pas seulement synesthésique, mais social et environnemental : il tend à conjurer la coupure « qui sépare un groupe de ses morts », précédant selon Baudrillard celles « entre le sujet et son corps séparé, entre l’individu et le corps social séparé » (1976, 200‑201). Cette fascination pour la solitude se généralise pour le philosophe au XVIe siècle à travers l’influence du christianisme, de sorte que l’iconographie grotesque permet de renouer avec le « théâtre collectif de la mort » (1976, 223) ayant encore cours au Moyen Âge. Autour de l’enfant trouvée morte dans la boue par son père, au sein de la nouvelle « The Father, Unblinking », l’univers entier semble en effet se rassembler :
He had that day found his daughter dead from what must have been the fever, her swollen eyes stretching her lids open. […] He had found his daughter facedown in the sun‑thick mosquito‑spattered mud, by the back corner, where the dark paint had started taking air underneath and was flaking off the house now and falling apart at a touch like burnt turkey skin. He squatted over her and turned her up, and she came free with a sucking, the air coming out of her in a sigh, blowing bubbles of mud on her lips. […] He worked at bending the body straight until the muck on her face dried ashy, then cracked.
He slapped mosquitos dead on her. He picked her up […]. He ducked under the window, hurried past the worn back stoop with the door at the top of it. He kicked hens and chicks out of the way, booting loose turbid clouds of pinfeathers. Hooking the barn door with his boot, he hop‑skipped back until it was open wide enough to let his foot free and for him to shoulder himself and his girl in. It was quiet inside, and dark except for the shafts of light from the roof traps, four long pillars of bright dust descending to the scatterings of hay below. (2002a, 3)
Aucune effusion sentimentale, une simple constatation qui met en action le corps du père, au milieu de cette effervescence où s’agitent moustiques et volailles. Le découpage original du texte, en isolant « must » au bout de la première ligne, met en avant moisi et moût plutôt que diagnostic médical : aucune autre certitude que le mouvement incessant de la vie et de la matière tout à la fois malgré et grâce à la chute littérale de ce cadavre. Le cosmos est au chevet de ce corps pris dans la boue, tout autant cercueil que berceau : la terre et l’eau bien évidemment, l’air, qui s’échappe des lèvres de l’enfant mais qui travaillait déjà la peinture, et le feu, puisque même la maison pèle et s’effrite comme une dinde trop cuite. Tout retourne à la terre, entre vie et mort, jusqu’aux colonnes de poussière qui descendent dans la grange depuis les ouvertures pratiquées dans le toit : loin de la vision classique d’ascension spirituelle esquissant un temple dans les cieux, l’ébullition créatrice que la mort ne saurait interrompre est ici l’image d’un rabaissement grotesque à la matière. C’est bien cette dernière qui change d’état et se met à craquer, malgré la subtile ambiguïté syntaxique qui place le père au début de la phrase (« He worked […] then cracked »).
L’altération se fait sentir d’un paragraphe à l’autre : embourbées, les premières phrases sont allongées, traînantes et répétitives (« He had that day found his daughter […]. The day had been a bright day […]. He had found his daughter […] »), abritant des compositions agglutinées allitératives (« facedown », « sun‑thick mosquito‑spattered »). Tout comme la nouvelle « Traub in the City » revitalise par la réécriture son pendant « Bauer in the Tyrol », les subtiles variations lexicales de « must » à « mud », « muck » et « duck » témoignent du pouvoir régénérateur d’une œuvre de la putréfaction. Le paragraphe suivant présente ainsi une succession de verbes d’action et de mouvement dans une prose davantage paratactique, craquelée. La métamorphose qui caractérise le grotesque affecte le voisin, dont le visage évoque la chair d’un vieux lapin mis à mort trop tard (5), et surtout le père, dont les gestes le rattachent à la basse‑cour (« ducked », « stoop »). Cette altération presque ovidienne est probablement le fruit de la confrontation à la mort et au cadavre, soulignée par la multiplication des <oo> comme autant de paires d’yeux. D’après Julia Kristeva, le cadavre « bouleverse plus violemment encore l’identité de celui qui s’y confronte comme un hasard fragile » :
Une plaie de sang et de pus, ou l’odeur doucereuse […] d’une putréfaction, ne signifient pas la mort. Devant la mort signifiée – par exemple un encéphalogramme plat – je comprendrais, je réagirais ou j’accepterais. Non, tel un théâtre vrai, sans fard et sans masque, le déchet comme le cadavre m’indiquent ce que j’écarte en permanence pour vivre. […] J’y suis aux limites de ma condition de vivant. De ces limites se dégage mon corps comme vivant. (1980, 11)
L’œuvre d’affect qui accueille la thanatomorphose, par les bouleversements d’une mort abjecte défiant toute mimesis et toute signification, rend possible une réelle altération du lecteur, son retour à une communauté charnelle avec le monde[14]. Les fluides pestilentiels s’écoulant depuis les orifices du cadavre sont « autant d’indices d’un inachèvement foncier et d’un processus permanent d’échange et d’altération » (Rosen, 1991, 124), pour le corps chu comme pour celui qui y fait face. Des probables piqûres de moustiques aux traces de boue sur la bouche, en passant par les bulles qui s’échappent des lèvres, la scène de la découverte du corps figure les points de passage entre le dedans et le dehors. Les yeux gonflés de la fillette, dont les paupières sont condamnées à rester ouvertes, retiennent plus particulièrement l’attention du père : ils apparaissent dès la première mention du corps, avant même le récit de son retournement. Le rapprochement immédiat avec le titre rend sensible l’altération et l’affect du père que le texte se refuse à signifier par un pathos classique et attendu. S’en suivra l’altération du lecteur, confronté à la putrescence visuelle de cette « peau de mots », selon l’expression de Didier Anzieu, que constitue le texte. La poussière, qu’il s’agisse des colonnes dans la grange matérialisant les rayons du soleil ou des minuscules détails d’un texte décomposé en lettres, constitue l’invisible condition de la vue (Marder, 2017, 24) : en s’offrant brusquement au regard, elle invite finalement à embrasser le monde dans toute sa diffé‑rance et son instabilité. Le corps présenté par cette fiction se voit littéralement libéré (« she came free »), celui de son témoin à sa suite (« foot free »). Ils se trouvent au moins momentanément délivrés des représentations traditionnelles ordonnées du pouvoir (Rosen, 1991, 20), qui privilégient les contours nets et francs « mettant l’accent sur [leur] autonomie et [leur] individualité, sur ce qui le[s] distingue d’autrui et du monde, [les] isole et le[s] singularise » (Rosen, 1991, 124). Le grotesque tel qu’il s’exhibe ici « détien[drait] un véritable pouvoir positif », permettant « d’explorer […] les possibles d’une utopique liberté dans les mœurs comme dans la pensée » (Rosen, 1991, 124). Pores et prose, par les béances des corps, esquisseraient la voie d’un monde plus ouvert. Les magnifiques <o> autour desquels ils s’érigent figurent non seulement le cycle du vivant mais sa communauté, enfin réunie grâce à l’irrésistible porosité de son tissu.
CONCLUSION
Les connotations morales accompagnant les termes renvoyant à la putréfaction, à l’image de « rance » et « corrompu », révèlent que beaucoup se joue en termes de représentation lors de ce moment critique où menace de s’imprimer sur la peau la mortalité de l’humain. Privilégier à la vision de la peau comme interface celle de barrière, séparant la vie et la mort mêmes, permet aux figures religieuses, scientifiques et administratives intermédiaires désormais indispensables d’accéder au pouvoir et à l’autorité, notamment discursive. Une telle médiation est en tout point contraire à l’esthétique de Brian Evenson, bien conscient du pouvoir d’incarnation d’un langage pouvant s’avérer violemment normatif et réducteur. Transcendance et savoirs totalisants sont ainsi écartés de sa fiction, éminemment ouverte. En mettant en œuvre dans sa prose putrescente des mots morts‑vivants qui retiennent l’œil du lecteur dans le tissu du texte, Evenson conjure la séparation de la mort et du vivant d’où découlent selon Baudrillard celle de l’humain vis‑à‑vis de son corps, et celle de l’individu vis‑à‑vis du corps social. Peut alors à travers cette « peau de mots » en putréfaction émerger une littérature du contact, tant physique que collectif et environnemental : l’œuvre de sensation, débarrassée de la distance sécurisante imposée par la mimesis, favorise non seulement l’interaction intensive du lecteur avec l’objet livre, mais avec le vivant dans toute sa diffé‑rance. La définition anglophone de la putréfaction insistant contrairement au français sur l’odeur émise, elle témoigne d’une sensorialité paradoxalement décuplée au moment du cheminement vers la mort : potentiel ô combien précieux pour un corpus à velléités synesthésiques.
L’œuvre littéraire entretient un rapport des plus singulier à la lie et à la terre. Rappelons ainsi à toutes fins utiles que la lecture est étymologiquement liée au recueil des ossements du mort. Et de fait, on ne saurait imaginer un matériau artistique plus corrompu que le langage, profondément instable, utilisé à tort et à travers en chaque instant. Malgré toutes les interventions pratiquées sur les corps en vue de leur aseptisation, la langue inscrit en chacun d’entre nous un reste irréductible de putréfaction[15]. À la suite du jeu de mot joycien glissant de la lettre « letter » à l’ordure « litter », Lacan fait une litière de la littérature, une « lituraterre » (1971, 3). La langue maternelle s’en trouve irrémédiablement souillée. Le titre de la nouvelle « Mudder Tongue » (2009) de Brian Evenson semble jouer sur l’embourbement de la formule anglaise « mother tongue », comme si l’écriture réclamait plus de boue encore. Nulle surprise donc à ce que l’œuvre lieterraire mineure de cet écrivain s’ouvre en 1994, dès les premières lignes du premier récit de son premier recueil, sur le corps d’une pauvre enfant dont la peau rejoint dans la boue l’altérité la plus radicale.
BIBLIOGRAPHIE
Anzieu D., (1995), Le Moi‑peau, Paris : Dunod.
Arasse D., (1996), Le Détail : Pour une histoire rapprochée de la peinture, Paris : Flammarion.
Bakhtine M., (1970), L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen‑Âge et sous la Renaissance, Paris : Gallimard.
Barthes R., (1996), La chambre claire : Note sur la photographie, Paris : Gallimard.
Barthes R., (1977), Fragments d’un discours amoureux, Paris : Seuil.
Baudrillard J., (1976), L’échange symbolique et la mort, Paris : Gallimard.
Blanchot M., (1955), L’espace littéraire, Paris : Gallimard.
Deleuze G., (1993), Critique et Clinique, Paris : Les Éditions de Minuit.
Deleuze G., (1994), Francis Bacon : Logique de la sensation I et II, Paris : Éditions de la Différence.
Evenson B., (2002a), Altmann’s Tongue, Lincoln : University of Nebraska Press.
Evenson B., (2015), Contagion, University of South Dakota : Astrophil Press.
Evenson B., (2002b), Dark Property: An Affliction, New York : Thunder’s Mouth Press.
Evenson B., (2004), The Wavering Knife, Tallahassee : Fiction Collective Two.
Evenson B., (2006), The Open Curtain, Minneapolis : Coffee House Press.
Evenson B., et Sally Z., (2009), Fugue State, New York : Coffee House Press.
Evenson B., (2012), Windeye, Minneapolis : Coffee House Press.
Evenson B., (2016), A Collapse of Horses, Minneapolis : Coffee House Press.
Evenson B., (2019), Song for the Unraveling of the World, Minneapolis : Coffee House Press.
Ferrari F., et Nancy J.‑L., (2002), Nus Sommes : La peau des images, Bruxelles : Yves Gevaert.
Flaubert G., (1974‑1976), Œuvres complètes de Gustave Flaubert ; 13‑16. Correspondance. [2]. 1850‑1859, Paris : Club de l’honnête homme.
Forest P., (2007), Le Roman, le réel et autres essais, Nantes : Éditions Cécile Defaut.
Ghitti J.‑M., (2009), « Maurice Merleau‑Ponty. Le lieu à l’œuvre dans la pensée ». Dans T. Paquot et C. Younes (dir.), Le territoire des philosophes : Lieu et espace dans la pensée au XXe siècle, 289‑305. Paris : Éditions La Découverte.
Goodwin G. H., (2005, février), « An Interview with Brian Evenson », Bookslut.
Kristeva J., (1980), Pouvoirs de l’horreur : Essai sur l’abjection, Paris : Seuil.
Lacan J., (1971), « Lituraterre ». Littérature, n°3, 3‑10.
Lecercle J.‑J., (1996), La violence du langage (traduit par M. Garlati). Paris : Presses Universitaires de France.
Marcus B., (date non communiquée), « Brian Evenson by Ben Marcus », Web del Sol. http://www.webdelsol.com/evenson/beven.htm
Marder M., (2017), Dust, New York & London : Bloomsbury.
Meekren J., (1682), Observationes Medico Chirurgicae [gravure], Dans J. Meekren, Observationes medico‑chirugicae, Amsterdam : Henrik & Theodore Boom.
Nietzsche F., (2002), Généalogie de la morale, Paris : Flammarion.
Nolen L., (2009, 1er février), « Interview with Brian Evenson », The OF Blog. http://ofblog.blogspot.com/2009/02/interview‑with‑brian‑evenson.html
Peak D., (2021, 11 novembre), « Bookforum talks with Brian Evenson about his new story collection,The Glassy, Burning Floor of Hell », Bookforum. https://www.bookforum.com/interviews/bookforum-talks-with-brian-evenson-about-his-new-story-collection-the-glassy-burning-floor-of-hell-24694
Proust M., (1954), Contre Sainte-Beuve, Paris : Folio.
Rosen E., (1991), Sur le grotesque. L’ancien et le nouveau dans la réflexion esthétique, Saint‑Denis : Presses Universitaires de Vincennes.
Treon M., (2012, 31 juillet), « Interview : Brian Evenson and the Weird », Weird Fiction Review. https://weirdfictionreview.com/2012/07/interview-brian-evenson-and-the-weird/
[1].↑. Le double‑sens corporel du terme « peel » se voit souligné dans la scène par le rituel mormon suivant l’installation des spectateurs ici décrite, consistant à mimer les sévices auquel sera soumis le corps en cas de révélation d’informations secrètes : « The men started to peel away to the left, the women to the right » (p. 149).
[2].↑. Citons l’exemple de la nouvelle « Any Corpse » : « A finger there, but stripped mostly of skin and the nail and bits of its meat gone » (2016, 168).
[3].↑. On peut ainsi lire : « He folded the jaws of the satchel together, closed the clasp. Removing himself to the sink, he stripped off gloves as if layers of skin, discarded them. […] His smiled was disjoint and twisted. […] He approached a bin in the corner, depressed its pedal. The lid gaped, disjointed its jaw » (79‑80 ; je souligne).
[4].↑. Le lien entre les documents papier et les corps est sous‑entendu par le recours à des métaphores organiques : « He unfolded the paper, faced the scrawl of its innards toward Kline. He pointed to an emblazon disfiguring the head » (Evenson, 2002b, 87).
[5].↑. On notera, en lien avec ces réflexions foucaldiennes, que le robot, image d’un corps docile et utile, répond également aux exigences économiques du pouvoir.
[6].↑. Brian Evenson évoque en entretien l’oscillation au‑dessus de l’abîme permise par la langue, en accord avec l’« Être‑jeté » heideggérien qui constitue l’épigraphe en version originale de Dark Property : « The original quote, in one translation, is “The sentence, ’Language is language,’ leaves us to hover over an abyss as long as we endure what it says.” […] I’m deliberately eliding that to expand it to make a statement about what sentences can do. […] For me, in terms of thinking about writing, the sentence is something that allows us to hover over the abyss. […] [I]t’s also true that language is the thing we dwell in as much or perhaps more than the actual world (since so much of our understanding of the world is mediated by it). So much of my work is about opening up that abyss below the feet of my readers, to give them a sense of that vertiginous feeling and danger […]. I think of language as being experiential and intensive as well as communicative » (Peak, 2021).
[7].↑. Baudrillard fait la distinction entre le destin de la peau et de la chair, et celui des os : « Déjà les os […] retrouvent la force du masque et du signe. Mais entre les deux, il y a ce passage abject par la nature et le biologique, qu’il faut conjurer à tout prix par des pratiques sarcophagiques (dévoreuses de chair) qui sont en fait des pratiques sémiurgiques » (1976, 274).
[8].↑. Baudrillard précise dans une note que « [l]es hérésies seront toujours la remise en cause de ce “Royaume de l’au‑delà” » : « [n]ier l’arrière‑monde, c’est nier aussi la coupure d’avec les morts, et donc la nécessité d’en passer par une instance intermédiaire pour établir commerce avec eux. C’est la fin des Églises et de leur pouvoir » (1976, 200).
[9].↑. Julia Kristeva explique dans Pouvoirs de l’horreur que « [c]e n’est donc pas l’absence de propreté ou de santé qui rend abject, mais ce qui perturbe une identité, un système, un ordre. Ce qui ne respecte pas les limites, les places, les règles. L’entre‑deux, l’ambigu, le mixte » (1980, 12).
[10].↑. Le réel est pour Forest « solidaire du concept d’“impossible ” » (2007, 50). On notera à cet égard les innombrables répétitions de « No » et de « nothing » dans le dialogue.
[11].↑. Marder résume : « Dust is at home in non‑linear, non‑sequential time; everything obtains in it all at once, in the babel of the past, the present and the future. Such synchronicity borders on spatiality (as Immanuel Kant sees in his first Critique), which makes sense to those who recall that dust is spatialized time and temporalized space » (2017, 46).
[12].↑. On pourra se référer par exemple à « The Father, Unblinking » (2002a, 3), « Windeye » (2012, 1), « Leaking Out » (2019, 12) ou encore « Song for the Unraveling of the World » (2019, 28).
[13].↑. Deleuze consigne dans Logique de la sensation : « Bacon est peintre de têtes et non de visages. Il y a une grande différence entre les deux. Car le visage est une organisation spatiale structurée qui recouvre la tête, tandis que la tête est une dépendance du corps […]. Ce n’est pas qu’elle manque d’esprit, mais c’est un esprit qui est corps, souffle corporel et vital, un esprit animal » (1994, 19).
[14].↑. Brian Evenson déclare : « I think of reading as an intensive experience, as something you undergo or live through, as something that has an effect on you and changes you in a similar way to what lived experience does. Since I think of fiction that way, I’m less worried about what it depicts (i.e. whether it depicts an accurate, mimetic representation of reality) than about what it does to the reader » (Treon, 2012).
[15].↑. Jean‑Jacques Lecercle développe dans son ouvrage La violence du langage une théorie du « reste », fondée sur le constat que « la langue est un mélange impur » (1996, 133).