La Peau et la Trace
sur les blessures de soi
Le Breton D.
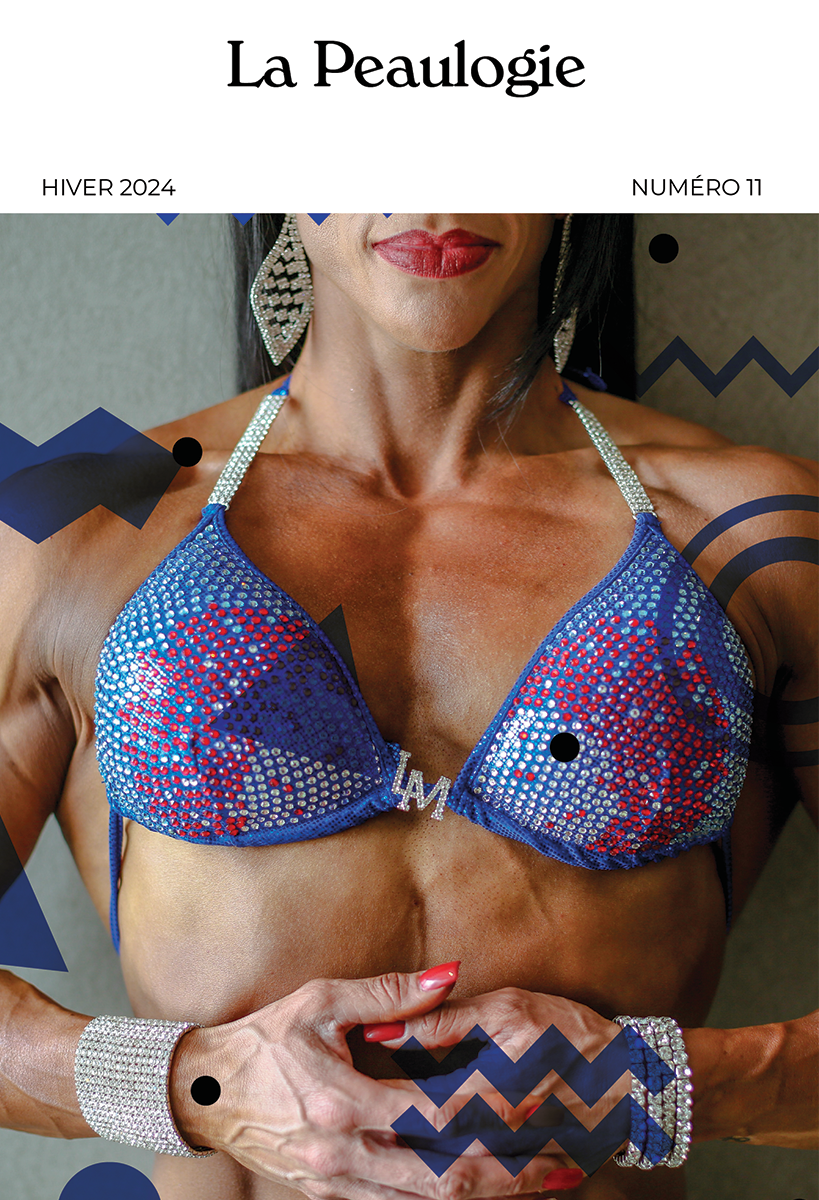

La Peau et la Trace
sur les blessures de soi
Le Breton D.
Le Breton D., (2003), La Peau et la Trace.sur les blessures de soi, Paris : Métailié, 144 p., ISBN : 2-86424-466-7
Compte rendu de Romane Blaise
Référence électronique
Blaise R., (2024), « La Peau et la Trace », La Peaulogie 11, mis en ligne le 28 octobre 2024, [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/peau-trace
La Peau et la trace est un essai documenté de témoignages analysant les raisons et l’impact des traces (blessures cicatricielles) sur notre peau. L’ouvrage vise à élucider la manière dont « les entames corporelles sont un moyen ultime de lutte contre la souffrance, [renvoyant] à un usage de la peau qui en fait aussi des signes d’identité » (p. 9). L’auteur analyse le recours à la souffrance corporelle comme une forme d’accouchement de soi, celui‑ci agissant alors en une maïeutique de la souffrance psychologique destinée à réunifier le corps et l’esprit des individus « non par choix, mais par nécessité intérieure » (p. 11). Il s’agirait alors de « payer le prix de la souffrance pour essayer de s’en extirper, s’acquitter d’une demande écrasante mais qui permet d’échapper à l’horreur » (p. 12).
Au fil de ses analyses, David Le Breton souligne le fait que les atteintes corporelles symbolisent des maux traduisant l’histoire, les souffrances intérieures et les circonstances dans lesquelles l’individu se scarifie. Par exemple, une automutilation visible sur les avant‑bras ou les cuisses, endroits facilement accessibles, rappelle le contrôle exercé sur soi et le besoin de l’individu de revendiquer la maîtrise qu’il a de son propre corps. Il est néanmoins important de garder en tête que « l’intention n’est pas de se rayer du lien social, mais justement de se purifier d’une souffrance pour y revenir. Lorsque le visage est attaqué, le pronostic est plus grave. L’individu commence à perdre pied et coupe les ponts derrière lui » (p. 13). Si dans notre société occidentale les mutilations sont un tabou, il n’en est pas de même dans toutes, notamment aux Etats‑Unis où le sujet est traité sans moralisme, et où de nombreuses ressources et recherches existent sur le sujet. Ainsi le recueil ‑publié en 2003‑ ne relève pas de jugements sur les actes d’individus, mais bien d’analyses, aujourd’hui étayées de recherches plus actuelles.
Dans cet essai, les individus présentés par David Le Breton ne sont pas malades et ont conscience que leur démarche trouble les autres ; pour autant le recours à la souffrance corporelle est le seul moyen capable d’apaiser leurs maux, la seule issue qui leur permette de continuer à existe (chapitre 1). Dans certains lieux tels que les prisons, ce type de comportement est plus que fréquent : pour les détenus il est important de lutter contre le manque des leurs, contre l’enfermement, contre une conception souvent immatérielle du temps, et contre une souffrance inéluctable (chapitre 2).
À la nécessité d’expier la souffrance, décrite sur le terrain carcéral, s’entremêle parfois, dans le récit de certains artistes, la nécessité de création. Celle‑ci se retrouve dans des oeuvres mettant en scène l’altération corporelle et interrogeant notamment les notions de body art et de performance (chapitre 3).
Par ces analyses croisées, David Le Breton insiste sur l’importance du sentiment identitaire, au sens ontologique du terme, de chaque personne. Ce sentiment évolue au fil de l’existence de chacun, et est soumis à l’air du temps, comme mis à l’épreuve face aux événements de la vie. L’adolescence apparaît, dans de nombreuses études, par une période de flottement du sentiment de soi : « L’éveil du désir, l’interrogation du féminin et du masculin, l’entrée dans la sexualisation sont alors perçus comme autant de dangers menaçant l’intégrité déjà difficilement élaborée du Moi » (p. 23). En parallèle, si l’auteur relève un nombre important de jeunes s’auto‑infligeant des blessures, cela est dû au fait qu’à cette période le corps change, tant dans sa forme que dans sa fonction ; il constate alors que « le propos récurrent de jeunes disant après un tatouage ou un piercing qu’ils se sont « réappropriés » leur corps atteste bien la nécessité chez eux d’un détour symbolique pour accéder au sentiment d’être soi » (p. 24).
Dans cette même idée de quête d’identité à travers la souffrance corporelle, l’auteur insiste sur le fait que la peau est, pour chaque individu, un palimpseste dont lui seul détient la clé ; en effet « la peau est une barrière, une enveloppe narcissique qui protège du chaos possible du monde. Porte que l’on ouvre ou ferme à son gré, mais souvent aussi à son insu. Elle est un écran où l’on projette une identité rêvée, comme dans le tatouage, le piercing, ou les innombrables modes de mises en scène de l’apparence qui régissent nos sociétés. Ou, à l’inverse, une identité insupportable dont on voudrait se dépouiller et dont les blessures corporelles auto‑infligées sont l’indice » (p. 25). L’expression « être mal dans sa peau » est à prendre dans certains cas au sens littéral du terme. Il est important de remarquer que ce mal‑être est souvent le fruit des diktas sociétaux. En effet, dans son livre, David Le Breton aborde le cas des femmes qui prennent sur elles la détresse intérieure qui les habitent, pourtant « en retournant sa souffrance contre sa propre peau, la femme récuse aussi le modèle de séduction qui l’étouffe et qui fait de son apparence le critère d’évaluation majeur de ce qu’elle est » (p. 31). Aujourd’hui il est important de rappeler que cette pression sociale, exercée dans une société patriarcale par les hommes‑cisgenre envers les personnes sexisées, ne se répercute pas seulement sur les femmes cisgenres, mais également sur tous ceux et celles qu’ils considèrent comme inférieurs et moins légitimes qu’eux : les personnes lesbiennes, gays, queers, transgenres, bies, etc. Dans ces cas, le recours à l’automutilation, peut se traduire par un besoin de réappropriation de son corps et de sa place légitime au monde, ou bien comme l’extériorisation nécessaire ‑voire la visibilisation‑ d’une douleur : « les atteintes corporelles sont des cris délivrés dans la chair à défaut de langage » (p. 34). Rythmée par de nombreux témoignages, cette partie de l’essai souligne l’ambivalence de la souffrance corporelle. Soulageant des maux sur lesquels les individus ne peuvent pas mettre de mots, le recours à la souffrance autorise un court répit à la souffrance émotionnelle. Loin d’être un chemin vers la mort, l’automutilation s’inscrit alors, dans ce contexte, comme un acte vital et vindicatif.
Pour illustrer cette vision du corps comme champ de bataille intime, l’auteur choisit d’aborder dans son second chapitre l’exemple des détenus. Dans les prisons, les détenus ne possèdent plus que leur corps pour exprimer leur existence. Entrer en prison, c’est se faire déposséder de soi, psychologiquement autant que matériellement. Le détenu se voit retirer ses effets personnels et son corps est enfermé, c’est une « réduction du corps à l’impuissance, privation de mouvements, promiscuité entre détenus, exiguïtés des cellules, violences physiques ou sexuelles éventuelles » (p. 85). En l’absence de toute intimité, les individus emprisonnés ne voient que la blessure corporelle comme dernier recours pour être considérés comme sujets plutôt que comme détenus. Dans d’autres cas, la souffrance est ritualisée. Ces détenus utilisent leur corps comme « mémorial de la douleur » et s’automutilent notamment « les jours ou les mois qui scandent les anniversaires des épisodes pénibles de leurs existences » (p. 93). Ces blessures auto‑infligées calment un instant leur peine en jugulant un flux de souffrance, et en réattribuant le contrôle sur leur corps.
Enfin, le dernier chapitre de l’essai s’intéresse aux performances artistiques durant lesquelles certains artistes ont recours à la mutilation corporelle. Cette « mise en corps de l’art » (p. 100) ouvre la voie à une analyse des revendications sociales, culturelles et politiques au travers de l’engagement personnel des artistes. Les performances ne se limitent pas à un rôle esthétique, elles sont un discours sur notre monde ; « elles interrogent avec force l’identité sexuelle, les limites corporelles, la résistance physique, les représentations du masculin ou du féminin, la sexualité, la miction ou l’excrétion, la douleur, la mort, la relation aux objets, l’espace, la mise en danger de soi… » (p. 100). Dans son travail, l’auteur cite notamment les performances de Gina Pane. Pour elle, « se faire mal » n’est pas une question de masochisme, elle perçoit la douleur comme un don capable de guérir et de délivrer : « Gina Pane met en scène un sacrifice en offrant elle‑même sa douleur pour prix d’une conscience élargie de la souffrance des autres et dans une perspective symbolique de la diminuer » (p.105). Finalement, à l’instar des automutilations intimes, les performances artistiques apparaissent comme cathartiques ; exceptées que les premières ont une portée individuelle, quand les secondes ont une portée universelle.
Néanmoins, David Le Breton choisit de distinguer et d’opposer les performances artistiques de Gina Pane, ‑ce qu’il appelle body art‑ des performances publiques, notamment des suspensions, comme celles de Stelarc ou de Bob Flanagan. Pour lui, un performer se situe « en retrait des instances sociales, plutôt entouré d’hommes ou de femmes qui partagent sa quête, l’ont déjà vécue, ou se préparent à la connaître » (p. 112). Les suspensions sont une quête de sens et de sensations amenant le performer aux limites de la condition humaine. C’est une expérimentation de la douleur volontaire, une thérapie par la souffrance, à l’instar des performances artistiques qui agissent comme une critique active du monde.
Que ce soit pour extérioriser une souffrance émotionnelle ou psychologique dont il est difficile de parler, que ce soit pour reprendre le contrôle de leur corps grâce à des marques corporelles (tatouages, piercings,…), ou bien pour traduire un message politique ou social par le biais de la performance artistique ; l’ouvrage de David Le Breton met en relief les modalités d’exercice de la souffrance comme moyen d’expression symbolique et cathartique par la douleur. Le corps, ainsi considéré, reste pour tout individu un champ de bataille de l’identité. Il lui permettra de trouver sa place dans le monde « mais parfois non sans turbulence et non sans l’avoir malmené » (p. 134).