Référence électronique
Bay A., (2025), « Tattoo flash vs creation », La Peaulogie 12, mis en ligne le 14 février 2025, [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/flash-creation
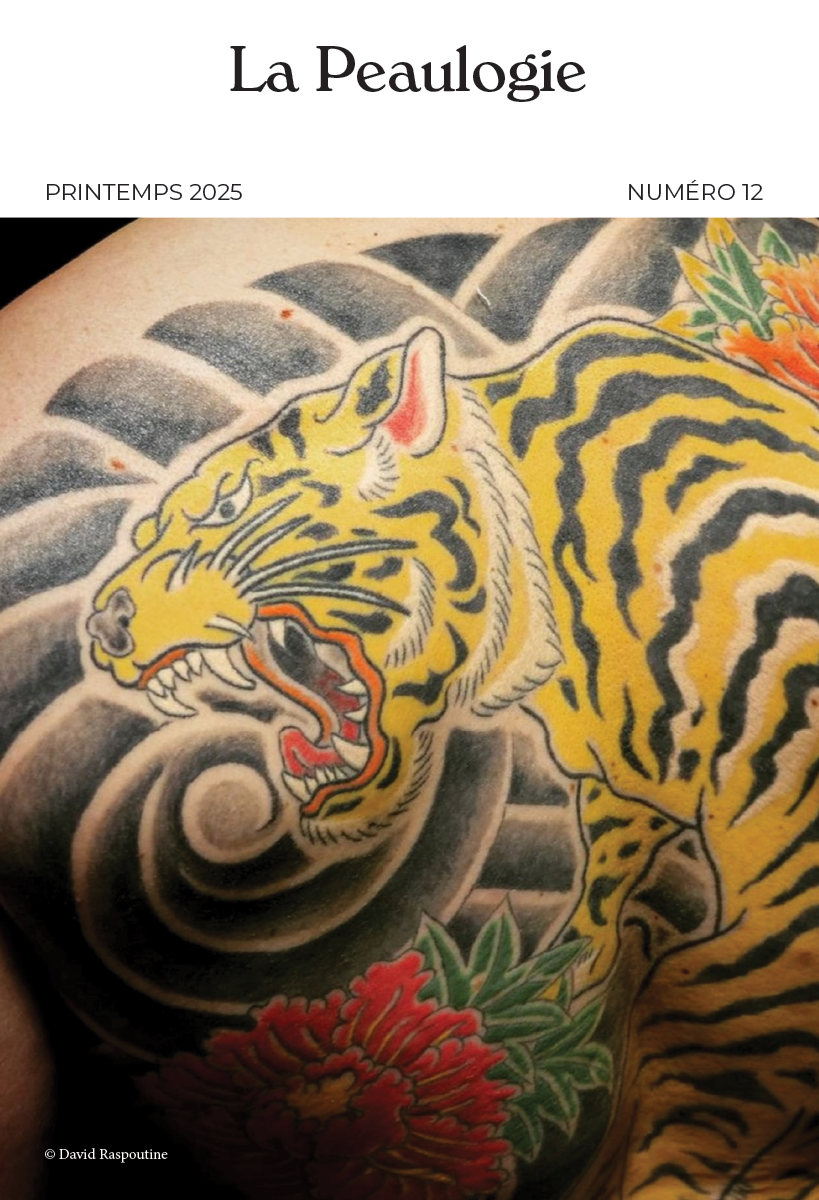
Alexandra BAY
Tatouée, Photographe, Auteure du livre « Le tatouage traditionnel Américain ». Co–fondatrice du fanzine Free Hands et créatrice du fanzine Tattow Stories, Paris. France.
Référence électronique
Bay A., (2025), « Tattoo flash vs creation », La Peaulogie 12, mis en ligne le 14 février 2025, [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/flash-creation
Résumé
En France, le tatouage a connu différentes évolutions, du tattoo flash à la création pure, de l’artisanat au Xe art. Au début des années 90, les tatoueurs issus de différentes scènes underground se concentrent sur le savoir-faire et l’aspect technique. Ils ont à cœur de répondre à la demande du client. Ils n’ont pas forcément un bagage artistique, mais au moins un œil de copiste. Ils travaillent principalement à base de tattoo flash. Au début des années 2000, une vague de jeunes artistes issus d’écoles d’art s’empare du métier. Tout en respectant la technicité exigée, ils imposent leur identité graphique unique, bien loin du tattoo flash. Ils ne répondent pas à la demande du client, ils la créent en imposant leur propre univers artistique. Ils vont durablement transformer l’artisanat du tatouage en Xe art. Passionnée de tatouage depuis 1995, je vous relate cette évolution avec un récit qui mêle à la fois histoire et témoignages.
Mots-clés
Tatouage, Tattoo flash, Yann Black, Kostek, Léa Nahon, Bugs, Mikaël de Poissy, Tatouage Magazine, Tattoo Savage
Abstract
In France, tattooing has undergone various evolutions, from flash tattooing to pure creation, from craftsmanship to Xth art. In the early 90s, tattoo artists from various underground scenes focused on know-how and technical aspects. They were keen to meet customer demand. They don’t necessarily have an artistic background, but at least a copyist’s eye. They work mainly with tattoo flash. In the early 2000s, a wave of young artists from art schools took over the profession. While respecting the technical requirements, they imposed their own unique graphic identity, a far cry from tattoo flash. They don’t respond to customer demand, they create it, imposing their own artistic universe. They will transform tattooing into an Xth art form for a long time to come. I’ve been a tattoo enthusiast since 1995, and I’d like to share this evolution with you in a story that combines history and personal testimonies.
Keywords
Tattoo, Tattoo flash, Yann Black, Kostek, Léa Nahon, Bugs, Mikaël de Poissy, Tatouage Magazine, Tattoo Savage
Avant l’ère du tattoo flash et de l’industrialisation du tatouage, vers 1870, les « marins tatoueurs » américains transformèrent leurs petits carnets (12 x 9 cm) reliés en percaline, en album de tatouages. Habituellement, ils les utilisaient pour noter des informations de navigation (photo ci-dessous). Durant les temps de loisir à bord des frégates, les plus créatifs imaginaient des motifs à tatouer autour des thèmes de l’amour, de la religion et du patriotisme. Certains d’entre eux auraient gagné beaucoup d’argent en croisières (Yazoo Democrat, 1859) comme Martin Hildebrandt et Ed Thomas, premiers professionnels « officiellement installés » sur les terres vers 1850/1860 (The St. Paul Sunday Globe, 1883). À New York, Ed Thomas continua de présenter aux clients « un livre bien usé, rempli d’images très colorées, allant d’une simple étoile bleue de 50 cents à un groupe de plusieurs figures coûtant 8 dollars. » (The St. Paul Sunday Globe, 1883) La différence entre les albums et les sets de tattoo flash résidait dans la quantité de dessins exposés. Les catalogues de petit format (souvent A5) contenaient entre un à trois motif(s) par page, tandis que le tattoo flash de grande taille (généralement A4) proposait une dizaine de visuels.
Vers 1890, en France, les tatoueurs dits « professionnels » comme Médéric Chanut ou le Père Rémy présentaient également leur catalogue aux clients afin qu’ils sélectionnent un motif. La Lanterne publie ainsi le 21 août 1888 : « Les tatoueurs ont des albums contenant un certain nombre de dessins faits à la main, parmi lesquels leur client fait un choix suivant son caractère, son tempérament ou le but qu’il se propose. » À l’inverse des tatoueurs américains qui gagnèrent beaucoup d’argent au cours des guerres ou sur les océans, nos piqueurs français ne vécurent pas décemment du tatouage et exercèrent de petits métiers en parallèle. Le père Rémy fut distributeur de prospectus et Médéric Chanut, mégotier. Le soir venu, dans les bals, les caves à vin et autres lieux interlopes, ils éternisèrent sur la peau une passion naissante, une déception amoureuse, un désir de vengeance ou de rébellion, etc. Il est possible d’admirer quelques artefacts comme l’album d’un « tatoueur Lyonnais » datant de 1889 (côte ms 5255) conservé à la bibliothèque municipale de Lyon.
Le tattoo flash fut le produit de l’industrialisation du tatouage aux USA. Grâce à l’invention du dermographe électrique en 1891 (US Patent 464 801, 8 décembre 1891), le tatouage connut un véritable boom dès le début du 20e siècle et s’étendit à de nouvelles couches sociales ainsi que sur l’ensemble du territoire américain. Face à une clientèle en constante progression, de nombreux aspirants tatoueurs se lancèrent dans le métier sans posséder de réel talent artistique, ou au moins un minimum d’aptitudes. Ils retranscrivaient maladroitement des cartes de visite ou des tatouages à même la peau de leur client. Ils encraient des tatouages de piètre qualité… Cette dérive aurait donné une idée ingénieuse à Albert Morton Kurzman [1880-1954], alias « Lewis (Lew) Alberts » ou « Lew the Jew ». Le tatoueur du Bowery, à New York, profita de ce boom pour commercialiser auprès de ses collègues des planches de motifs prêts à être recopiés et tatoués (Albert Parry, 1933, Secrets of a Strange Art as Practised among the Natives of the United States). Puis, il s’associa à Charles Wagner pour ouvrir « The Chatham Electric Tattooing », l’une des boutiques de vente de matériels les plus populaires à New York.
Le 18 septembre 1927, dans le Forward Sunday, Albert Parry écrit : « Lew the Jew » vint à la rescousse de ses amis tatoueurs. Bien qu’accablé par la clientèle autant (si ce n’est plus) que ses confrères, il conserve sa fraîcheur d’esprit originelle vis-à-vis de son art. Pour lui, il s’agit toujours d’un art et non d’un simple métier. Il passe ses journées devant ses aiguilles électriques à tatouer des multitudes de corps de toutes conditions, âges et positions sociales, et il consacre ses nuits à créer et dessiner de nouveaux motifs. Lew-the-Jew connaît étonnamment bien ces hommes et ces femmes ainsi que leurs goûts esthétiques. Il répond à leur besoin de pathos primitif et de sentimentalité simple. »
Ce sont ces mêmes planches de tattoo flash que le Français Bruno a présentées dans sa boutique lorsqu’il s’est installé en France une soixantaine d’années plus tard. Officiellement, il a été le premier tatoueur français à ouvrir un salon à Paris, le 6 octobre 1962. La préfecture a validé sa demande de licence sous l’appellation de dessinateur intra-dermique (Archive INA – Vidéo du 26/08/1964), et il s’est établi dans le quartier chaud de Pigalle. Bruno avait appris les ficelles du métier avec Tattoo Peter d’Amsterdam, rencontré en 1959. Peter avait l’habitude d’encrer les marins de passage et d’autres populations interlopes. Sa boutique avait les murs recouverts de tattoo flash. Comme lui, Bruno a œuvré à partir de ces planches pour présenter aux clients ce qu’il était en mesure de tatouer. Il a bourlingué quelques années avec sa camionnette avant de s’implanter à Pigalle. Dans son shop, en quelques minutes, le client pouvait choisir son motif parmi une centaine de visuels. Le prix apparaissait généralement à côté de chaque dessin facilitant la transaction. La plupart des tatoueurs français ont travaillé avec des sets de tattoo flash, car ils répondaient à la demande du consommateur. Il n’était pas encore question d’imposer sa patte graphique.
Dès la fin du 19e siècle, la presse américaine et française a vu dans la pratique du tatouage l’expression simpliste du marin, de l’ouvrier, du criminel, de la prostituée, etc. Les études de Cesare Lombroso et d’Alexandre Lacassagne ont contribué à la construction de cette image négative, celle d’une population primaire qui manifestait ses émotions sur la peau, ne sachant pas les extérioriser verbalement. Les médias écrits n’ont pas perçu le tatouage comme une démarche avant-gardiste, mais plutôt comme un acte conformiste et uniformisé, loin de toute création artistique ; hormis le tatouage japonais qu’elle a encensé en tant que véritable art. Elle a fréquemment ironisé sur l’inscription définitive d’une devise ou d’initiales sur l’épiderme ou sur le peu d’originalité des motifs portés. Elle était horrifiée par cet homme ou cette femme privé(e) de son droit à la rédemption, enfermé(e) dans la caricature de ses émotions et d’un moi projeté à un instant donné. Elle se moquait souvent du manque de singularité de la population tatouée, offrant parfois un dessin humoristique sur le sujet.
L’évolution du tatouage américain a fortement été liée au sentiment patriotique des marins et des soldats qui combattaient en l’honneur des États-Unis. En France, c’était l’inverse, le tatouage concernait les mauvais garçons et les mauvaises filles, les Bat’ d’Af’., les marginaux qui vivaient hors du système. Contrairement aux tatoueurs américains installés dans des « studios officiels » avant la fin du 19e siècle, le tatoueur français allait là où se trouvait sa clientèle. À Paris, on le rencontrait chez le marchand de vin, dans les brasseries, sur les quais ou dans les bals. Il se déplaçait avec son album, sa triplette d’aiguilles et son encre de Chine. Le 21 octobre 1891 (date de l’invention du dermographe électrique), le père Remy exerçait « son art » dans sa chambre de l’hôtel de l’Avenir, situé au 64 rue des Poissonniers, à Montmartre (Le Progrès de la Côte d’Or, 1891). En France, le tatouage a longtemps été une pratique d’anticonformistes et cette image a persisté jusqu’à la fin des années 90. C’est le maître de la mode française Jean-Paul Gaultier qui a mis en avant les tatoués lors de son défilé de 1994. C’était une démarche absolument novatrice, même si ça restait totalement « underground ».
Au début des années 1990, les tatoueurs de Paris et de sa banlieue se comptaient sur les doigts d’une main. On n’entrait pas si facilement dans une boutique de tatouage, c’était presque aussi sulfureux que d’aller faire ses achats dans un sex shop. L’encre bleue appartenait aux bandes comme les punks, les skinheads ou les bikers. Le monde du tatouage incarnait un univers mystérieux dont il était difficile de déchiffrer les codes et les usages. Le tatoueur spécialiste du vitrail Mikael de Poissy (fondateur du Musée français du tatouage et éditeur de Tatouage Magazine) se remémore : « En dehors des bandes, on avait très peu de gens tatoués, même dans le milieu du rap ! J’habitais dans une cité à Poissy et ça n’existait pas le tatouage ! Tu avais quelques groupes de punks ou de skins français, mais ils étaient partiellement tatoués. Les vrais portaient alors 5 à 6 motifs. C’étaient de petits tattoos, comparés aux Allemands ou aux Anglais. »
En 1991, Mikaël obtenait son premier tatouage chez le célèbre Marcel, situé rue Legendre à Paris. Évidemment, il choisissait un motif sur l’une des nombreuses planches de tattoo flash accrochées au mur du shop, une tête de mort avec un rat posé dessus (le fameux « Rats Get Fat While Brave Men Die »). Bien disposé, Marcel lui a encré une belle pièce sur le haut du bras droit. Lors de la séance, il s’est même déridé, Mikael se souvient : « Ça a biché entre lui et moi, c’était un vieux parigot Marcel, il te tatouait la clope au bec. Il m’a tatoué en fumant pendant une heure ! Finalement, c’est en me faisant tatouer et en discutant avec lui qu’on a vraiment sympathisé. Il connaissait déjà ma trogne, mais je n’étais pas encore un client. » Le lien était établi et c’est celui-ci qui conditionnait au plus haut point le rapport de l’amateur à l’art du tatouage. Après un premier tatouage, l’adepte avait cette sensation étrange d’appartenir à un cercle fermé d’initiés.
À cette époque, il était coutumier que le client régulier assimile les ficelles du métier grâce à son tatoueur. Ce dernier ne se sentait pas menacé par une éventuelle concurrence déloyale, car le tatoué connaissait les codes du milieu qu’il respectait. En matière de projet de tatouage, seuls les habitués se permettaient des extravagances, car ils avaient établi une véritable connexion avec leur tatoueur. Précurseur du tatouage contemporain, Bugs alors spécialiste du celtique, encrait sa première pièce dans le style « cubiste », et ce, sur un client familier. En France, les vrais tatoués n’étaient pas tellement recouverts. Mikaël de Poissy confie : « En 1990, personne ne venait se faire un bras en entier chez un tatoueur, même aux USA, c’était du patchwork… » Les véritables adeptes possédaient une dizaine de pièces. À la fin des années 90, choisir un tatoueur pour son style artistique était un concept inexistant.
Le magazine Juxtapoz en 1998, avec le célèbre Mark Ryden en couverture © Juxtapoz Magazine
https://assets.vogue.com/photos/55d9ffc8236da4c133179290/master/w_1920,c_limit/JEAN-PAUL-GAULTIER-SPRING-1994-RTW-01.jpg
S’agissant de mon expérience personnelle, j’ai découvert le tatouage en 1994 avec Jean-Paul Gaultier et l’émission « 52 sur la Une ». C’était un reportage inédit. Je voyais le tatouage comme une pratique de tribus, et la mienne était le punk. En tant que newbie, j’ai été impressionnée d’entrer dans une boutique la première fois pour me faire tatouer sur le poignet. J’avais 17 ans en 1995. Mon tatoueur était un ancien anesthésiste qui s’était reconverti. Il avait une allure de biker habillé tout en cuir. Il tatouait avec son pit-bull à ses côtés et possédait une mygale dans un aquarium. J’aimais beaucoup dessiner et ce premier contact m’a donné envie de devenir tatoueuse.
J’ai tenté un premier apprentissage avec Hassan Goucem en 1996, le frère d’Amar. Cependant, ce dernier est reparti en Inde. Puis, j’ai bénéficié d’une deuxième initiation vers 1999 avec Faba, un tatoueur rockab installé près de Montmartre. Décédé depuis, il m’a inculqué la passion de l’artisanat, l’importance de maîtriser la soudure des aiguilles, tout en nourrissant une culture artistique avec le magazine Juxtapoz qu’il affectionnait. Je me souviens qu’il m’avait prêté un catalogue de Jet France, en me demandant d’en prendre le plus grand soin. Il avait réellement la trouille que je le perde, car ce n’était pas si simple d’en obtenir un. L’apprentissage relevait d’une initiation. Le novice devait rester en retrait, souder les faisceaux d’aiguilles à la perfection, savoir monter et démonter la machine, respecter les règles d’hygiène, observer le maître à l’œuvre pour comprendre comment il encrait les peaux. Au bout de quelques mois, l’apprenti était prêt à encrer son premier tatouage. Attention, ce n’était pas n’importe quel motif ! On partait sur un dessin simple à base de tracé. Le remplissage demandait plus d’habileté et nécessitait de l’exercice. L’apprenti se perfectionnait grâce aux pièces toujours plus complexes qui se présentaient lors des séances. Je me souviens que la règle commune était de savoir tatouer tous les tattoo flash et tous les styles afin de répondre à n’importe quelles exigences du client.
Les tattoo flash permettaient aux tatoueurs d’exposer leur savoir-faire et ce qu’ils étaient en mesure d’encrer. En général, ils avaient déjà tatoué plusieurs fois chaque modèle proposé. Les sets de tattoo flash recouvraient les murs des commerces pour présenter tous les motifs tatouables. Le client désignait selon la mode du moment celui qui ornerait son épaule ou le haut de son bras. Dans les années 90, la préférence se portait sur le tribal popularisé par Leo Zulueta, les entrelacements celtiques, les lettrages, les motifs d’inspiration japonaise ou polynésienne, etc. Je me souviens justement d’avoir sélectionné un bracelet celtique pour ma cheville en voyant un tattoo flash dans la boutique Tattoo Spirit à Bordeaux, en 1998. J’ai toujours ce tatouage choisi sur un coup de tête. Cependant, je ne le regrette pas.
La technique du tattoo flash était éprouvée. Après avoir échangé avec le client sur l’emplacement, la taille, les couleurs et le cas échéant, procédé à quelques ajustements au goût du client, le tatoueur décalquait l’illustration sur du papier transfert. C’était un procédé rapide. Une fois sur la peau, les lignes violettes du carbone lui permettaient de piquer les tracés en noir. La plupart des magasins étaient ce que l’on appelle des streets shops ayant pignon sur rue. On pouvait se faire tatouer tous les styles, tous les motifs, sans prendre de rendez-vous des mois à l’avance. En 1986, Bruno ouvrait Jet France Company, une entreprise de fournitures pour tatouer. Il a largement démocratisé l’accès aux matériels à tatouer. Son catalogue proposait justement des tattoo flash à la mode comme le tribal, réinterprété à la manière occidentale.
Si l’on doit comparer le tattoo flash au tatouage contemporain, une œuvre sur mesure, on peut effectivement se poser la question de l’originalité dans le port d’un motif reproductible à l’infini. Si un cœur restait un cœur, l’histoire que son porteur y insufflait en faisait un cœur unique et bien différent des autres. De plus, le client pouvait tout à fait demander au tatoueur de le modifier, de l’adapter à son idée, de le grossir ou de le réduire. Il pouvait choisir des couleurs particulières, supprimer ou ajouter un élément. Le tatoueur qui avait reproduit ce dessin un nombre incalculable de fois en était parfaitement capable. Le tattoo flash était la principale méthode jusqu’aux années 2000, et encore plus dans les street shops où les clients de passage s’arrêtaient pour assouvir une envie rapide de tatouage. Les tatoueurs n’avaient pas le même bagage artistique que les gamins issus des écoles d’art. Ils proposaient ce qui était à la mode et ne cherchaient pas spécialement à se démarquer. De plus, il existait des styles efficaces aux lignes solides comme le old school, le new school, le réalisme, le japonais, etc. Le tatoueur expérimenté possédait un savoir-faire technique qu’il privilégiait à l’esthétisme. Il avait à cœur de tatouer une pièce qui survivrait au passage du temps. Pour finir, il maîtrisait tout son catalogue de tattoo flash ainsi que la plupart des différents styles.
Avant les années 2000, le tattoo flash était à la base de la plupart des projets de tatouage. Les anciens tatoueurs n’avaient pas le temps ou la capacité de concevoir une œuvre sur mesure. La création pure est apparue dans les années 00’s. Yann Black ou Kostek encrait des pièces uniques. Aucun client ne possédait le même tatouage. Le concept du tattoo flash a progressivement disparu pour laisser place au projet sur mesure. Il était tout à fait possible de reconnaître la patte graphique des artistes de la vague contemporaine, que ce soit un « Yann Black », un « Kostek » ou un « Léa Nahon ». La clientèle a changé, touchant ainsi de nouvelles sphères sociales, avec une population bien moins marginale. Un profil de tatoués collectionneurs est apparu. Ils accumulaient les œuvres d’art sur le corps. À l’heure actuelle, il est bien plus difficile de se faire un nom parmi la quantité incroyable d’artistes sur les réseaux sociaux dont les identités graphiques sont toutes très proches.
La France avait une culture récente du tatouage en comparaison de ses voisins. Devenir tatoueur, ça se méritait ! Trouver des équipements était un véritable sacerdoce, même si Bruno avait ouvert Jet France Company à la fin des années 80. Il a été le premier en France à lancer une entreprise de vente de fournitures et de matériels. Les tatoueurs achetaient surtout des aiguilles ainsi que d’autres fournitures nécessaires pour le tatouage, mais préféraient les machines à tatouer anglaises ou américaines. Jusqu’au milieu des années 90, les tatoueurs étaient de vrais artisans, capables de se fabriquer une machine, de souder des aiguilles, désinfecter le matos… etc. Ils travaillaient en majorité avec des sets de tattoo flash. Mikaël de Poissy confie : « Je savais que je pouvais encrer ce qui était dans mes catalogues et qu’on ne me demanderait pas autre chose. Tous les motifs qui étaient dans les catalogues, je les avais faits 20 fois. »
À cette époque, la plupart des tatoueurs qui débutaient n’avaient pas fréquenté d’école d’art ou suivi de formation artistique. C’étaient des personnes issues de sphères « underground » notamment liées à la musique, dont les potes souhaitaient se faire tatouer. Trouver un apprentissage n’était pas aisé, et assimiler les ficelles de la profession, ça se méritait. Les procédés, les catalogues et les secrets de fabrication restaient insaisissables. Mickaël blague à ce sujet : « Comme le métier était jalousement gardé et qu’il ne fallait pas que les choses se voient, les tatoueurs faisaient tout en cachette. Ils dissimulaient même leurs machines et dormaient presque avec ! » Le client fidèle était quelquefois initié par son propre tatoueur, devenu un ami au fil du temps. L’aspirant qui se lançait devait avoir une bonne connexion avec le milieu et surtout, respecter ses règles. À l’époque, les tatoueurs n’étaient pas très nombreux et se faisaient souvent appeler par leur prénom et parfois le nom de leur ville comme Rémy d’Étampes, Michel de Bordeaux, Claude de Villeneuve (mon premier tatoueur), etc. Le S.N.A.T (Syndicat National des Artistes Tatoueurs) recensait 300 boutiques de tatouages en France à la fin des années 90.
En 1992, Mikael de Poissy a cherché en vain un apprentissage dans toute la région d’Île-de-France, mais le gamin ne s’est pas démonté. Il a acheté quelques sets de tattoo flash chez Dimitri à Issou et du matos chez Jet France, en 1993. Son père a été son premier client ! Le tatoueur raconte : « Je suis rentré chez moi avec le matos et mon père est venu dans ma chambre. Il m’a dit : “C’est parti, tu commences aujourd’hui.” J’ai préparé un dessin. C’était une tête de lion et de femme, côte à côte, de profils. Au final, le tatouage était pourri et ça ressemblait plus à une tarte aux pommes… Je l’ai tatoué avec une aiguille. » La technique, ça s’apprend et Mikaël a expérimenté durant une bonne année chez lui. Il enchaîne : « Pendant six mois, j’ai tatoué avec une aiguille, car je ne savais pas qu’on pouvait en mettre plusieurs ! J’ignorais également qu’on pouvait remplir avec des aiguilles plates. J’ai couvert des avant-bras et des cuisses avec des faisceaux d’une à trois aiguilles ! J’y passais des heures et des heures. » Puis, il a lancé son business « Mikael Tatouage » et encré les gens de sa cité. Il recouvrait les bousilles des rockers des années 50/60, et Sitting Bull a remplacé Gene Vincent. Les grands classiques étaient la tête d’indien ou de loup, le dauphin, les îles, etc., tous ces tatouages que l’on retrouvait dans les catalogues des tatoueurs.
Magazines US : Tattoo Savage et Tattoo Flash avant 2000. © DR
Internet et les réseaux sociaux sur lesquels brillent nos artistes actuels n’existaient pas encore. Aussi, l’importation des magazines US dans les kiosques et les tabacs presse a apporté un vent de modernité dans la culture du tatouage français. Encore fallait-il trouver ces pépites qui étaient rangées à côté des revues pornographiques. Les plus célèbres étaient Tattoo Savage, Tattoo Flash, et leur prix était relativement élevé, plus de 40 francs. Mikaël se souvient des débuts : « Quand j’ai commencé (NDLR En 1992), 95 % des tatoués et tatoueurs du milieu étaient des bikers. Le seul magazine en France qui parlait un peu de tatouage était Hot Bike et Free Wheels. Ils avaient une petite rubrique sur le tatouage. Ils présentaient tous les tatoueurs français. Puis, l’américain Jonathan Shaw a lancé son magazine International Tattoo Art. Dans ce mag, les premiers motifs tribaux sont apparus avec Léo Zulueta, en 93/94. Le new school a émergé dans la deuxième partie des années 90. Ça a cartonné ! J’étais de la génération avec le cul entre deux chaises, j’avais de vieilles planches et des sets de tattoo flash faits par Bugs et Brian Everett. » C’était une véritable source d’inspiration pour nos artisans qui ont découvert les stars du moment et les nouvelles tendances US comme les styles new school, biomécanique, etc.
Les années 1995 signaient les prémices d’un tatouage bien plus technique. En France, le old school a surgi comme une réinterprétation du traditionnel américain où les aplats de couleurs ont été remplacés par des volumes aux effets chromés. J’ai eu un coup de cœur pour ce style. En arrivant à Paris en 1998, j’ai adopté un flamming autour de la cheville, puis un cœur sacré au bas du dos encré par Yann (co-organisateur de la convention de Nantes) de Buzz tattoo, un street shop des Halles. On retrouvait les sets de tattoo flash sur les murs des boutiques du quartier. Les motifs en vogue étaient le cœur sacré, la boule de billard, les cerises, la pin-up, etc. Le old school mélangeait les codes du traditionnel à la sauce Kustom culture américaine dont le dessinateur Coop était le fer de lance. Je percevais encore le tatouage comme un art compartimenté en différents styles et dont chaque tribu se faisait encrer les motifs de prédilection.
En 1997, le premier magazine français Tatouage Magazine a apporté une véritable émulation dans le milieu ! Mikaël ajoute : « On a enfin eu une revue qui parlait de nous ! On s’est tous mis à leur écrire, à vouloir être publié, etc. » Désormais éditeur de la célèbre publication, Mikaël a conservé les archives et possède des « lettres rigolotes de tatoueurs » qui tenaient vraiment à paraître dans « le mag ». C’était une véritable fierté d’être publié à cette époque. Internet s’est démocratisé vers 1999/2000. Mikaël conclut : « Avoir un magazine français et des conventions, c’était très important pour le paysage français. Dans les conventions, on allait voir le photographe officiel pour qu’il prenne notre pièce en photo pour qu’elle soit publiée. ». Ces revues ont longtemps trôné sur la table basse des shops. Dans la salle d’attente, la clientèle les feuilletait et pouvait piocher des idées pour montrer au tatoueur ce qu’elle souhaitait. À cette époque, et dans de nombreuses villes de province, on était bien loin de la notion de droit d’auteur actuel. C’est cette presse qui a mis en avant un précurseur du tatouage contemporain, Bugs.
Mikaël de Poissy se souvient : « Le premier tatoueur où je me suis dit qu’il y avait eu la balance, c’était Bugs. Au milieu des années 90, il en a eu marre de faire du celtique. Il s’est lancé dans ses dessins cubiques à la Picasso. Il a commencé à les tatouer et ça nous paraissait fou que des gens fassent des choses qui leur plaisent sur la peau de leur client. On s’en tenait aux planches et aux catalogues et on ne cherchait pas plus loin. » Diplômé des beaux-arts de Perpignan, Bugs est un amoureux du cubisme. Comme de nombreux tatoueurs, il a suivi un apprentissage à l’ancienne avant de devenir un vrai spécialiste du celtique, très à la mode à la fin des années 90’s. Contrairement aux tatoueurs français, Bugs possède une riche culture artistique et un sacré bagage technique, il n’a donc pas de limites hormis celles de sa clientèle.
Devenu une pointure du style celtique, il a ouvert son studio en 1986, « Evil from the needle » dans le quartier de Camden, à Londres. Sa première pièce personnalisée, il la doit à un client régulier en 1994. Et c’est une véritable révélation pour l’artiste ! Bugs se souvient : « un client italien dont je recouvrais le corps de celtique m’a demandé un tatouage hors du commun. Il voulait une peinture du Duce par Gerardo Dottori (1933) sur son dos. Le symbole ne m’intéressait pas, mais le projet artistique m’a emballé et j’ai effectué des recherches sur Dottori. » L’Italien a été un précurseur du style futuriste dans les années 20. Une fois le portrait tatoué sur le dos de son client italien, Bugs a envoyé une photo aux magazines qui lui ont retourné des commentaires positifs. Sa clientèle habituelle a apprécié cette nouvelle orientation. Elle lui a prêté un bout de peau pour ses nouvelles compositions. Ce sont ces différentes réactions qui ont décidé l’artiste à tatouer son propre style. Bugs va mixer les motifs du traditionnel avec son art favori, le cubisme. C’était une démarche absolument novatrice dans le paysage français.
En 1998, Tatouage Magazine a publié un article dévoilant le travail inédit de l’artiste boostant ainsi sa carrière. Cette publication a apporté un regard moderne sur le tatouage. Le client portait enfin de l’art sur la peau. Malheureusement, la population tatouée de l’époque n’était pas encore prête pour cette révolution ou elle ne possédait pas la culture nécessaire pour apprécier cet art. Bugs raconte : « J’ai commencé à sélectionner les pièces. Au début, j’ai perdu beaucoup d’argent, puis j’ai pris de nouveaux tatoueurs dans la boutique. Du coup, je pouvais encrer seulement les projets qui m’intéressaient et faire tourner la boutique. Des fois je ne tatouais pas du tout pendant 2 à 3 mois. Le tatouage contemporain, ce n’était pas à la mode. » En revanche, il est incontestable qu’il a ouvert la voie à de nombreux jeunes artistes sortis des écoles d’art comme Yann Black, Léa Nahon, Joe Moo ou Belly Button. Ce dernier le cite comme étant une source première d’inspiration.
Dans mes souvenirs, le fer de lance du tatouage contemporain est incarné par Yann Black au début des années 2000, à Paris. Après avoir suivi des études dans le domaine du dessin animé, Yann a vécu à Bruxelles. Il a commencé à tatouer ses potes en 1992. Pour le blog Urbania, l’artiste se remémore : « C’était une autre époque. Tu achetais ta machine aux bikers avec une boîte d’aiguilles sans même savoir souder. Je faisais des tattoos de taulards […]. Des trucs gratuits dans des squats de punk. » Il a déménagé à Paris et posé ses valises chez Tribal Act, une boutique de modification corporelle ultra-moderne, située dans l’Est parisien. Il confie au blog : « J’offrais déjà un tatouage différent avec mon style propre et là, je me retrouve dans un studio à la mode à faire des gros tribals dégueulasses et des signes chinois. Mais je faisais de l’argent pour la première fois de ma vie. Une journée à Paris, c’était un mois à Bruxelles. Mais qu’est-ce que je me sentais mal ! » Yann Black a alors décidé d’imposer son style, sans concession. Il a refusé de tatouer autre chose que son art. C’était une démarche ultra-novatrice. Je me souviens d’une « prof » dans mon école de stylisme qui s’était fait rembarrer, car elle lui avait demandé une fée. Yann avait tout simplement dit non ! Adieu le tout-venant ! L’artiste tatoueur ajoute : « Je pouvais enfin me libérer des trucs pourris que je faisais. C’était gratifiant. »
En 2002, Tatouage Magazine a publié un reportage sur son travail singulier et c’est un succès absolu ! L’artiste s’est retrouvé avec 6 mois d’attente sur son agenda. Les clients ont afflué de toute l’Europe pour passer sous ses aiguilles. Il a dépoussiéré les codes du tatouage. Une certaine clientèle a enfin pris conscience qu’on pouvait se faire tatouer autre chose que des têtes de loups ou des dauphins. La peau est devenue un nouveau support d’expression artistique. On parle alors de Tribal Act comme du berceau du tatouage moderne. Dans ces années-là, dans la rue, si vous exhibiez un tatouage de Yann Black, vous pouviez être sûr d’être interpellé par un aficionado qui reconnaissait sa patte graphique. Ses pièces étaient de véritables œuvres d’art que les clients détenaient comme des collectionneurs. J’ai rêvé de posséder un « Yann Black », mais j’ai abandonné face au délai d’attente, puis il est parti en Suisse vivre d’autres aventures !
À la même époque, de multiples artistes vont se démarquer par leur art encré. À Bruxelles, on évoque évidemment la Boucherie Moderne comme un important vivier de talents dont les fers de lance sont Kostek et Jeff Palumbo. En France, Léa Nahon, issue de l’école Boulle, s’est fait connaître pour ses croquis et ses esquisses crayonnés sur la peau. C’était l’époque bénie des artistes tatoueurs qui étaient encore assez peu nombreux pour être reconnus grâce à leur identité graphique. Désirés pour leur art unique, ils/elles ne manquaient pas de travail et il y avait parfois plus d’un an d’attente, ce qui était aussi nouveau par rapport à la vieille école.
Ils multipliaient les guests dans les boutiques réputées et ils avaient le luxe de sélectionner les pièces qu’ils souhaitaient encrer tout en privilégiant le lien avec leur clientèle. Cette démarche mènera aux ateliers privés qui sont progressivement devenus une nouvelle norme. On est bien loin du street shop avec son esprit de tattoo flash et du tout-venant. Ces artistes ont élevé le niveau technique et artistique du tatouage et apporté une clientèle bien plus diversifiée, loin des tribus urbaines. Désormais, les clients collectionnaient les pièces de ces tatoueurs côtés. Ces derniers possédaient une culture artistique bien plus pointue, et donc, étaient plus exigeants.
Malheureusement, de nombreux artistes de la vieille école ne se sont pas adaptés à cette nouvelle ère du tatouage. Certains ont jeté l’éponge et d’autres se sont suicidés. Mikaël rapporte ainsi : « La première génération des années 70 ne comprenait pas ce qu’il se passait et ils n’ont pas voulu prendre le train en marche, car soit ils étaient fatigués, soit ils ne voulaient pas, le tatouage pour eux ce n’était pas ça ! […] Après 2010, les vieux avaient disparu, ceux qui ont survécu, ont pris des artistes en guest pour ne pas mourir. Je connais beaucoup de tatoueurs qui se sont suicidés ou qui sont morts. La dernière fois avec Bruno, on faisait le compte, on en connaissait déjà onze qui s’étaient suicidés. Bruno appelle ça le piédestal. C’était les meilleurs de leur ville ou de leur département, car c’étaient les seuls. Après qu’internet et les nouveaux tatoueurs sont arrivés, ils n’ont pas supporté et se sont suicidés. »
S’agissant de son propre travail, Mikaël conclut : « Je me suis dit, soit tu fais ce que tu vois partout, soit tu fais comme Bugs et tu développes ton identité, ta patte. Je me suis concentré là-dessus, c’était le tout début des réseaux sociaux avec MySpace, et on commençait à mettre des photos. […] j’ai eu une révélation et j’ai bossé un an et demi sur mon triptyque qui m’a propulsé sur la scène internationale. Je suis passé dans tous les magazines de tatouage. » Mikaël est devenu un artiste tatoueur spécialiste du vitrail. Il a su s’adapter à cette nouvelle école. De plus, il a l’avantage de posséder une culture historique incroyable et cela donne du sens à son style médiéval français. Avec son expérience, son amour de l’histoire, mais aussi son esprit moderne, Mikaël a servi de passerelle entre l’ancienne et la nouvelle génération. Dans les conventions, les tensions étaient parfois palpables. Il raconte : « On était souvent à table dans les conventions, les mecs se regardaient et ne se parlaient pas. Ça m’est souvent arrivé de créer le lien. Les vieux se répètent, les jeunes n’ont rien à dire, l’ennui est réciproque. Dès fois, tu avais des ambiances d’entre-deux-guerres. » Et pourtant, les anciens auraient encore des choses à apprendre aux plus inexpérimentés.
Tandis que nos artisans tatoueurs avaient à cœur de savoir reproduire à la perfection leurs sets de tattoo flash, qu’ils avaient encrés des centaines et des centaines de fois, la nouvelle génération d’artistes est arrivée pour tatouer son art, son identité graphique, sans aucune limite technique. Leurs compétences créatives leur donnaient la possibilité de répondre à une demande toujours plus personnalisée d’une clientèle toujours plus exigeante. Il est indéniable que cette démarche a enrichi le tatouage et repoussé ses frontières graphiques, mais aussi techniques. Cependant, si la première génération d’artistes tatoueurs contemporains gardait en tête le savoir-faire artisanal du tatouage pour encrer une œuvre pérenne, Internet et son miroir aux alouettes ont produit une nouvelle génération de jeunes artistes bien plus intéressés par la beauté instantanée de leurs œuvres et leur popularité, et qui ne se préoccupaient pas de leur durabilité dans le temps. On est dans une sorte de happening artistique. Ça donne des tatouages qui peuvent être très beaux sur les photos, mais s’avèrent être de pures bousilles mal encrées et vouées à être recouvert par de vrais professionnels soucieux de leur métier. Être un artiste tatoueur, ce n’est sûrement pas renier l’aspect artisanal qui caractérise la pratique de ce métier, même s’il est évident que le tatouage devrait désormais représenter le Xe art.
Entretien avec Bugs en 2022 pour écrire cet article.
Entretien avec Mikaël de Poissy pour écrire un article sur sa carrière publié dans Tatouage Magazine 144, janvier 2022.
Je les en remercie.
Je voudrais également remercier Jimmie Skuse pour m’avoir apporté son éclairage d’historien et de passionné du tatouage sur la notion de tattoo flash pour cet article. Ce terme ne se met pas au pluriel.
« Les gens utilisaient des flashs pour attirer l’attention des clients afin qu’ils puissent les visualiser en un éclair. Un bon ensemble de bannières d’écriture, de panneaux, etc. vous aidaient à trouver du travail. »