Référence électronique
Lançon B., (2021), « Cuirs barbares et peaux romaines », La Peaulogie 7, mis en ligne le 17 décembre 2021, [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/cuirs-barbares-peaux-romaines
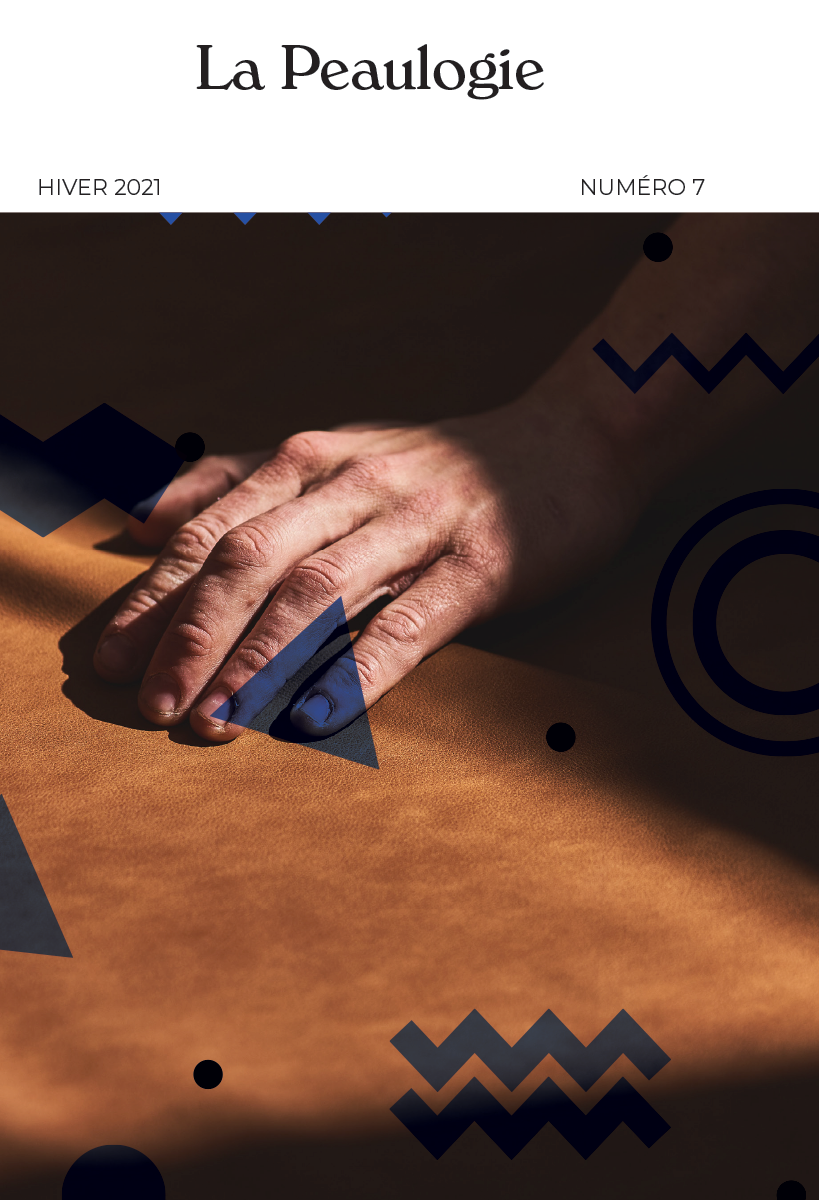
Bertrand LANÇON
Professeur émérite d’Histoire romaine, Université de Limoges.
Référence électronique
Lançon B., (2021), « Cuirs barbares et peaux romaines », La Peaulogie 7, mis en ligne le 17 décembre 2021, [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/cuirs-barbares-peaux-romaines
Résumé
Aux yeux des Romains, adeptes du tissu, le vêtement de cuir a longtemps connoté les barbares. Ils faisaient cependant un usage multiple des peaux animales, celui‑ci culminant avec l’emploi du parchemin pour les Codes juridiques impériaux et la Bible. L’Antiquité tardive a vu les peaux intégrer la romanité, mais perçues de manière ambivalente en perpétuant des clichés, tandis que les moines les adoptaient comme vêtement topique. Aujourd’hui, une nouvelle relation avec les animaux s’instaure et, disqualifiant les usages traditionnels de la peau, semble annoncer la fin de l’« âge du cuir ».
Mots-clés
barbares, ceinture, cuir, parchemin, peau, romains
Abstract
For the Romans, who were adepts of the wooven tissues, leather clothes have for a long time designated the barbarians. They had nevertheless themselves manifold uses of animal skins, one of them reaching a climax with the parchment for the great Law Codes and the Bible. During the Late Antiquity, the skins were integrated into Romanity, albeit they were perceived in a paradoxical way, not excluding the clichés, as the monks chose it as a topical cloth. Nowadays, a new relationship with animals prevails, and, disqualifying the traditional uses of the skins, seems to announce an end of the “leather ages”.
Keywords
barbarians, belt, leather, parchment, roman, skin
Jusqu’au Ve siècle de notre ère, les « barbares » ont concentré, aux yeux des Romains, l’altérité principale à leur modèle de civilisation. Les auteurs romains, qu’ils fussent de langue grecque ou latine, ont multiplié les clichés qui étaient supposés définir les contours de leur image topique : les « barbares » portent des cheveux longs, des moustaches et des barbes, de couleur blonde ou rousse, et s’habillent de vêtements de peau. L’usage vestimentaire de peaux animales était donc une des caractéristiques principales de la barbarité aux yeux de Romains vêtus d’étoffes. De fait, les cheveux longs et le port du cuir étaient censés rapprocher les « barbares » de l’animalité, tandis que les cheveux coupés et les vêtements tissés faisaient des Romains les adeptes par excellence de la civilitas.
Il se trouve que cette dualité a été brouillée durant l’Antiquité tardive, et cela pour deux raisons principales. La première est que l’usage vestimentaire des peaux s’est peu à peu répandu chez les Romains à partir du IVe siècle. La seconde est le triomphe du codex comme forme de livre, aboutissant à un emploi du parchemin pour la Bible et les Codes juridiques et faisant basculer les peaux de la bestialité au sacré. En d’autres termes, les IVe‑VIe siècles sont une période où le statut du cuir connaît une inversion.
Le mot français « cuir » provient du latin corium ‑ lui‑même issu du grec korion ‑ qui désignait aussi bien la peau humaine que les peaux animales et végétales. Pour les désigner, les Romains employaient cependant de préférence le mot pellis (peau), au singulier comme au pluriel (pellices), assorti de l’adjectif « en peau » (pelliceus). Leurs usages du cuir étaient multiples. Le premier, militaire, était destiné aux cuirasses pectorales, aux casques, aux ceintures, à l’équipement de cavalerie et aux tentes. On en faisait aussi des fouets, des tambours et des gants de pugilat. Un usage général était celui des chaussures et sandales à semelles cloutées, dont on conserve des vestiges archéologiques, et dans lesquelles on a pu voir « la pierre angulaire de l’édifice de l’Empire romain[1] ». Dans l’architecture civile, il leur arrivait de l’utiliser, épais, roulé en cylindre et imperméabilisé, comme alternative à la terre cuite et au plomb pour les canalisations des aqueducs. Les outres de peau servaient au transport individuel des liquides, mais aussi, gonflées, comme support aux ponts flottants sur les fleuves.
La différence la plus visible avec les barbares tenait au vêtement. Pour celui‑ci, les Romains n’utilisaient pas le cuir mais le tissu, en particulier de laine ou de lin, et ils connurent un grand engouement pour la soie aux IVe et Ve siècles.
Durant l’hiver 416, un édit de l’empereur Honorius interdit à Rome le port des cheveux longs et des vêtements de peau[2]. Six ans après le sac de Rome par les Goths de l’été 410, il s’agissait de réapproprier la ville de Rome[3] à la romanité en y prohibant les caractéristiques pileuses et vestimentaires des barbares. Le texte définit ainsi légalement l’idiosyncrasie romaine des cheveux courts et des vêtements de tissu, rejetant les habits de peau et la chevelure longue comme des usages barbares à proscrire dans la ville. Cela rappelle un passage consacré par Suétone à une cérémonie triomphale de l’époque de Caligula, au milieu du Ier siècle de notre ère[4]. À cause d’une pénurie de captifs barbares, cet empereur recruta pour le cortège des figurants, qu’il fit déguiser en barbares en faisant teindre leur chevelure en rouge et en les vêtant d’habits de peau. Le vêtement de cuir entrait donc bel et bien dans la définition topique du barbare, et plus encore, dans un cliché durable de sa perception. De fait, les textes nous ont transmis plusieurs descriptions de barbares qui véhiculent et perpétuent plus ou moins ce cliché : ainsi Tacite pour les Germains, Ammien Marcellin pour les Huns et les Alains, Sidoine Apollinaire pour les Huns et les Francs[5]. Les indications de Tacite, dans sa Germanie, sont maigres et éparses. Il mentionne que les Germains vivaient nus ou presque et que chez eux, les cuirasses et les casques étaient rarissimes (Germ. 6). Une précision vient plus loin (Germ. 17) : ils pouvaient porter un sayon (sagum) tenu par une agrafe et les plus riches d’entre eux portaient leur vêtement serré. Il ajoute qu’ils portaient aussi des peaux de bêtes sauvages (gerunt et ferarum pelles), mais seulement là où le commerce ne fournissait pas d’autres parures. Ainsi, les Fenni, les plus pauvres des Germains, avaient‑ils des vêtements de peau (Germ. 46 : uestitui pelles). Quant aux femmes, elles étaient surtout vêtues de lin. L’habit de cuir était soit porté par défaut, soit sous forme de parures soignées. Les Germains choisissaient (eligunt) des animaux dont ils tachetaient et bigarraient les peaux avec celles d’animaux marins[6]. Lorsqu’il décrit les Bretons dans sa Vie d’Agricola, Tacite ne mentionne pas le cuir et se contente de signaler que beaucoup d’entre eux ont adopté la toge romaine parce qu’elle était une option valorisante (VAgr. 21, 3). Il nous faut donc, constatant que l’habillement de cuir était pour les « barbares » un pis‑aller, que le cliché procédait moins d’un choix ethnique et coutumier que d’une contrainte géoéconomique. Sidoine Apollinaire le confirme au Ve siècle : s’il décrit la physionomie des Huns et des Francs, il évoque leur chevelure sans mentionner des vêtements de peau. Au siècle précédent, Ammien Marcellin avait été plus disert dans ses notations sur les Huns et les Alains. Les premiers, écrit‑il, « portaient des vêtements de lin ou faits de peaux de bêtes sauvages », « couvraient leurs jambes hirsutes de cuirs de chèvres »[7] et avaient aux pieds des chaussures si grossières qu’elles leur permettaient à peine de marcher. Des Alains, il dit qu’ils étaient moins sauvages dans leurs mœurs et leur vêtement que les Huns, ce qui pourrait éventuellement indiquer un moindre usage du cuir. Cependant, comme Ammien les présente comme des éleveurs et des chasseurs, on pourrait en déduire que les peaux animales entraient dans leurs usages quotidiens.
Jusqu’au IVe siècle, où l’empereur Constantin mit fin aux sacrifices animaux dans la religion romaine, les quartiers de la carcasse et la peau des animaux sacrificiels étaient réparties/partagées entre les sacerdotes (prêtres) et le peuple. Les viandes grillées étaient offertes en banquet à ce dernier, tandis que les prêtres recevaient la carcasse et la peau, qu’ils pouvaient monnayer auprès des tanneurs pour faire de la colle et des cuirs. On sait néanmoins que des rites anciens se perpétuèrent à l’époque chrétienne de l’Empire. Ainsi, la fête des Lupercales se tenait encore, à la mi‑février, dans la Rome de la fin du Ve siècle. Il s’agissait d’une course autour du Palatin, accomplie par le collège des Luperques, qui étaient à moitié nus et couverts de peaux de bouc. Ils couraient en faisant siffler des fouets de cuir – également de bouc – pour toucher les femmes regroupées sur le parcours et désireuses d’être fécondes. La fonction fécondante de la peau animale est ici manifeste et, en 494, le pape Gélase Ier écrivit une lettre contre le sénateur Andromachus pour dissuader les aristocrates chrétiens de continuer à participer à la fête, même en s’y faisant représenter par des esclaves de leur maison (Gélase, 1960). Appeler à rejeter les peaux de bouc équivalait à renoncer à un rite archaïque dans une société fortement attachée à ses mythologies fondatrices : ici celle de Palès, vieille divinité des troupeaux qui avait donné son nom au Palatin. Les antiques bergers fondateurs de la ville devaient, aux yeux de Gélase, s’effacer du souvenir et les Romains se muer en brebis du Dieu unique, conduites par les bergers qu’étaient les évêques.
S’il est une peau animale qui illustra le pouvoir impérial romain, c’est bien la dépouille du lion de Némée, qu’Hercule étrangle de ses mains dans le récit mythologique. Héros et demi‑dieu, celui‑ci conjugue dans ses « travaux » l’intelligence rusée à la force physique. Aussi la dépouille du lion a‑t‑elle été choisie par des empereurs pour exalter en eux ces vertus. L’exemple le plus célèbre en est le buste « Borghese » de Commode (180‑192). On trouve aussi la peau du lion de Némée sur des monnaies, coiffant les empereurs de lignée « herculienne » de la tétrarchie à la fin du IIIe siècle et au début du IVe. Il est remarquable que, dans le mythe, une grande partie des travaux d’Hercule consiste à abattre des animaux réputés invincibles, ce qui fait de la peau animale un trophée exceptionnel, pourvoyeur de puissance. C’est également le cas de la « toison d’or » rapportée de Colchide par Jason et les Argonautes, qui était celle d’un bélier ailé sacrifié par les dieux. Rappelons qu’Hercule, qui faisait partie des Argonautes, est mort à cause du centaure Nessus : en mourant, ce dernier avait persuadé Déjanire, l’épouse d’Hercule, de plonger sa tunique dans son sang et de la lui faire porter afin de conserver sa fidélité. La tunique empoisonnée adhère à sa propre peau et, ne pouvant s’en défaire, il se jette sur un bûcher.
Chez les Romains, la peau animale connote surtout la force comme auxiliaire de la victoire. Aussi les porteurs d’enseignes des légions portaient‑ils une peau de loup.
Il est intéressant de relever qu’un type monétaire français dû au graveur Augustin Dupré a représenté Hercule avec la dépouille du lion de Némée sur la pièce de 5 francs argent lors des trois premières républiques. Ce type a été modernisé en 2011‑2013 par Joaquim Jimenez pour la frappe de séries de pièces en argent de 10 euros. Si l’allégorie de la Liberté a perdu sa pique, Hercule y conserve sa parure léonine.
L’empereur porte la dépouille du lion de Némée et des attributs herculéens : la massue et les pommes d’or du jardin des Hespérides.
Dans les années 260, l’empereur Valérien mourut en captivité chez les Perses. Selon quelques sources, la peau de sa dépouille aurait été teinte en rouge et exposée dans un temple mazdéen. Au début du IVe siècle, le rhéteur chrétien Lactance rapporte ainsi les faits :
« Après qu’il eut fini sa vie honteuse dans cette indignité, il fut dépouillé de ses viscères et sa peau, arrachée et imprégnée de rouge, fut déposée dans un temple des dieux barbares en mémoire de leur triomphe éclatant et pour être exhibée aux yeux de nos ambassadeurs afin que les Romains perdent confiance en leurs forces[8] ».
Le fait est confirmé par Aurelius Victor dans les années 360, et par des auteurs grecs plus tardifs, dont certains énoncent même que l’empereur septuagénaire aurait été écorché de son vivant[9]. Quoi qu’il en fût, les sources indiquent que le Grand Roi sassanide usa de la peau de l’empereur comme d’un trophée à caractère politique et religieux, visant à humilier les Romains et à saper leur confiance en eux‑mêmes. En cela, il perpétuait l’usage ancien des rois assyriens, qui affichaient sur leurs remparts les peaux des ennemis exécutés[10].
Un précédent est connu par Hérodote. Lors de son occupation despotique de l’Égypte, dans les années 525‑522 av. J.‑C., le roi perse Cambyse II aurait fait écorcher vif le juge Sisamnès et revêtir de sa peau le siège des juges. L’usage de la peau humaine ressortit donc à l’intimidation. Dans le cas de Valérien, la peau impériale fut traitée comme un trophée de chasse, l’assimilant à une peau animale. Ammien Marcellin indique que, de leur côté, les Alains décapitaient leurs ennemis vaincus et leur enlevaient la peau, dont ils ornaient, sous forme de phalères, leurs chevaux de guerre[11].
L’époque contemporaine n’est pas exempte de cette pratique anthropodermique dans le cas de quelques tueurs en série. Le plus célèbre, Ed Gein (1906‑1984), a prélevé la peau de cadavres exhumés pour en faire des habits, des draps, des rideaux et un abat‑jour (Schechter, 1998). Dans le cinéma, la peau humaine est le mobile des crimes dans Les yeux sans visage de Georges Franju (1960) et dans Le silence des agneaux de Jonathan Demme (1991). Dans le premier, le professeur Génessier, incarné par Pierre Brasseur, prélève la peau du visage de jeunes filles enlevées afin de redonner un visage à sa fille défigurée. Dans le second, le criminel enlève des jeunes filles enveloppées pour prélever la peau de leur dos. Les accusations envers Ilse Koch, épouse du premier commandant du camp de Buchenwald Karl‑Otto Koch, d’avoir fait fabriquer un abat‑jour avec la peau humaine de prisonniers a été en revanche déconstruite (Cazenave, 2008).
Dans la littérature contemporaine, comment ne pas penser à Malpertuis, le chef d’œuvre de Jean Ray [12]? Le propriétaire de cette étrange maison de Gand, Quentin Moretus Cassave, a obligé par testament un groupe de personnes à y résider, tels des captifs, jusqu’à ce que ne subsiste plus qu’un couple qui en hériterait. Les admirateurs de Jean Ray connaissent le ressort de son histoire : qualifié de « rose‑crucien », l’oncle Cassave avait, par la magie des formules et des grimoires, capturé sur une île égéenne des dieux mourants de l’Antiquité. Pour les garder en vie, il les « enferma dans de grotesques dépouilles » préparées par le taxidermiste Philarète :
« Il fourra les dieux de l’antique Thessalie comme dans des sacs et ils furent à peine des hommes » (chapitre 10).
Sous une apparence humaine, les anciens dieux demeurent prisonniers de la maison maudite de Malpertuis. « Soumis à d’imprévisibles alternances de déité et d’humanité », « ils vivaient dans un étrange état humain et végétatif avec, par moments, une sorte d’anxiété, une conscience confuse de leur essence véritable… ». Quelle est la nature de leur enveloppe ? « Des peaux ! Rien que des peaux dans lesquelles on souffle comme dans des conques » (chapitre 6). La matière première d’un taxidermiste est la peau animale, mais Jean Ray laisse planer le mystère, excepté dans une allusion fugitive à une peau de loup. Quoi qu’il en soit, la peau, telle une outre ou un sac, est une enveloppe qui contient. Elle n’empêche pas la mort, car les dieux périssent l’un après l’autre, ni les Gorgones de pétrifier par leur regard, l’ultime rescapé qu’est le dieu Terme.
Les bibliologues, à la suite des travaux de Lawrence S. Thompson dans les années 1940, ont avéré l’existence de livres reliés avec de la peau humaine entre le XVIIe et la première moitié du XXe siècle, en Grande‑Bretagne, aux États‑Unis et en France (Gordon, 2016). Ceux‑ci alimentaient des cabinets de curiosité, en particulier lorsqu’ils étaient faits de peaux tatouées. L’« Anthropodermic Book Project », qui a été lancé en 2015, s’est donné pour objectif de les recenser et de les authentifier. En 2019, sur une cinquantaine de volumes supputés tels, dix‑huit ont été reconnus grâce à l’analyse de la masse peptidique (peptide mass fingerprinting). Parmi ceux‑ci, certains ont été reliés avec la peau de condamnés exécutés : c’est le cas, en Angleterre, des minutes du procès de 1828 de William Corder, « le meurtrier de la grange rouge »[13]. Comme l’a récemment montré Jennifer Kremer, qui a recensé au total 137 exemples de biblioplégie anthropodermique, cela établit un lien privilégié entre celle‑ci et l’exercice punitif de la justice criminelle (Kremer, 2019). Nous y retrouvons des traits antiques du trophée, augmentés du goût pour le châtiment et de la curiosité pour le morbide dans les siècles modernes.
La peau animale a été utilisée, dans l’Antiquité romaine, comme support d’écriture, ce qui l’anoblissait. L’étymologie du mot « parchemin », le vocable grec pergamenon, relie son origine à la prestigieuse ville de Pergame, en Asie Mineure. Il témoigne d’un usage des peaux pour l’écriture au cours de l’époque hellénistique. Son emploi coûteux en faisait un support de luxe. Le Romains, qui entrèrent en possession de cette cité et de son royaume par un legs du roi Attale en 133 av. J.‑C., en connurent ainsi l’usage, mais celui‑ci ne se développa qu’avec la révolution médiologique qui eut lieu entre le Ier et le IVe siècle de notre ère. À partir de la fin du Ier siècle commence cette révolution qui dura environ trois siècles, celle du changement de support d’écriture qu’est celui du passage du uolumen (rouleau de papyrus) au codex (pages rectangulaires, reliées ou non)[14]. Cette révolution, en plus d’être formelle, était aussi culturelle, l’écriture passant d’un support d’origine végétale à un support d’origine animale plus résistant mais aussi plus coûteux.
Le codex perpétua l’usage du papyrus et, par l’emploi de petits formats, permit de créer des livres à bon marché, aisément transportables et vendables. Du fait de son coût élevé, le parchemin fut réservé aux gros livres de prestige comme les Bibles, les grands Codes juridiques et les grands traités médicaux, livres destinés à la sédentarité des bibliothèques.
Nous disposons sur ce point d’un témoignage remarquable. Il s’agit d’une lettre adressée par l’empereur Constantin (306‑337) à l’évêque Eusèbe de Césarée, pour lui commander la fabrication et la livraison de cinquante exemplaires de la Bible destinés aux églises de Constantinople :
« Vainqueur Constantin Très Grand Auguste à Eusèbe de Césarée[15]. Dans la ville qui porte notre nom[16], avec l’aide de la providence du Dieu sauveur, une très grande multitude de gens s’est attachée à la très sainte Église, au point qu’ils y sont devenus beaucoup plus nombreux. Il semble donc tout à fait opportun d’y construire aussi davantage d’églises. En conséquence, reçois avec beaucoup d’empressement la décision que nous avons prise. Il a paru bon de faire connaître ceci à Ton Intelligence, pour que tu ordonnes que soient copiés sur du parchemin bien préparé, par des calligraphes compétents et qui connaissent bien leur métier, cinquante volumes des divines Écritures, bien lisibles et faciles à utiliser. Tu sais que la préparation et l’usage de celles‑ci sont choses tout à fait nécessaires à la vie de l’Église. Une lettre a été envoyée par Notre Clémence au rationalis du diocèse[17], pour qu’il ait soin de fournir tout ce qui est nécessaire pour leur préparation[18]. Ce sera la tâche de Ta Diligence que les livres soient prêts au plus vite ; pour le transport, tu es autorisé à utiliser deux voitures publiques, sur la foi de notre présente lettre. Ainsi, ces belles copies seront très aisément transportées jusque sous nos yeux. Un des diacres de ton Église accomplira certainement cette mission : lorsqu’il arrivera chez nous, il fera l’expérience de notre bonté. Que Dieu te garde, cher frère ! »
Constantin, Lettre 38, dans Lettres et discours, trad. Pierre Maraval, Paris, Les Belles Lettres, coll. « La roue à livres », 2010.
La matière première nécessaire à ces cinquante Bibles correspondait à 100 000 peaux d’agneaux, soit 2 000 agneaux par exemplaire. La première condition à leur fabrication était donc l’existence d’un élevage ovin florissant. La deuxième condition était le processus long et coûteux de la préparation du parchemin : tannage, tension pour disposer convenablement les fibres de collagène, ponçage, blanchiment à la poudre de craie, assouplissement et polissage. L’exigence de Constantin est assortie d’une exigence de qualité de la préparation des parchemins. Enfin, la troisième condition était la mobilisation de scribes de talent, experts en calligraphie grecque, dotés de calames et d’encre en quantités suffisantes, et priés de fournir une écriture belle et lisible. Il est donc permis de penser que l’on eut peut‑être recours aux spécialistes locaux des « lettres célestes », l’écriture en caractères de haut format qui était employée pour les textes officiels émanant du Palais impérial et des résidences des gouverneurs. L’ensemble requérait donc une dotation financière importante, que les caisses de l’État prirent en charge sur ordre de l’empereur. Le texte de la lettre ne précise pas si le rationalis d’Orient concerné par cet investissement coûteux était celui des caisses publiques, les « Largesses sacrées », ou celui du patrimoine personnel de l’empereur, la res priuata. En revanche l’acheminement des cinquante Bibles devant être assuré par deux chariots du cursus publicus (la poste impériale), relevait du domaine public et nécessitait des sauf‑conduits. Cette commande massive avait en outre pour corollaire une exigence de rapidité de fabrication et de livraison, qui s’accordait mal aux lenteurs ordinaires. De cet exemple, on retiendra qu’une Bible en parchemin était constituée des peaux de 2 000 agneaux et que le poids de cinquante Bibles n’était pas supportable par un seul chariot. Nous sommes ici bien au‑delà des cent bœufs du traditionnel hécatombe de la religion gréco‑romaine, décidé lors de grands périls. Cependant, le fait nous ramène à l’importance sacrificielle de l’agneau dans le judaïsme ancien et assimile concrètement le Livre à l’agneau de Dieu. Cette superposition est évoquée par Georges Didi‑Huberman dans un chapitre de son livre Phasmes, où il mentionne une apparition du Christ sous la forme d’un livre en peau d’agneau[19]. Le mot « Bible » signifie en grec « les livres » et les métonymies qui la désignent, « membrana » et l’Écriture, superposent la peau d’agneau et le sacré de la révélation divine.
Le mot membrana est ainsi devenu, au cours du IVe siècle, un synonyme d’Écritures saintes. Autrement dit, « les peaux » sont devenues le terme par lequel la Bible se trouvait définie de manière métonymique. C’était là une promotion inédite de la peau animale dans la société romaine et dans l’échelle des valeurs, au degré le plus sacré, par le truchement du christianisme. Si, comme on l’a vu, une Bible était constituée de multiples peaux d’agneaux, l’usage du mot membrana est une description on‑ne‑peut‑plus réaliste, chaque volume représentant un cheptel sacrifié pour la bonne cause. Jérôme, qui a traduit l’Ancien testament de l’Hébreu et du Grec en Latin entre 382 et 405, s’alarme cependant que l’on puisse accorder un luxe si dispendieux aux membrana, alors que les pauvres meurent à notre porte.
Le parchemin, outre sa robustesse incomparable par rapport au papyrus, offrait la possibilité du réemploi. Nous avons ainsi les traces de manuscrits grattés et réécrits, que l’on appelle les palimpsestes. La Bible en était bien sûr exclue. Ainsi, vers 700, l’herbier du pseudo‑Apulée, une compilation du IVe siècle abondamment copiée au cours du Moyen Âge, fut copié en palimpseste sur un Code théodosien du Ve désormais obsolète (Lowe, 1933). Comme si la connaissance médicinale supplantait qualitativement le Droit.
Parmi les attributions du magister officiorum de l’empereur romain se trouvait la tenue du laterculum maius, nomenclature exhaustive des fonctionnaires impériaux, ici dépeint sous forme d’un grand codex sanglé de cuir. Correspondance et édits sont présents sous la forme de rotuli (rouleaux de papyrus, ou de parchemin pour les édits impériaux).
Vignette d’une copie médiévale la Notitia dignitatum (vers 425).
Parmi les attributions du magister officiorum de l’empereur romain se trouvait la tenue du laterculum maius, nomenclature exhaustive des fonctionnaires impériaux, ici dépeint sous forme d’un grand codex sanglé de cuir. Correspondance et édits sont présents sous la forme de rotuli (rouleaux de papyrus, ou de parchemin pour les édits impériaux).
.
La diffusion du christianisme dans l’Empire eut‑elle pour effet d’accepter les peaux animales dans le vestiaire romain sans y voir un élément de barbarisation ? De fait, la Genèse indique qu’avant de chasser Adam et Ève de l’Eden, « Yahweh Elohim fit à l’homme et à sa femme des tuniques de peau et les en vêtit[20]». Le vêtement primordial des humains aurait donc été une peau animale mais le texte biblique ne précise pas de quel animal il s’agit. La peau animale vient couvrir l’innocence perdue qu’était la nudité. Dans son Épître aux Hébreux (11, 37), Paul indique que les martyrs de la foi, fuyant les tortures de leurs persécuteurs, erraient de cachette en cachette, vêtus de peaux de moutons et de chèvres. On trouve dans la Bible latine issue de la traduction de Jérôme – la fameuse Vulgate ‑ une douzaine d’occurrences du mot pellis. Leur examen indique que la moitié seulement concerne la peau en tant que telle, humaine ou animale. Elle fait partie des quatre éléments charnels dont Elohim a dotés sa créature humaine façonnée dans l’argile : il l’a « vêtue de peau et de chair, tissée en os et en nerfs[21] ». La peau est définie comme le vêtement d’une chair putrescible : « Sous ma peau, ma chair tombe en pourriture et nos os se dénudent comme des dents[22] » dit Job. L’homme est donc doublement vêtu de peau : la sienne propre et celle de la tunique de cuir offerte par Elohim. La peau est à ce point centrale qu’elle figure dans un proverbe hébraïque cité par Job (2, 4) : « Peau pour peau », qui signifie « donnant donnant », mais qui est placé dans la bouche du démon.
Courant ascétique et anachorétique du christianisme, le monachisme est né en Égypte au milieu du IIIe siècle et se place dans le sillage de ce passage de la lettre de Paul aux Hébreux. De cette origine provient ce vêtement topique des moines qu’est la mélote. Celle‑ci était une tunique de peau et de poils de chameau, de mouton ou de chèvre, tels que la portèrent les ermites des déserts d’Égypte. Ce tropisme égyptien s’étendit au monachisme syrien et se répandit ensuite dans un Occident pourtant dépourvu de camélidés. En témoigne la Vie de saint Martin, publiée peu après 397 par l’Aquitain Sulpice Sévère. Ce dernier indique en effet que lorsque Martin, désireux d’échapper aux soucis de l’épiscopat de Tours, élut pour ermitage un méandre de la Loire, les moines qui le rejoignirent portaient des tuniques en peau de chameau[23]. Même si l’activité commerciale rendait possible l’arrivée de peaux de chameau de provenance égyptienne en Touraine, la probabilité en est incertaine. Voyons plutôt dans cette inférence de Sulpice Sévère un attachement au tropisme du monachisme égyptien, propre à placer Martin dans la continuité de Pakhôme et de d’Antoine, les plus célèbres moins d’Égypte, mais aussi de Jean‑Baptiste et des martyrs qui, selon saint Paul « sont allés çà et là sous des peaux de moutons et des toisons de chèvres[24] ».
Les moines du VIe siècle portaient une bure de tissu rêche, une ceinture et des sandales, dont le port est justifié par les premières règles monastiques. La ceinture s’opposait au caractère flottant du vêtement ; ceignant les reins, elle connotait l’assurance dans la chasteté et la détermination quasi militaire de l’ascèse. Les premières règles monastiques en indiquent bien la raison : la ceinture des moines – de cuir ou de corde ‑ était conçue comme élément d’une panoplie de combat. Elle tenait les reins dans le combat de l’ascète contre les passions corporelles. Dans le même temps, les Pères de l’Église faisaient des désirs un fouet susceptible de lacérer l’homme. En d’autres termes, le cuir était ambivalent, mais toujours rangé dans le registre martial de la coercition, d’une autodiscipline assurée par le ceignant. À la différence de l’étoffe, qui peut flotter sur le corps, le cuir l’épouse comme une seconde peau, serrant de près ses membres ou parties et procurant une conscience de la maîtrise de soi. Il est une sorte d’exosquelette qui soutient le moine dans son combat continuel contre le corps et fustige ses désirs coupables.
Les distinctions cru/cuit, bouillie /pain et cuir/tissu, qui véhiculaient traditionnellement le clivage entre barbarité et romanité s’estompent toutes entre le IIe siècle av. J.‑C. et le IVe siècle de notre ère[25]. Si les Romains passèrent à la panification au temps de la République, ils n’admirent que tardivement le cuir ; sans doute à mesure de la romanisation et de la christianisation progressive des barbares. Les peaux perdirent progressivement de leur aliénité sauvage avec l’intégration des barbares au monde romain, qui est contemporaine de l’éviction des chasses (uenationes) au profit de simples exhibitions de fauves dans les jeux du cirque. Le paradigme du mépris s’inversa progressivement en celui d’une admiration pour leur bravoure guerrière. Parallèlement, le cuir changea progressivement de statut dans la romanité tardive en culminant, grâce au parchemin, dans le prestige accordé au texte biblique.
Après des siècles où les peaux et fourrures animales ont véhiculé des significations symboliques liées au pouvoir et au rang social, le statut du cuir change encore aujourd’hui. La défense du bien‑être animal, telle qu’elle s’est développée de manière militante, discrédite le cuir animal, le renversant de son piédestal de noblesse et de luxe. La technologie du faux‑cuir a fait de substantiels progrès durant les deux dernières décennies, au point de proposer des simili‑cuirs dont la différence avec les vrais s’est considérablement estompée. Avec quelque retard, l’évolution est la même que pour les fourrures. Jusqu’aux années cinquante, les femmes portaient au cou des « renards » qui s’accumulent aujourd’hui avec les toques et manteaux d’astrakhan dans les friperies vintage. Peaux de phoque pour les chaussures hivernales imperméables ou le dessous des skis de randonnée, visons et chinchillas, cols léopard, chaussures et bracelets‑montres de crocodile ou sacs de galuchat : tout cet attirail a vécu, rejeté par les perceptions nouvelles dans un passé révolu, celui d’une forme de barbarité. La bourrellerie et la charronnerie demeurent dans les milieux équestres, tandis que la maroquinerie décline et se trouve progressivement marginalisée dans la haute‑couture. Aux pieds des alpinistes, les chaussures de haute‑montagne ont délaissé le cuir pour des coques en plastique. Cependant, les industries de la chaussure et des mobiliers de salon (fauteuils, canapés) conservent un usage répandu du cuir de vachette. Cependant, dans les écoles, le cartable de cuir a vécu. La reliure d’art usant de la « pleine fleur » n’est plus qu’un reliquat patrimonial. Dans les voitures de haut de gamme, la sellerie de cuir s’efface au profit d’un simili désormais valorisé comme tel. On entend ne plus s’asseoir sur la peau d’animaux. Pour ce qui est de la peau humaine, on remarquera que si l’usage chirurgical de la greffe de peau – humaine ou animale ‑ est toujours de mise pour les « grands brûlés » et les accidentés, celle de la peau artificielle accomplit actuellement, grâce aux chercheurs, des progrès décisifs. La chimie du silicone et des polymères, couplée à la nanotechnologie, permet d’ores et déjà de créer une peau artificielle très proche de la naturelle.
Tout indique que le statut des peaux et du cuir fait partie intégrante des indicateurs culturels de l’évolution des sociétés. Tantôt décriées tantôt adoptées, tantôt luxueuses tantôt versées dans la maltraitance des animaux, les peaux d’origine animale ont suivi des oscillations et se trouvent aujourd’hui, quelques siècles après leur abandon comme support d’écriture, délaissées voire réprouvées dans leurs usages maroquiniers ‑ et ce jusqu’à l’abandon du terme « maroquin » pour désigner un « portefeuille ministériel ». Ce n’est pas que l’humain se soit détaché de l’animalité : c’est plutôt l’animalité qui se trouve aujourd’hui détachée des peaux. De la même façon que la préhistoire a connu des époques paléolithique et néolithique avant l’âge du fer, il semblerait que l’histoire ait connu des époques paléodermiques et néodermiques avant d’entrer, au XXIe siècle, dans l’âge du similidermique. Cette prise de distance avec la peau animale peut être interprétée, non comme un éloignement de la nature, mais comme la définition d’un nouveau statut de l’animalité, désormais regardée comme élément de l’anthropique. Ce processus n’est en rien anodin car, dans le texte de la Genèse, fondamental dans la culture méditerranéenne et occidentale, Elohim crée les animaux pour qu’ils soient dominés par l’homme, qu’il créé après eux (Gn 1, 26‑30). Les perceptions nouvelles du cuir montrent que l’homme abdique aujourd’hui de cette assignation à la domination pour déplacer progressivement sa relation avec l’animal du registre de la prédation à celui de la protection. Ce nouvel élément de l’anthropocène demeure conflictuel mais signe, de nos jours, une évolution qui semble devoir aboutir à la fin prochaine d’un âge du cuir plurimillénaire. En témoigne la Bible, qui est passée en quatre siècles du parchemin au « papier‑bible » puis au CD‑ROM. N’en déplaise aux chasseurs, aux vieux rockers et aux amateurs de bondage, dont les cuirs paraissent d’ores et déjà marginaux et out of date dans des sociétés qui se veulent « écoresponsables » et respectueuses des peaux vivantes que sont les animaux.
Cazenave B., (2008), « La mégère de d’Armaggedon – Ilse Koch », Revue Pluridisciplinaire de la Fondation Auschwitz, Paris : Kimé, 25‑42.
Bergé C., (2019), Guerre et peau. Écorchement 2, Paris : Le Murmure.
Gélase, (1960), Lettre contre Andromachus au sujet des Lupercales, ed. G. Pomarès, Paris : Cerf, Sources chrétiennes, 65.
Gordon J., (2016), « In the Flesh? Anthropodermic Biblioplegy Verification and its Implications », RBM. A Journal of Rare Books. Manuscripts and cultual Heritage, 17, 118‑133.
Kremer J., (2019), « Reliures de livres avec la peau du condamné : hommage et humiliation autour des corps criminels », dans Mathieu Vivas (éd.), (Re)lecture archéologique de la justice en Europe médiévale et moderne, Bordeaux : Ausonius, 195‑211.
Lowe E.A., (1933), Codices Latini Antiquiores, VIII, 1211, Oxford : Oxford University Press.
Schechter H., (1998), Deviant: The shocking true story of Ed Gein, The original Psycho, New York : Simon & Schuster.
[1].↑ Benedikt Meyer, blog.nationalmuseum.ch (blog du Musée National Suisse), voit dans cette auxiliaire de la marche l’élément déterminant d’une conquête romaine essentiellement piétonne.
[2].↑ Code Théodosien XIV, 10, 4 (12 décembre 416).
[3].↑ À savoir la ville et le territoire d’un rayon de cent milles romains qui l’entourait (environ 150 km), espace placé sous l’administration du préfet de la Ville de Rome.
[4].↑ Suétone, Vies des douze Césars, Caligula, 47.
[5].↑ Tacite, La Germanie, éd. J. Perret, Paris : Les Belles Lettres, CUF, 1962. Ammien Marcellin, Histoires 31, 2, 5‑6 (Huns) ; 31, 2, 17‑22 (Alains). Sidoine Apollinaire, Carmen 2, 243‑268 (Huns) ; Carmen 5, 237‑254 (Francs).
[6].↑ Germ. 17 : eligunt feras et detracta uelamina spargunt maculis pellibusque belluarum. La suite du passage précise que les Germains utilisaient pour ces ornements la pourpre issue du murex.
[7].↑ Hist. 31, 2, 5 : Indumentis operiuntur linteis uel ex pellibus siluestrium ; 31, 2, 6 : hirsuta crura coriis munientes haedinis. On notera l’emploi, rare, du mot corium au lieu de pelles. Haedinus peut désigner la chèvre, le bouc ou le chevreau et le cabri.
[8].↑ Lactance, La mort des persécuteurs 5, 6 : Postea uero quam pudendam uitam in illo dedecore finiuit, derepta est ei cutis et exuta uisceribus pellis infecta rubro colore, ut in templo barbarorum deorum ad memoriam clarissimi triumphi poneretur legatisque nostris semper esset ostentui, ne nimium Romani uiribus suis fiderent….
[9].↑ Aurélius Victor, Les Césars 32, 5 ; Pierre le Patrice, fr. 13, Agathias 4, 23, 7, Malalas, Kédrénos, Léon le Grammairien. Voir Histoire Auguste, Vie de Valérien, éd. Stéphane Ratti, Paris : Les Belles Lettres, CUF, 2000.
[10].↑ Sur la pratique de l’écorchement et ses significations dans les guerres de l’Antiquité, on se référera à Christine Bergé, Guerre et peau. Écorchement 2, Paris : Le Murmure, 2019.
[11].↑ Ammien, 31, 2, 22 : auulsis capitibus, detractas pelles pro phaleris iumentis accomodant bellatoriis.
[12].↑ Le roman a été édité en 1943, puis remanié en 1955 (Paris, Denoël). Un film en a été tiré par Harry Kümel en 1971, avec Orson Welles et Michel Bouquet. Les citations proviennent de l’édition de 2020 réalisée pour Alma, coll. Espace Nord (Communauté Française de Belgique), par Arnaud Huftier.
[13].↑ Volume exposé dans un musée du Suffolk.
[14].↑ Sur ce processus, l’étude de référence est celle de Guglielmo Cavallo (dir.), Libri, editori e pubblico nel mondo antico. Guida storica e critica, Roma‑Bari, Laterza, 1984, part. p. 81‑132 ; Guglielmo Cavallo et Roger Chartier (dir.), Histoire de la lecture dans le monde occidental, Paris : Seuil, 2001 ; Frédéric Barbier, Histoire du livre en Occident, Paris, Armand Colin, 2020 (3e éd.).
[15].↑ Césarée de Palestine.
[16].↑ Constantinople, fondée en 324, dédicacée en 330.
[17].↑ Le comptable impérial du diocèse d’Orient.
[18].↑ Peaux traitées, encre, calames…
[19].↑ Georges Didi‑Huberman (1998), Phasmes. Essais sur l’apparition 1, Paris : Minuit, chapitre 14, Une page de larmes, un miroir de tourments.
[20].↑ Gn 3, 21 (trad. de l’Ecole biblique de Jérusalem). André Chouraqui traduit de la façon suivante : « Yahweh Elohim fait au glébeux et à sa femme des aubes de peau et les en vêt ».
[21].↑ Job 10, 11.
[22].↑ Job 19, 20.
[23].↑ Sulpice Sévère (2003), Vie de saint Martin, éd. Jacques Fontaine, Paris, Cerf, 3 vol., Sources chrétiennes 133‑135, 1967‑1969. ; traduction française seule : Paris : Cerf, Trésors du christianisme, Part. 9‑10.
[24].↑ Épître aux Hébreux 11, 37.
[25].↑ Bertrand Lançon, (2014), « Dans l’Antiquité tardive, le barbare cesse d’être la figure de l’autre », dans Yves Coativy et al. (éds), Jean‑Christophe Cassard, historien de la Bretagne, Morlaix : Skol Vreizh, 185‑193.
La Peaulogie - Revue en Libre Accès de sciences sociales et humaines sur les peaux - ISSN 2646-1064 - Texte sous licence CC BY-ND 4.0
