Référence électronique
Cintorino R., (2025), « Bobines, sonnettes et machines à tatouer », La Peaulogie 12, mis en ligne le 14 février 2025, [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/bobines-sonnettes-machines-tatouer
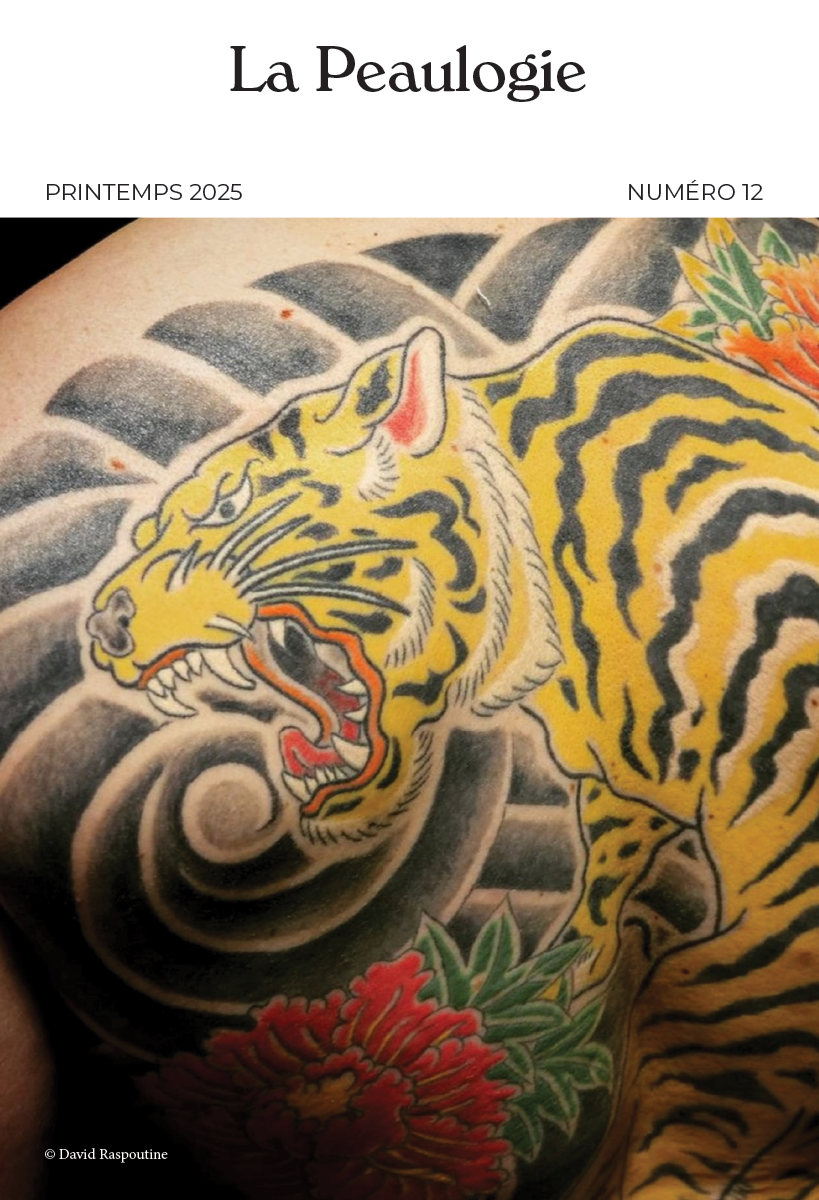
Rodolphe CINTORINO
Performer plasticien et fabricant de matériel pour tatoueur·euse·s.
Référence électronique
Cintorino R., (2025), « Bobines, sonnettes et machines à tatouer », La Peaulogie 12, mis en ligne le 14 février 2025, [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/bobines-sonnettes-machines-tatouer
Résumé
La machine à tatouer n’a pas de propriétaire attitré mais est essentiellement l’accumulation de savoirs et expériences qui, assemblées, ont façonné la machine à tatouer telle que nous la connaissons aujourd’hui.
Mots-clés
Machine à tatouer
Abstract
The tattoo machine has no owner, but is essentially the accumulation of knowledge and experience that, together, have shaped the tattoo machine as we know it today.
Keywords
Tattoo machine
Je suis Rodolphe Cintorino, performeur‑plasticien et fabricant de machines à tatouer traditionnelles — à bobines rotatives — ou de handpoke tools afin de réaliser des tatouages sans électricité. Ma réflexion ici est basée sur la conviction que la machine à tatouer n’a pas de propriétaire attitré mais est essentiellement l’accumulation de savoirs et expériences qui ont façonné la machine à tatouer telle que nous la connaissons aujourd’hui. Pour comprendre cela, je vais donc revenir un peu en arrière sur ma propre expérience.
C’est vers l’âge de treize ans, dans ma chambre, que tout a commencé : je feuilletais les magazines de tatouage de l’époque — Tattoo Mag, Savage —, tous bien rangés chez les buralistes à côté des magazines pornos. C’était toujours un grand moment, pour un gamin comme moi, de repartir avec cette lecture… Presque une double victoire et un peu de honte en moins. Ces revues venaient des États‑Unis : on y trouvait principalement des motifs de tatouage à l’esthétique U.S. (aigles, dragons, têtes de loup, portraits d’Indien, dauphin étoilé, Tribal, etc.), et des encarts publicitaires pour du matériel principalement nord américain. Les motifs, jadis très « tendance », n’avaient rien à voir avec l’univers graphique actuel.
À cette époque, j’ai également découvert la soudure en cours de technologie et j’ai pu ainsi, en m’inspirant de ce que je voyais dans ces magazines, réaliser mon premier faisceaux d’aiguilles — sept au total —, emprunté à ma mère qui faisait beaucoup de couture. Je pense qu’elle cherche encore ses aiguilles Bohin !
Jusqu’en 2009, je suis resté sensible au tatouage et me suis fait tatouer différents motifs, petits et gros. Cette année‑là, une amie se propose de me tatouer avec une machine à tatouer achetée sur Ebay ; j’ai accepté qu’elle teste sur moi son nouvel outil. Je me souviens de ce bruit excitant dans mes oreilles, ce bruit que l’on retrouve seulement quand on est assis dans un shop de tattoo à attendre son tour… J’ignore le fonctionnent de cette machine ; avec ses aiguilles et ses BUZZZZ, elle m’attire, mais je n’ai pas les moyens d’en acheter une. Une année durant, j’insiste tellement que mon amie finit par me l’offrir. Mais entre désir et illusion, je fais le constat que cette machine n’est pas si belle et trop lourde. Pas grave, je vais fabriquer la mienne avec les parties de cette machine.
Un an plus tard, elle est à nue, toute démontée : ressorts, vis, bobines, tout est à plat et avec une plaque de laiton, très fine, trop fine. Je me mets pourtant à fabriquer mon premier cadre de machine pour accueillir toutes les pièces qui la composent. Je glane des informations, sans trouver une vraie réponse à ma question : comment ça marche, une machine à tatouer ? C’est comme si tout était très secret, à la limite de l’alchimie et de la secte sacrée. Personne ne parle ou ne veut parler… comme si ne pas être du milieu me fermait toutes les portes de la Connaissance. Certes, je parviens à trouver de vieux magazines américains, une ou deux publications en allemand, mais la traduction et la compréhension des termes techniques n’éclaire pas ma lanterne.
D’abord je la branche sur une pile de 9 Volts. Rien.
J’achète une alimentation. Toujours rien. Cette machine ne fonctionne pas.
Et puis, un ami qui me voit dans l’errance électrico‑mécanique m’envoie vers un certain Karl Marc, tatoueur et fabriquant de machine à tatouer, qui allait devenir pour moi un véritable Magicien qui, par chance, avait du temps à me consacrer.
C’était magique ! Lui, curieux de voir quelqu’un qui ne tatoue pas se passionner pour la fabrication de machines, et moi curieux tout court. Après deux heures passées ensemble, d’explications, d’informations sur la puissance d’une bobine, le nombre de tours et les différents paramètres de ressorts à prendre en compte, ma première machine était vivante. Je l’ai vu se mettre en route, activer l’aiguille, la faire monter et descendre. À l’image de Frankenstein, faite de différents morceaux assemblés, je voyais enfin cette machine, ma machine, produire son BUZZZZ.
Merci Karl, car sans le savoir à l’époque, tu as mis une étincelle entre mes mains.
Et puis, les nuits se sont enchaînées. Avant de m’endormir, j’ai commencé à penser, à rêver de machine à tatouer… Quelle serait la prochaine ? J’ai enchaîné les essais, les échecs, puis les réussites et je me suis lancé dans mes premiers modèles.
Avec des morceaux de laiton, de la brasure et un peu d’histoire j’ai fabriqué ma première machine : une toute petite single coil, une mono bobine comme on dit en français, légère, compacte.
Ensuite je me suis attelé à de la fabrication plus conséquente ; elle manquait de force pour utiliser de gros faisceaux d’aiguilles : alors j’ai commencé les modèles à deux bobines, un classique pour les machines à tatouer.
À cette époque, je voulais apporter un peu d’histoire à leur fabrication, j’ai ajouté des morceaux d’ivoire chinés, d’ébène, et des matériaux synthétiques empruntés à de vieux objets type coupe‑choux, poudriers, plaques de micarta… Et bien d’autres encore.
Depuis ces premières années de fabrication, j’ai décidé de travailler exclusivement avec des matériaux anciens, rien de neuf, seulement un réemploi de vieux objets que j’intègre, leur donnant une seconde vie.
Très peu de temps après sont arrivées mes premières commandes.
J’aimais beaucoup l’idée de fabriquer sur commande, de devenir un artisan et de faire à la demande.
J’ai découvert que les tatoueurs sont des fans de machine à tatouer.
Même s’ils utilisent de façon régulière deux à trois modèles qui leur conviennent dans leur travail, ils sont aussi fétichistes de pièces uniques, personnalisées : en allant à leur rencontre, j’ai compris leurs envies techniques mais aussi leurs désirs esthétiques, les poussant à acquérir des machines qui puissent se détacher de l’industrie et de la grosse production.
Et pour cela, j’étais là.
Un jour, dans un magazine de tatouage, j’ai découvert Woody Hills, l’artisan du handpoke. Et je me suis dit : pourquoi pas moi ? Lui faisait des tatouages, moi des outils ; alors j’ai commencé à développer tout un tas d’outils pour réaliser des tatouages sans électricité, faits à la main en utilisant seulement l’aiguille. J’ai donc créé des modèles, des supports pour aiguilles.
Ma recherche, éloignée de la complexité de fabrication des machines à tatouer, s’orientait essentiellement vers un approfondissement esthétique avec toujours en arrière‑plan l’utilisation contrainte de matériaux simples, anciens de préférence et faciles à nettoyer, car dans ce milieu, on peut toujours faire du beau, mais il ne faut pas négliger l’hygiène.
Les premières commandes ont commencé quelques semaines plus tard avec des exigences très différentes, tant sur le plan pratique qu’esthétique. Et comme pour la fabrication de machines à tatouer, j’ai déplacé mes savoirs en fonderie, soudure et ferronnerie au profit des outils de handpoke. Il m’est même arrivé de travailler sur l’ergonomie positive des outils car pour certains tatoueurs, après des années de pratique, des douleurs peuvent apparaître dans leurs mains et leurs membres. C’est devenu un vrai atout pour moi que d’être également sensible à ces questions de confort d’utilisation.
Mais revenons à la machine à tatouer : plus qu’un simple objet, elle est un véritable support à performances. Du reste, saviez‑vous qu’elle n’est jamais la propriété d’une seule personne ? C’est un objet intriguant, qui ressemble à une sonnette de porte, mais qui a nécessité plus d’un siècle à être conceptualisé et industrialisé. Chaque partie, chacun de ses composants la relie à l’histoire, au temps. Voyons cela de plus près…
Au XIXe siècle, la Révolution industrielle bat son plein. En Europe, tout comme aux États‑Unis, la recherche technique et l’ingénierie se développent à grand pas. Il faut aller toujours plus vite, plus loin, faire mieux que les autres.
Ainsi, en 1800, le chimiste et physicien Alessandro Volta effectue des recherches et met en évidence le fait que deux plaques de métal différentes, plongées dans un liquide acide — type saumure ou acide sulfurique —, permet de produire une source d’énergie autonome et surtout utilisable partout. Il invente la pile Voltaïque. Et ce n’est que le début…
‑1819‑20 : Hans Christian Orsted, physicien et chimiste danois, fait une découverte essentielle dans le champ de l’électromagnétisme. Il pointe du doigt le fait que lorsqu’un courant électrique passe dans un fil, il influence l’aiguille d’une boussole et découvre ainsi l’interaction entre magnétisme et électricité.
‑1825 : William Sturgeon scientifique et inventeur anglais, aidé du Physicien Joseph HENRY, invente le premier électro‑aimant. Le principe est simple : autour d’une tige en métal (type clou), est entouré un fil de cuivre vernis, isolé, dans lequel on fait passer un courant. La tige en métal devient alors magnétique. Une fois le courant arrêté, le magnétisme cesse.
‑1831 : le même Joseph HENRY, aux États‑Unis, invente la sonnette de porte en se basant sur les travaux qu’il effectue avec William Sturgeon. Il fait bouger une barre en métal à l’aide d’un électro‑aimant qui vient frapper une cloche et produit un son.
‑1835 : Gustave Froment en France conçoit les premiers moteurs électriques à usage industriel, pour lesquels il reçoit en 1857 une mention au prix Volta. Dans sa conception, des électro‑aimants étaient alimentés pour attirer des tiges de fer fixées à un volant d’inertie en rotation. Au moment où une tige de fer atteignait l’électroaimant, l’alimentation du solénoïde (bobine de fil de cuivre) était interrompue jusqu’à ce que la prochaine tige de fer s’approche de l’électroaimant.
Ainsi ce jeu de ON/OFF faisait tourner l’axe et ainsi transformait l’énergie électrique en énergie mécanique. C’est cette rupture du champ magnétique que l’on retrouve dans les machines à tatouer traditionnelles
Pendant cinquante ans, les recherches s’accumulent, les ingénieurs, chimistes, horlogers et bricoleurs se concurrencent les uns les autres afin d’être toujours les premiers. À coup de brevets déposés à tour de bras, ils cherchent à être pionniers dans les domaines qui permettrons de faire avancer l’industrialisation et la modernisation de leur pays. Les communications terrestres, le télégraphe, le morse se développent très rapidement et un esprit concurrentiel, quasi‑lobbyiste, se développe également en parallèle. Dans les inventions majeures de cette époque, une recherche permet de faire avancer la transcription du savoir. Même si la presse existe déjà, la diffusion des journaux reste astreinte à une machinerie qui pour l’époque prend beaucoup de place et les premières machines à écrire se développent lentement.
‑1874 : Eugenio de Zuccato dépose un brevet pour un procédé de transformation du papier en un stencil, le « Papyrograph ». Cet ingénieur italien travaille en Angleterre et cherche à améliorer les systèmes de duplication manuscrite et mécanique. Il invente alors un procédé qui permet d’imprégner une feuille de papier d’une substance, mélange de laque et d’encre, et une fois cette feuille placée dans une machine à écrire ou à plat sur une autre feuille vierge, de reproduire un document par frottement ou frappe[1].
Cette invention sera encore maintenant utilisée par les tatoueurs pour retranscrire un motif et venir ensuite le placer sur la peau de leur client avant de les tatouer : dans le jargon ça s’appelle le « papier carbone ».
Au XIXe siècle, la volonté d’avancer plus vite, plus loin et plus fort se fait sentir dans tous les domaines de la société et le tatouage ne va pas y échapper. À cette époque, les seules personnes qui tatouent sont principalement des marins ou des voyageurs qui reviennent avec des expériences, des outils que l’on peut qualifier de traditionnels, des os, des pics de porcs‑épics, des épines de végétaux et ces personnes s’adonnent au tatouage sur des bateaux, au fond de certains bars — mais rien de professionnel ni même de mécanisé. Le premier shop de tatouage n’ouvrira qu’en 1875.
‑1873 : Un an avant l’invention du stencil, William Gibson Arlington Bonwill, dentiste américain dépose le brevet pour son invention, le Dental Electromagnétique Mallet (maillet électro magnétique ou Dental Plugger). Son outil permettait, grâce aux déplacements d’une tige en métal à l’intérieur d’un tube, de créer de petits martèlements et d’installer de petites particules d’or ou d’argent dans les creux dentaires de ses patients.
‑1875 : aux États‑Unis, l’inventeur de l’ampoule électrique et du phonographe, le scientifique et industriel Thomas Alva Edison apporte sans le savoir une pierre à l’histoire de la machine à tatouer. Cet homme a déposé des milliers de brevets tout au long de sa vie. Reste que son titre de « père » ou « grand‑père de la machine à tatouer » est selon moi quelque peu usurpé, bien que sa notoriété à l’époque, son impact historique et technique rayonnent encore dans nos foyers. Son statut de lobbyiste de l’époque a en effet presque effacé tous les autres ingénieurs de l’histoire.
Ainsi, Edison invente en 1876 l’Electric Pen, avec l’assistance de Charles Batchelor. Leur préoccupation commune est de fabriquer un outil électrique autonome qui permette de copier rapidement des documents manuscrits afin d’équiper écoles et administrations. Le principe de l’outil est simple et toujours alimenté par une pile. Des bobines en cuivre (encore des bobines), type électro‑aimant, sont placées sur un axe horizontal et viennent faire tourner une roue en métal, elle placée à la verticale. Sur cette roue est placée une cam, pièce de métal qui permet de passer d’un mouvement circulaire à une rotation décentrée, et ainsi d’obtenir un mouvement elliptique, de haut en bas. Ce même mouvement entraîne alors une tige en métal placée dans un tube (celui tenu en main). La tige monte et descend à raison d’un cycle situé entre 15 et 50 frappes par minute.
Pour reproduire le document, on place une feuille de papier que l’on vient perforer avec cette machine en formant le motif souhaité (on repasse sur le motif ou le texte original). Le papier perforé est ensuite utilisé comme pochoir : placé sur une autre feuille de papier vierge, il recueille la poudre ou l’encre dispersée sur la première pour révéler le motif.
En 1877, Thomas Edison dépose un autre brevet, celui du Stencil Pen, plus compact. Il supprime l’élément rotatif, place les deux bobines électromagnétiques côte à côte et installe le tube de prise en main en partie centrale. Ainsi il rend l’outil plus équilibré pour l’utilisation. Cependant, pour la fabrication, les deux bobines ont un poids assez conséquent qui rend l’outil inconfortable pour une utilisation longue. Ces deux inventions d’Edison sont les clés de ce qui va suivre.
‑1891 : L’histoire raconte que c’est lors d’un passage devant un magasin de fournitures de bureau, que le tatoueur new‑yorkais, Samuel O’Reilly, comprend les possibilités de l’Electric Pen d’Edison. Il tatoue à l’aide d’un outil dentaire proche de celui du Dental mallet de Bonwill mais voit en l’invention d’Edison un nouvel outil. Le brevet venant d’expirer, il saute sur l’occasion, récupère quelques plans et dessine son propre modèle qu’il tentera de faire breveter à trois reprises, la dernière étant la bonne.
Samuel O’Reilly dépose alors en 1891 le premier brevet pour une machine à tatouer qui diffère en quelques points du modèle d’Edison :
‑un décentrage du poids principal est effectué par déviation de l’axe de la tige principale, celle‑ci est montée sur un bras à pivot, ce qui permet au‑dessus de la main de supporter l’outil et donc d’alléger la sensation de poids ;
‑un réservoir d’encre est installé au bout de la buse afin de pouvoir éviter les ruptures de trait dans le tatouage. Ce type de buse avec « réserve d’encre » a gardé la même forme depuis.
Son modèle permet également l’utilisation de faisceaux pouvant aller d’une à trois aiguilles et il clame pouvoir tatouer une personne entièrement en moins de six semaines.
Depuis cette année, une vraie course à la machine à tatouer s’intensifie entre dépôts de brevets et revendications de paternité.
Vingt jours seulement après le dépôt de brevet de Samuel O’Reilly, c’est au tour de de l’Anglais Thomas Riley de déposer le brevet pour une machine fonctionnant avec une seule bobine (single coil) dont la base de construction est largement empruntée à une sonnette de porte détournée, encore une fois…en machine à tatouer ! Il rejoint alors la longue liste des tatoueurs ayant déposé à leur tour un brevet, se targuant d’être des inventeurs.
‑1894 : Sutherland Mac Donald invente le premier modèle de Pen (stylo). Ce modèle de machine est très proche de la première version industrielle développée par la marque Cheyenne dans les années 2010. Mouvement vertical de l’aiguille, aucun mécanisme apparent, léger, peu bruyant et facile à nettoyer, le tout est contenu dans un tube. Ce stylo, qui existe encore et qui est de plus de plus en plus utilisé par les tatoueurs, est très souvent décrié par les puristes qui le comparent à un vibromasseur (dildo) car sans intérêt esthétique et surtout, il fait le même bruit.
À la fin du XIXe siècle, l’électrification des foyers est croissante. Tout le monde ou presque a l’électricité chez lui : plus besoin de pile, juste une prise suffit. Nombreux sont les tatoueurs qui voient dans ce simple fait une extension vers la machine à tatouer, de nombreux foyers ont ainsi raccordés au courant électrique et l’entrée des maisons s’équipe de sonnettes de porte, c’est la période des Bell’s Machines. Ainsi, les machines à tatouer de cette époque sont‑elles fabriquées à partir de sonnettes de porte. Simples de conception, faciles à modifier pour leur transformation — aucune notion d’ingénierie n’est requise —, elles peuvent désormais fonctionner sur secteur, sans besoin de batteries.
‑1899 : Alfred Charles South développe sa machine à deux bobines, directement empruntée aux composants et à la géométrie des sonnettes de porte.
‑1904 : Charles Wagner (NY) dépose le premier brevet de machine à tatouer aux États‑Unis, une machine double bobine avec un alignement latéral, suite de la seconde machine d’Edison inventée en 1877 tout en s’inspirant des composants du maillet dentaire de Bonwill inventé lui en 1875…
A la veille de la première guerre mondiale, le tatouage dans le monde est en plein essor, le flux de soldats permet de conforter les styles mais l’évolution de la machine à tatouer se stabilise.
Ce n’est qu’en 1924 qu’un nouveau tatoueur entre en scène et questionne l’esthétique de la machine et sa facilité d’utilisation. Percy Waters, tatoueur américain, dépose un brevet et vient ajouter plusieurs standards de construction à sa machine et une « innovation » majeure encore inspirée du passé.
Avant tout, il dissocie la machine d’un boitier existant : elle n’est plus dans une boîte, il lui offre un cadre, sorte de support en métal qui soutient tous les composants de la machine (bobines, ressort, vis de contact, etc…) Il réfléchit au poids de la machine, cherche à l’alléger. Il s’inspire du modèle d’Alfred Charles South de 1899 et vient placer un interrupteur sur le cadre de sa machine et un sur le corps de la buse. Il suffisait d’appuyer avec son index pour faire fonctionner la machine. A cette époque le tatoueur n’arrêtait pas sa machine entre deux changements de couleur… seul un boitier type transformateur permettait de le faire.
Percy Waters se questionne encore sur le business que la standardisation peut lui rapporter en parallèle de son activité et développe en 1929 quatorze modèles de machine à tatouer qu’il dépose, des standards aux formes encore identifiables de nos jours.
Il ne dépose pas l’objet mais bel et bien sa forme : quatorze formes de cadre de machine au total qui permettront aux tatoueurs d’accéder à des machines différentes tant sur le plan esthétique que sur leur utilisation : liner / shader en fonction du style, du motif à tatouer.
Il crée ainsi des cadres à vendre pour monter, assembler soi‑même sa machine avec de vraies avancés simplifiées quant aux réglages de la machine.
Ainsi, les tatoueurs pourront changer les buses plus facilement, régler l’angle de la vis de contact supérieure, une foule de détails qui feront passer du standard à la personnalisation des réglages pour un tatoueur.
Depuis cette période, d’autres tatoueurs se sont investis dans cette évolution et le dépôt de formes de cadre : Milton Zeis, Paul Rogers, Bill Jones, Owen Jensen.
Ce qui est surprenant et plaisant à la fois en plongeant dans cet univers c’est d’observer à quel point la recherche de performance s’est accrue au fil du temps dans cette approche de cet outil qu’est la machine à tatouer.
Pour autant, avec le recul, une chose me paraît claire désormais, c’est que la machine à tatouer n’appartient pas à une seule personne.
Certes il est toujours possible de revendiquer sa forme, son esthétique mais quant au reste de ses composants, il serait maladroit de vouloir en accorder la paternité à une seule personne.
Tout ce qui fait la machine à tatouer est issu de siècles de recherches, d’inventions auxquelles je n’ai pas participé, tout comme d’autres fabricants : je n’ai fait que récupérer ce que d’autres ont découvert par le passé. De leurs échecs, réussites et savoirs j’ai puisé ce qui m’a semblé le plus judicieux pour poursuivre cette aventure[2].
Et, si vous avez encore des questions sur ce qu’est une machine à tatouer, faites comme moi : creusez !
[1].↑. Première version mécanique : 1714 par l’Anglais Henry Mill, puis 1857 par Samuel Ward Francis.
[2].↑. Je souhaiterais ici remercier ceux qui m’ont guidé depuis une dizaine d’années, à commencer par Karl Marc, ce magicien du Buzzz et du Smooth à qui je pense régulièrement. Merci à Hugo Fulop pour son approche de la coil en toute sensibilité, à Raphyo6.36 sans qui la machine serait encore une invention outre‑Atlantique, et sans qui l’histoire de la bobine solénoïde ne serait pas. Merci également à Mike Schaefer pour son honnêteté critique sur le milieu des fabricants et toute l’ingéniosité qu’il partage avec humilité. Merci encore à toutes celles et ceux qui ont pris le temps d’enlever leurs gants entre deux clients pour me donner leur point de vue sur cet outil magique qu’est la machine à tatouer. Merci enfin à ceux qui n’ont pas voulu répondre à mes questions, car pour eux le métier n’est plus ce qu’il était et que tout change trop vite.