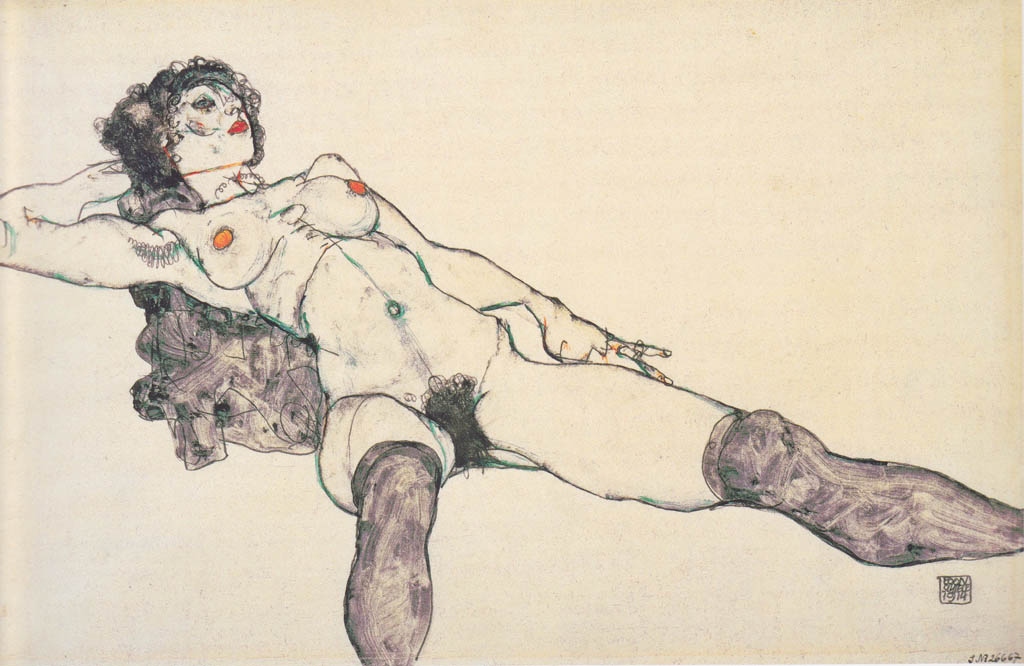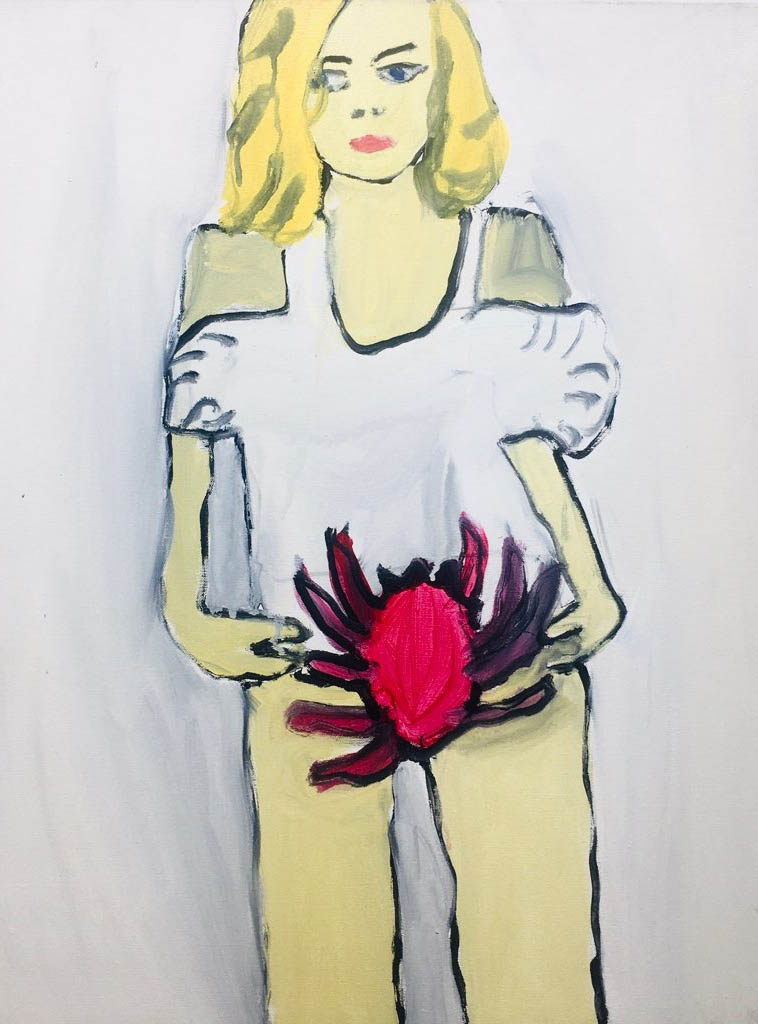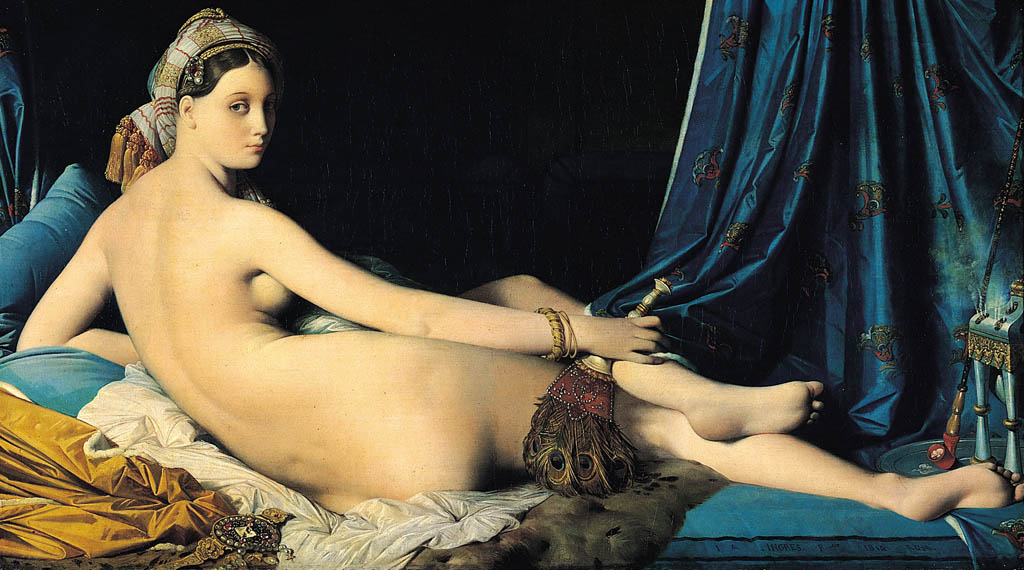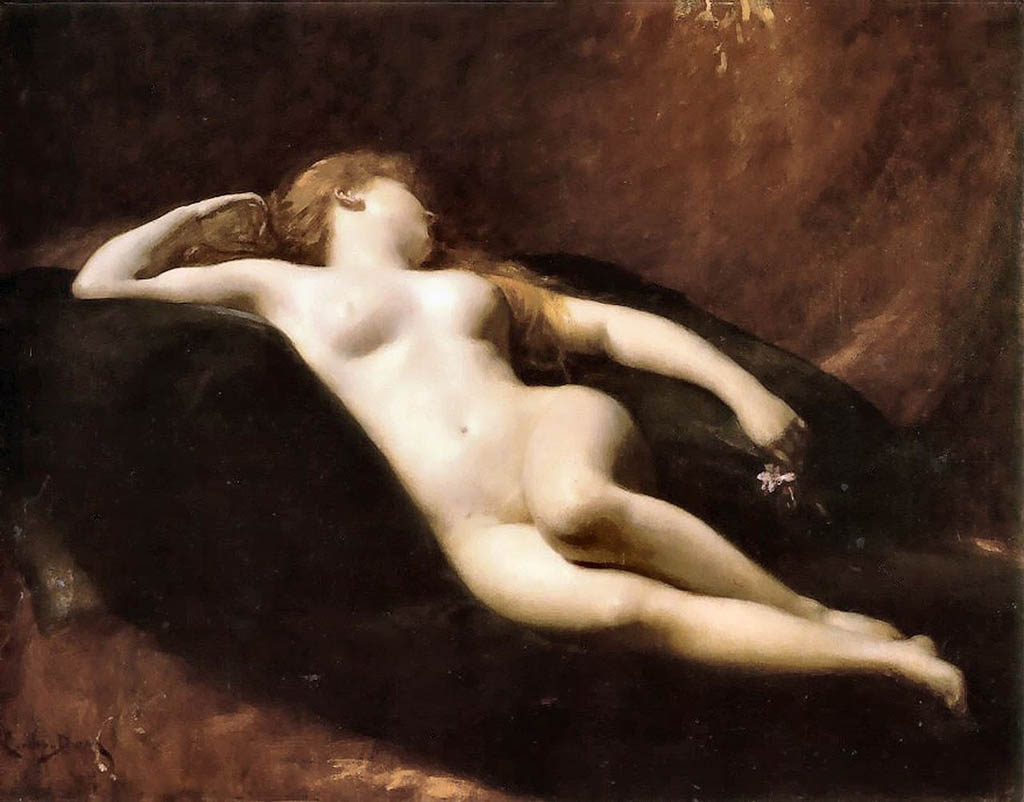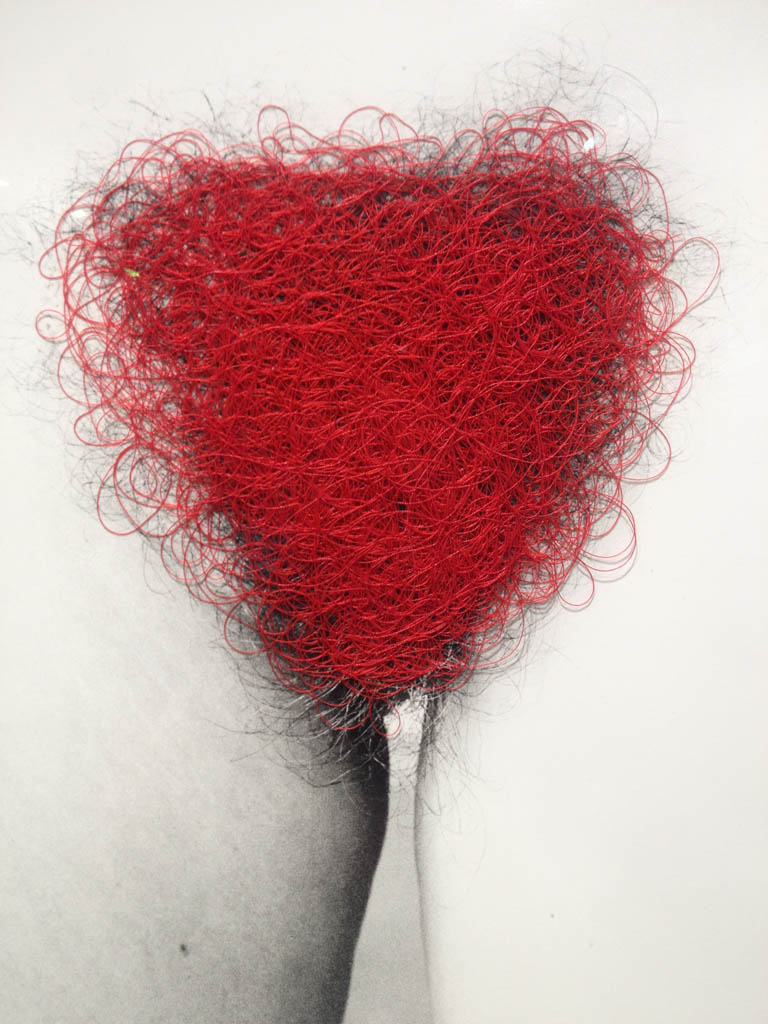Référence électronique
Fortier C., (2022), « Du Bain turc à l’Origine du monde », La Peaulogie 9, mis en ligne le 11 juillet 2022, [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/bain-turc-origine-monde
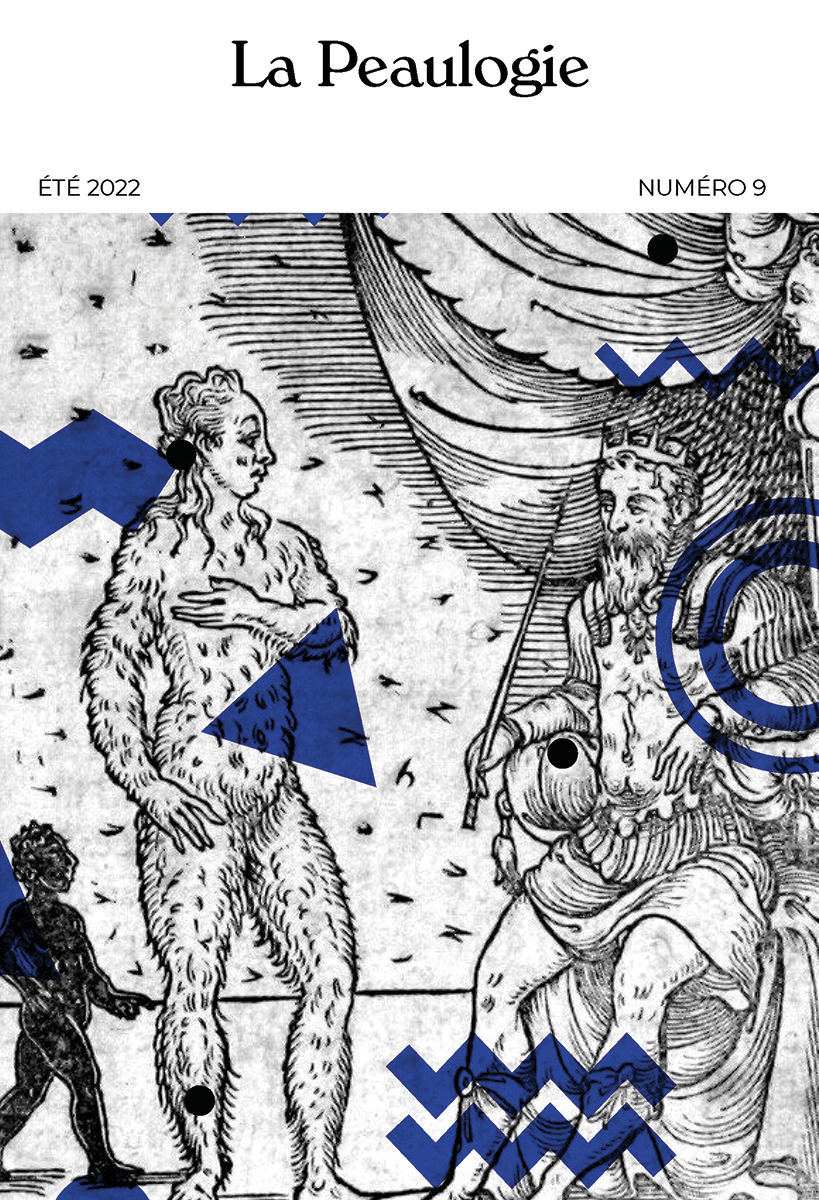
Du Bain turc à l’Origine du monde. Femmes, barbu(e)s, imberbes, efféminés et autre troisième genre dans l’art occidental et dans le monde arabo-musulman
-
Description
Corinne FORTIER
Anthropologue et réalisatrice, Chargée de Recherche au CNRS, membre du Laboratoire d’Anthropologie Sociale du Collège de France, médaille de bronze 2005 du CNRS, spécialiste du corps, du genre et de l’identité.
Résumé
La pilosité est conçue dans de nombreuses sociétés comme un élément immédiatement perceptible qui manifeste clairement la différence corporelle entre les sexes. Ôter ses poils pour une femme ou laisser pousser sa moustache ou sa barbe pour un homme visent à distinguer visiblement les deux sexes et permettent de réaffirmer culturellement leur différence anatomique. Une telle exigence cache en creux la crainte qu’une indifférenciation originelle toujours latente ne se développe, la confusion des sexes étant considérée comme nuisible et dangereuse pour la bonne reproduction de la société. Cette peur de l’indifférenciation est particulièrement prégnante dans le monde arabo‑musulman (notamment persan) ainsi que dans l’art occidental où la différence physique entre les hommes et les femmes est clairement marquée.
En dépit du fait qu’un même terme puisse être utilisé pour les cheveux et les poils, ceux‑ci n’ont pas le même statut, surtout pour les femmes, car si celles‑ci, en certains contextes, épilent leurs poils pour se féminiser, il est beaucoup plus rare qu’elles se rasent les cheveux. En tant qu’objets du désir masculin, les femmes, les efféminés, les imberbes et les femmes trans ont en commun d’avoir recours à la chirurgie sexuelle que représente l’épilation afin d’ôter les poils qui les masculiniseraient dans le but implicite de ne pas réveiller l’angoisse de castration masculine. En revanche, la figure inverse de l’homme efféminé, la femme masculinisée, se rencontre peu à l’échelle des sociétés humaines, la femme à barbe n’étant en aucun cas érotisée par le regard masculin.
Mots-clés
Poils, Genre, épilation, Art occidental, Monde arabo‑musulman
Abstract
Hair is conceived in many societies as an immediately perceptible element that clearly manifests the bodily difference between gender. Removing hair for a woman or growing a mustache or beard for a man is a way to distinguish gender and to culturally reassert the anatomical difference between men and women. Such a requirement hides the fear that an original indifference always latent will develop, the confusion of gender being considered as dangerous for reproduction of society. This fear of undifferentiated is particularly prevalent in the Arab‑Muslim world including the Persian world and in Western art where the physical difference between men and women is clearly marked.
Despite the fact that the same term is usually used in many languages for hair and hairs, they do not have the same status, especially for women. In certain contexts, women shave their hairs to feminize themselves, but it is much rarer for them to shave their hair. As objects of male desire, women, effeminate, beardless and trans women have in common the use of sexual surgery represented by the removal of their hairs that would masculinize them in order implicitly not to awake the anguish of male castration. On the other hand, the opposite figure of the effeminate man, the masculine woman, is very uncommon, the bearded woman being in no way eroticized by the male gaze.
Keywords
Hair, Gender, Hair Removal, Western Art, Middle East
« Beau jeune homme, à la peau lisse et aux dents fines
dans les poils de mon pubis vient d’éclore pour toi du gui »
(chanson de femmes Massa du Tchad et du Nord‑Cameroun,
De Garine, 1987, 111).
« Je le voudrais jeune aussi, et vigoureux,
Un homme cependant, avec les cheveux crépus
Moulés en un millier de pièges et de boucles
Les yeux de Vénus et de Minerve,
Des sourcils arqués, comme l’arme de Cupidon,
Le front, un vaste champ de neige,
Le nez égal, et de plus la joue
Lisse comme est la boule de billard,
Le menton, velouté comme la pêche,
Et sa lèvre devra enseigner le baiser,
Jusqu’à ce qu’il aime trop la barbe
Et qu’il fasse peur à l’Amour ou à moi ».
Ben Jonson[1], Un homme à son goût, cité par Germaine Greer (2003, 49)
La pilosité est conçue dans de nombreuses sociétés comme un élément immédiatement perceptible qui manifeste clairement la différence corporelle entre les sexes. Ôter ses poils pour une femme ou laisser pousser sa moustache ou sa barbe pour un homme visent à distinguer visiblement les deux sexes et permettent de réaffirmer culturellement leur différence anatomique. Une telle exigence cache en creux la crainte qu’une indifférenciation originelle toujours latente ne se développe, la confusion des sexes étant considérée comme nuisible et dangereuse pour la bonne reproduction de la société. L’œuvre de l’artiste français Marcel Duchamp (1887‑1968) intitulée L.H.O.O.Q. (1919) qui affuble d’une moustache la Joconde de Léonard de Vinci (1452‑1519) témoigne d’une telle subversion des genres, l’artiste jouant avec les codes visuels de la pilosité qui marquent la différence des sexes.
Cette peur de l’indifférenciation est particulièrement prégnante dans le monde arabo‑musulman où la différence physique entre les hommes et les femmes est clairement marquée. Dans cette partie du monde, la barbe (lahya) ou la moustache (shārab) est la marque visible pour l’homme de la masculinité, et de la supériorité qui lui est attribuée comparativement à la femme[2]. Cette idée est explicitement énoncée dans des locutions proverbiales telles que : « La barbe avant la tresse » (lahya sābig azfīra) (Fortier, 2010a, 102)[3]. Ce proverbe oppose la barbe des hommes aux cheveux des femmes, emblèmes visuels du masculin et du féminin.
Aussi, dire d’un homme qu’il n’a pas de moustache (Bourdieu, 1972, 60, note 4) ou de barbe (Fortier, 2010a, 102) dans les sociétés arabo‑musulmanes constitue une insulte qui équivaut à souligner son manque de virilité. Ce qui n’empêche pas que, dans ce contexte culturel comme dans d’autres, la figure de l’imberbe puisse être érotisée, à la différence de celle, inverse du point de vue du genre, de la « femme à barbe ». Outre que notre analyse concerne essentiellement le monde arabo‑musulman et occidental, nous ne nous interdirons pas quelques incursions dans d’autres sociétés dans la perspective d’une approche comparée qui vise à rendre intelligible un sujet moins futile qu’il n’y paraît dont l’étude permet de mettre au jour, au‑delà des différences, des représentations récurrentes sinon universelles, à travers l’approche conjuguée de l’anthropologie, de la psychanalyse, de l’histoire de l’art et des études visuelles.
L’ÉPILATION FÉMININE : UNE FORME D’EXCISION
Dans le monde arabo‑musulman, l’épilation est une pratique culturelle qui vise à annihiler la pousse naturelle des poils chez les femmes ; celle‑ci étant d’emblée associée au masculin, laisser pousser cette pilosité virile viendrait à masculiniser la femme, produisant à terme, un corps bisexué, comble de l’abomination. Ainsi, dans de nombreuses sociétés arabo‑musulmanes, l’épilation commence dès la naissance de la fillette de peur que le masculin ne prenne le dessus sur le féminin. C’est le cas dans la société maure de Mauritanie où la pilosité est retirée par anticipation (Fortier, 1998) afin d’empêcher qu’elle ne se développe. Dès la naissance, la mère ôte le duvet qui recouvre le visage, les bras ou les jambes de la petite fille à l’aide du colostrum, premier lait maternel qui n’est pas donné à boire au nourrisson (Fortier, 2001). On retrouve cette pratique dans d’autres pays, notamment en Iran, où l’application du colostrum est censée empêcher l’apparition des poils à l’âge adulte sur les parties du corps où il a été appliqué enfant (Riahi, 1986, 50).
Il est par ailleurs significatif que, dans la société maure de Mauritanie, simultanément à l’épilation, une autre opération est effectuée sur le corps de la petite fille sept jours après sa naissance : l’excision (Fortier, 2012). Ces deux interventions ont non seulement en commun d’être réalisées très précocement mais possèdent la même finalité : retirer ce qui est considéré comme masculin, voire phallique, chez la femme, à savoir tout ce qui dépasse, respectivement la pilosité et le capuchon clitoridien. À cet âge précoce, ce qui est soustrait du corps de la fillette ne consiste qu’en un fin duvet et un minuscule capuchon clitoridien, mais, dans la mesure où ces éléments anatomiques sont associés à des attributs masculins, il s’agit de mesures de prévention réalisées de bonne heure pour empêcher que le poil ne pousse et que le clitoris ne se développe.
Ainsi, l’ethno‑psychanalyste Georges Devereux (2011, 148, 152) avait relevé le caractère masculin du poil pubien dans la société somali, société qui pratique l’épilation en plus de cette forme extrême d’excision que représente l’infibulation (Fortier, 2020b, 47) : « Cas 1 ‑ Les quelques données publiées indiquent que le poil pubien féminin a une connotation masculine phallique […]. Ainsi, un Somali, qui, lors d’une visite à Budapest, eut des rapports avec une hongroise, fut surpris par son poil pubien au point de le transformer, en rêve, en un visage barbu ».
Devereux avait par ailleurs noté que cette représentation n’était pas propre à la société somali mais se retrouvait également en France (2011, or. 1983, 124) : « Cas 2 – Le poil pubien surabondant de la maîtresse d’un analysant devait être périodiquement coupé afin de ne pas les gêner durant le coït. Cet acte était familièrement appelé “tailler la barbe de Josephus” ‑ Josephus étant le petit nom que mon patient donnait au sexe de son amie. […]. Cas 7 – Un statisticien réputé vit, alors qu’il était encore enfant, sa mère nue et prit son poil pubien pour un pénis. Cette illusion d’optique fut si forte que parvenu à l’âge adulte, il se rappelait encore “avoir vu” le poil pubien de sa mère comme un pénis ». Relativement aux derniers cas cliniques rapportés par Devereux, on peut ajouter qu’un des vocables utilisés en français pour désigner le sexe féminin témoigne qu’il est associé à cet attribut masculin et phallique que représente la barbe : le « barbu ».
L’ÉPILATION COMME « TECHNOLOGIE DU GENRE »
L’épilation comme l’excision correspondent à des « technologies du genre » (technology of gender), pour reprendre le concept de Theresa De Lauretis (2007, or. 1987), et en l’occurrence à des pratiques de démasculinisation, et par ricochet de féminisation. L’épilation comme l’excision s’apparentent à des « chirurgies esthétiques » visant à féminiser le corps et à « l’embellir », expression qui est d’ailleurs utilisée dans la société maure de Mauritanie (zayan), mais aussi dans d’autres sociétés arabo‑musulmanes où l’on pratique l’excision, comme en Égypte où la nouvelle excisée est appelée « l’embellie » (Fournier, 2011, 58).
Aussi, nous parlerons à propos de l’épilation comme de l’excision de « chirurgie sexuelle ». Ce concept (Fortier, 2022b) inclut toute forme d’opération qui n’est pas strictement chirurgicale mais qui vient transformer visiblement les corps et les identités. En outre, la « chirurgie sexuelle » (Fortier, 2020a) possède une dimension doublement sexuée, en tant qu’elle vient sexuer le corps, en l’occurrence le féminiser, en même temps que le sexualiser, au sens de le rendre érotique et désirable. De surcroît, ces chirurgies sexuelles que représentent l’épilation féminine ou l’excision visent à effacer ce qui pourrait évoquer le masculin chez la femme afin de susciter le désir des hommes sans réactiver leur angoisse de castration (Fortier, 2020b).
En français, le terme de toison peut renvoyer autant à la « toison pubienne » que « capillaire ». C’est aussi le cas dans de nombreuses sociétés où les cheveux et les poils (pubis, aisselles…) sont désignés par un unique vocable, en anglais par le mot hair, en arabe par le terme sha’ar, ou encore en grec ancien où l’expression employée (Ή εθειρα) pour nommer la chevelure se réfère aux poils pubiens (Cootjans, 2000, 55).
En dépit du fait qu’un même terme puisse être utilisé pour les cheveux et les poils, ceux‑ci n’ont pas le même statut, surtout pour les femmes, car si celles‑ci, en certains contextes, épilent leurs poils pour se féminiser, il est beaucoup plus rare qu’elles se rasent les cheveux, ce qui les masculiniserait. À cet égard, en France, les femmes en chimiothérapie conçoivent la perte de leurs cheveux comme une atteinte à leur féminité (Bromberger, 2010, 81‑83), recourant le plus souvent à un bandeau ou à une perruque pour dissimuler cette perte.
Le rasage des cheveux féminins peut représenter une punition semblable à une castration comme le montre pendant la seconde guerre mondiale en France la tonte publique des femmes accusées d’avoir couché avec l’occupant (Virgili, 2004). Une même logique de sacrifice de la féminité est à l’œuvre chez les femmes hindoues (Obeyeskere, 1981) ou les nonnes bouddhistes (Schneider, 2018) qui se rasent volontairement les cheveux pour des raisons religieuses.
Par réaction à la sexualisation de leur corps, notamment de leurs cheveux, certaines femmes, issues du mouvement punk, choisissent de les raser, tandis que d’autres, de confession musulmane, préfèrent les voiler (Fortier, 2017a)[4]. Dans une perspective similaire de désexualisation, la chanteuse américaine Britney Spears (née en 1981) se rasa la tête en 2007 afin d’échapper à son statut de sex‑symbol, geste totalement incompris qui lui valut d’être traitée de « folle » et d’être internée dans un hôpital psychiatrique ; elle souffrait en l’occurrence que ses fans lui « touchent les cheveux »[5], pratique fétichiste qui témoigne de l’attrait érotico‑sexuel que peuvent susciter les cheveux féminins en tant que substitut sexuel.
L’ORIGINE DU MONDE : L’OBSCÉNITÉ PILEUSE PORNOGRAPHIQUE
Les odalisques orientales aux corps lisses comme des poupées de porcelaine est un topos de la peinture occidentale, qu’on pense au Bain turc (1862) de Jean‑Auguste‑Dominique Ingres (1780‑1867) en forme de tondo, forme ronde qui rappelle le dispositif voyeuriste du trou de la serrure (Guéguan, 2006, 67). Comme le remarque Régis Michel (2000, 167) : « L’irréalité — ou plus précisément la déréalisation — de la femme ingresque passe notamment par la censure de son système pileux. Non seulement elle n’a pas de sexe, mais elle n’a pas non plus son accessoire usuel : la toison pubienne. Dans le code ultra‑puritain qui régit l’univers d’Ingres (l’épithète est impropre : elle ne désigne que l’exorcisme fanatique de l’élément charnel), la répression de la pilosité se révèle une exigence prioritaire. Le poil est obscène parce qu’il introduit du vivant dans ce monde fossile : du réel dans ces productions faussaires. Aussi les femmes d’Ingres sont‑elles épilées par un pinceau vorace avec la minutie panique d’une névrose obsessionnelle ».
https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010066606
Le Bain turc (1862), Jean Auguste Dominique Ingres, peinture à l’huile, 108 x 108 cm,
photographie © 2005 RMN Grand Palais (musée du Louvre) / Gérard BlotCe tableau appartenait au diplomate turco‑égyptien Khalil‑Bey (1831‑1879) qui, dans son appartement parisien, avait acquis entre 1865 et 1868 une collection de peintures érotiques, « la première qu’ait formée un enfant de l’Islam » selon Théophile Gautier (1811‑1872) (Haddad, 2000, 139)[6]. Or, en plus de cette toile dépeignant des corps sans aspérités ressemblant à des statues de marbre, Khalil‑Bey possédait un tableau à l’opposé du Bain turc qui représentait le sexe velu d’une femme dans un zoom quasi cinématographique[7] inspiré du cadrage des photos pornographiques de l’époque (Des Cars, 2008, 382 ; Schicharin, 2018) ; il s’agit de l’Origine du monde (1866), commandée par Khalil‑Bey à Gustave Courbet (1819‑1877), « tableau qui reprend sans conteste les figures obligées de l’image obscène contemporaine (pilosité, parties génitales exposées, linge repoussé) […] » (Des Cars, 2008, 382).
Une des caractéristiques pornographiques de ce tableau tient au close‑up sur le sexe de la femme. Celle‑ci, sans visage, est restée longtemps sans identité, jusqu’à ce que Claude Schopp (2018), travaillant sur la correspondance d’Alexandre Dumas‑fils tombe sur une phrase qui retint son attention : « […] on ne peint pas de son pinceau le plus délicat et le plus sonore l’intérieur de Mlle Queniault de l’Opéra », révélant que Khalil Bey avait fait poser sa maîtresse de l’époque, Constance Quéniaux (1832‑1908), célèbre courtisane et danseuse à l’opéra de Paris.
L’historienne d’art britannique Lynda Nead (1992, 17, note 31) observe que le plaisir visuel dans l’art occidental est lié à un modèle de corps féminin totalement lisse, tel que le représente Jean‑Auguste‑Dominique Ingres dans le Bain turc, tendance qui est liée à une « une peur profonde ainsi qu’à un véritable dégoût du corps et de la féminité à l’intérieur de la culture patriarcale ». Courbet, en revanche, propose un nu qui ne protège pas le spectateur de l’anxiété que peut provoquer la vue du sexe féminin[8].
Comme le remarque Jean Clair (1988, 66‑67), peindre le sexe féminin est d’abord une manière de dépasser le danger que celui‑ci exerce afin que, d’iconique, sa représentation devienne apotropaïque : « Encore faut‑il préciser que cette peur et cette répulsion ne sont l’autre face que cette incessante fascination du peintre pour ce même corps et que tableau n’est là précisément que pour donner corps à cette attirance ambiguë : prophylactique, il iconise les corps féminins pour éviter d’avoir à le représenter, de telle sorte qu’il laissera à la pulsion érotique toute liberté d’aller se fixer ailleurs. C’est dans la mesure où le tableau n’est plus une représentation “achevée” mais un processus d’exorcisme, toujours en cours et donc toujours inachevé, qu’il permet d’opérer ce clivage, dans l’ordre du désir, à l’intérieur de ce fascinum et de ce tremendum du corps sexué, entre ce qui est ressenti en lui comme “bon”, attirant, désirable et gratifiant et ce qui est ressenti comme “mauvais”, repoussant, funeste, dangereux ». Le clivage qui s’opère dans l’esprit de l’artiste qui peint un sexe féminin comme dans celui qui le regarde, est le même que celui que provoque la vision de la tête de Méduse dans la mesure où les deux représentations se confondent : « Si la tête de Méduse se substitue à la figuration de l’organe génital féminin, ou plutôt si elle isole son effet excitant l’horreur de son effet excitant le plaisir on peut se rappeler que l’exhibition des organes génitaux est encore connue par ailleurs comme acte apotropaïque » (Freud 1985, or. 1922, 45).
L’ORIGINE DU MONDE : UN SEXE GORGONE SOURCE D’EFFROI
La fente légèrement ouverte du sexe de l’Origine du monde laisse apparaître un sourire, comme si celui‑ci souriait au spectateur ; un des noms en français du sexe féminin n’est‑il pas le « sourire d’en bas », expression qui présuppose que le sexe est visage. Examinée de plus près, cette ouverture peut aussi inquiéter car elle laisse poindre un clitoris entouré de poils qui rappelle la tête de Méduse, le plus souvent figurée avec une barbe (Frontisi‑Ducroux et Vernant, 1997, 71) et une chevelure proéminente. Ainsi que le relève le psychanalyste Sandor Ferenczi (1974, 200) : « L’analyse des rêves et des associations m’a amené plusieurs fois à interpréter la tête de la Méduse comme le symbole effrayant de la région génitale féminine dont les caractéristiques ont été déplacées “du bas vers le haut” ».
De plus, à l’instar du sexe‑visage de l’Origine du monde, la tête de Méduse est « coupée », car, comme l’explique Julia Kristeva (1998, 37) : « Méduse‑Gorgone ne devient supportable qu’en tant qu’eikôn. Coupez la tête du monstre et proposez son reflet à la vue : ce n’est qu’ainsi que vous serez protégés de la mort et du sexe féminin qui pourrait vous y absorber ». Tel est précisément le geste apotropaïque qu’accomplit l’Origine du monde en tant qu’il coupe le corps de la femme pour ne représenter que le sexe féminin/gorgone.
https://www.musee-orsay.fr/fr/oeuvres/lorigine-du-monde-69330
L’Origine du monde (1866), Gustave Courbet, huile sur toile, 46 x 55 cm,
musée d’Orsay photographie © Musée d’Orsay, Dist. RMN‑Grand Palais / Patrice SchmidtDevereux (2011, 38‑39, or. 1983, 21) rapporte que son étude sur la tête de Méduse ou Baubô lui a été inspirée par des photos de toisons pubiennes entrevues dans Playboy : « En 1976, feuilletant Playboy chez mon coiffeur, je vis la photo d’une ravissante Noire nue qui […] étalait son poil pubien, réduit à une sorte de crête verticale “phallique”. Peu après je vis une autre photo d’une telle toison “phallique”. […]. Ce furent sans doute ces deux photos, montrant la toison réduite à une sorte de crête verticale et ressemblant, par conséquent, à un phallos, qui cristallisèrent pour moi le problème de base de la présente étude et me permirent de faire, en 1976, un exposé provisoire sur Baubô […] ».
Comme le remarque la psychanalyste Janine Filloux (2002, 108) : « […] la figure de Méduse assure de façon continue une possibilité de donner expression et de canaliser l’impact de la “peur du féminin”. C’est par le mythe que Freud se saisit du regard d’effroi de la différenciation sexuelle, de l’interdit porté sur l’origine de l’espèce, sur le sexe en tant qu’il est sexe maternel, sur la sexualité d’une mère devenue monstre terrifiant et pétrifiant puisque sa vue seule suffit à vous changer en pierre, pour formuler sa conception de l’angoisse de castration et sa représentation fantasmatique d’une mère monstrueuse. L’horreur du sexe de la mère est horreur de l’inceste. La figure de Méduse est possibilité de représentation de l’horreur de la fusion incestueuse avec l’animalité de la nature femelle, de l’horreur de l’inceste prototypique sous forme de fantasme de retour à l’origine ».
On comprend alors l’aspect terrifiant que peut revêtir l’Origine du monde pour les spectateurs, ainsi que les raisons ayant poussé les différents acquéreurs de ce tableau à le dissimuler au regard : « Ces écrans successifs seraient alors les artifices par lesquels les divers propriétaires auraient cherché à mettre à distance cette Origine du Monde/Gorgone » (Bernardi, 2014, 147).
La toile, longtemps tenue cachée, est exposée en 1995 au musée d’Orsay. Sa présentation est alors accompagnée d’une notice selon laquelle cette œuvre « échappe au statut d’objet pornographique », assertion qui semble d’autant plus nécessaire d’affirmer qu’elle ne va pas de soi ; rappelons qu’elle sera interdite en 2011 par Facebook.
L’acte artistique de Fanny Viollet (née en 1944) à l’égard de l’Origine du monde vient renouer avec la logique du caché/montré qui a toujours accompagné cette toile. En 1996, alors que des cartes postales du tableau de Courbet sont éditées par le musée d’Orsay, l’artiste française contemporaine a l’idée de les « rhabiller »[9] par une petite culotte (Viollet, 2014, 5‑6) dont l’une, de coton blanc[10], laisse tout de même voir par transparence l’ombre à la fois érotique et menaçante de la toison pubienne.
Parmi les diverses petites culottes plus ou moins innocentes dont Fanny Viollet recouvre l’Origine du Monde, l’une arbore humoristiquement un lion rugissant, suggérant la potentielle dangerosité et férocité du sexe féminin.
La toile de Courbet continue à déranger sinon à choquer ceux qui, au détour d’une salle, se retrouvent nez à nez avec elle, sans doute parce que ce tableau place le spectateur en position de voyeur. Position qui est d’autant plus difficile à assumer dans un espace public où, à la différence du dispositif scopique pornographique habituel dans lequel le voyeur regarde sans être vu, le visiteur regarde tout en étant lui‑même regardé, ses réactions d’effroi ou/et de plaisir pouvant être épiées.
L’artiste française ORLAN (née en 1947) brise le dispositif scopique selon lequel les hommes regardent le sexe féminin sans eux‑mêmes être vus quand, dans une performance, elle donne à voir son sexe poilu tout en filmant les réactions des spectateurs. Ceux‑ci sont le plus souvent effrayés par ce sexe macroscopique, observé à travers une loupe, qui rappelle une « tête de Méduse », d’où le nom donné à cette œuvre : Étude documentaire : la tête de Méduse (1978), que l’artiste (ORLAN, 2002, or. 1995, 5) explique ainsi : « J’ai réalisé une performance intitulée Étude documentaire : la tête de Méduse ; il s’agissait devant une énorme loupe de montrer son sexe dont les poils d’un côté étaient peints en bleu, et ce, au moment de mes règles, un moniteur vidéo montrait la tête de celui ou celle qui allait voir, un autre montrait la tête de ceux ou celles qui étaient en train de voir, à la sortie le texte de Freud sur la tête de Méduse était distribué, texte qui dit “à la vue de la vulve le diable même s’enfuit” »[11].
Le fait que l’Origine du monde soit exposée dans un musée rend caduque le dispositif jusque‑là attaché à sa monstration : être regardée dans un espace intime à l’abri de tout regard extérieur. En effet, Khalil Bey l’avait accrochée dans un cabinet de toilette privé alors que le Bain turc trônait dans son grand salon d’apparat (Da Silva, 2009, 54 ; Des Cars, 2008, 378), comme si le sexe lisse, poli et sage des femmes orientales était moins sulfureux, sexualisé et terrifiant que le sexe touffu de l’Origine du monde. D’autre part, son commanditaire avait élaboré un dispositif scopique particulier : le spectateur devait écarter le tissu vert — couleur du paradis en islam — qui le recouvrait afin de pouvoir le contempler en toute intimité.
Lorsqu’en 1868, pour éponger des dettes de jeu, Khalil‑Bey fut contraint de vendre aux enchères sa collection de peintures, à la différence du Bain turc[12], l’Origine du monde, immontrable, ne put être mise en vente publique (Des Cars, 2008, 379‑380). Après avoir été vendue « sous le manteau »[13], Edmond de Goncourt signale l’avoir vue en 1889, dissimulée sous une autre toile de Courbet (Le château de Blonay), chez le marchand d’art d’Extrême‑Orient Antoine de la Narde : « Et il ouvre avec une clef un tableau, dont le panneau extérieur montre une église de village dans la neige et dont le panneau caché est le tableau peint par Courbet pour Khalil‑Bey, un ventre de femme au noir et proéminent mont de Vénus, sur l’entrebâillement d’un con rose » (p. 381).
Après de nombreuses péripéties, l’Origine du monde fut acquise en 1955 par Jacques Lacan, qui, à son tour, la déroba aux regards : « Le psychanalyste demanda à son beau‑frère, André Masson, de concevoir un panneau destiné à dissimuler autant qu’à suggérer la toile. Masson peignit un étrange paysage représentant de façon allusive la composition du nu[14], qui ne devenait lisible que lorsque ce dernier était dévoilé[15] ». Lacan théorisera la problématique du voilement dans un passage de la leçon IX et X du Séminaire (1994, or. 30 janvier 1957) : « Qu’est‑ce qui peut matérialiser pour nous, de la façon la plus nette, cette relation d’interposition, qui fait que ce qui est visé est au‑delà de ce qui se présente ? Sinon ceci, qui est vraiment une des images les plus fondamentales de la relation humaine au monde, le voile, le rideau. Le voile, le rideau devant quelque chose est encore ce qui permet le mieux d’imaginer la situation fondamentale de l’amour. On peut même dire qu’avec la présence du rideau, ce qui est au‑delà comme manque tend à se réaliser comme image. Sur le voile, se peint l’absence. […]. Le rideau, c’est, si l’on peut dire l’idole de l’absence […] ».
ORIGINE DU MONDE ET MADONE : UN SEXE FÉMININ PHALLIQUE
Le dispositif de voilement/ dévoilement de l’Origine du monde possède une connotation religieuse à la fois par l’acte même du voilement qui renvoie au caché, et par le mouvement de dévoilement de l’ordre de la révélation. Dans le christianisme, c’est surtout la Vierge qui fait l’objet de ce processus de voilement/dévoilement, que ce soit à un niveau rituel ou iconographique ; c’est le cas près de Naples[16] où, sur le plan rituel, l’image de la Madone est voilée, de même que le phallus est caché par un voile vert à la villa des Mystères de Pompéi (Quignard, 1996), tandis que sur le plan iconographique, la Madone Sixtine de Raphaël (1483‑1520) est représentée derrière un rideau vert (Loyrette, 2002). On notera la constance de la couleur verte, y compris dans le choix du tissu utilisé par Khalil Bey pour dissimuler l’Origine du monde, couleur qui évoque le paradis dans de nombreuses religions.
De l’Origine du monde à la Madone, il n’y a qu’un pas, et l’analyse du titre de l’œuvre de Courbet nous y conduit. Celui‑ci renvoie davantage à la dimension procréative du sexe qu’à son aspect sexuel, de même que la figure de la « Vierge Mère » (Virgin birth) (Leach, 1980), « à l’origine du monde », incarne une procréation sans sexualité. Or, malgré ce qu’indique le titre du tableau, Courbet choisit de représenter la dimension davantage sexuelle que procréative du sexe féminin, peignant un pubis velu où le regardeur entraperçoit un clitoris, soit un sexe éminemment phallique.
Si l’Origine du monde a quelque parenté de par son titre avec la Madone, celle‑ci, en tant que « mère primitive », a également quelque accointance avec le sexe féminin tel qu’il est représenté par Courbet ; ainsi que le déclare le théologien Tertullien (Carthage, vers 150‑vers 220) : « La vierge est aussi une femme… à moins d’être un troisième sexe monstrueux » (Le voile des Vierges VII, 2, cité par Agacinski, 2005, 174). À travers le décalage entre le titre du tableau et l’image qui en est donnée, le peintre révèle l’ambivalence du sexe féminin[17], à la fois honoré eu égard à sa fonction de reproduction, mais aussi craint en tant que phallique ou pouvant cacher un phallus (Devereux, 2011, 105‑106 ; Fortier, 2020b).
L’idée d’un sexe féminin effrayant est à l’œuvre dans une photographie de l’artiste autrichienne VALIE EXPORT (née en 1940) prise par Peter Hassmann où celle‑ci, vêtue d’un pantalon découpé au niveau de l’entrejambe, écarte les cuisses de telle manière à découvrir une toison pubienne noire, objet du regard du spectateur. VALIE EXPORT arbore par ailleurs une chevelure ébouriffée, semblable à son sexe, rappelant la tête de Méduse. Cette exhibition sexuelle apparaît d’autant plus menaçante et phallique que l’artiste, dotée d’une arme à feu, se tient prête à tirer.
Cette photographie fait suite à une performance ayant eu lieu en 1969 dans un cinéma pornographique de Munich où VALIE EXPORT invitait les hommes à regarder son sexe plutôt que celui projeté sur l’écran, souhaitant ainsi dépasser le « tabou du sexe caché »[18]. Mais cette monstration effraya les spectateurs qui furent pris de « panique génitale » (genital panic) pour reprendre l’expression de VALIE EXPORT.
Cette panique est semblable à celle que provoque la vision de la Gorgone, en tant que sexe facialisé (Vernant, 1985 ; Clair, 1988, 47). Le rituel d’exhibition du sexe féminin, ainsi que l’effroi qui lui est corrélé, est connu de plusieurs sociétés. C’est notamment le cas dans la société maure de Mauritanie où les anciennes esclaves habituellement non excisées et non épilées recourent à ce type d’exhibition dans le but d’effrayer les hommes (Fortier, 2020b, 47). Devereux (2011, 53, or. 1983, 33) relève la signification de ce geste qu’on retrouve dans de nombreux contextes de par le monde : « Cela dit, lorsqu’une femme exhibe son sexe, de façon railleuse, à un homme, son intention première est de le traiter de lâche et d’eunuque. Parfois elle cherche aussi à l’intimider, en lui rappelant qu’il pourrait être “châtré” lui aussi, danger fort réel pour les vaincus au Proche‑Orient. Enfin, Ferenczi rapporte qu’une mère intimidait régulièrement son petit garçon en retroussant ses jupes devant lui[19] ».
Le motif récurrent en peinture de Judith décapitant Holopherne rend compte de cet effroi à la vue du sexe féminin, motif visuellement semblable à la tête de Méduse décapitée par Persée. Comme l’explique Freud (1985, or. 1922, 45) : « “Décapiter = castrer”, l’effroi de la Méduse est celui issu de la perception de la castration, manifestement de la vision du sexe de la mère, entouré de poils. Les serpents faisant office de cheveux et renvoyant au pénis, montrent, par la nécessité de multiplier les symboles phalliques, la très forte présence de la castration. Voir la Méduse transforme en pierre : consolation de la castration. Si l’érection est encore possible c’est que le pénis est toujours là. La tête de Méduse remplace l’organe génital féminin et vaut dans son action apotropaïque ». Cette idée est particulièrement claire dans Judith et la tête d’Holopherne (1543) du peintre hollandais Jan Massys (1509‑1575)[20] où la barbe d’Holopherne renvoie à la toison pubienne de Judith dont l’ombre pointe au niveau de son bas‑ventre. Une angoisse sourde émane de ce tableau qui témoigne que la femme est autant capable de décapitation que, son sexe, de castration.
ORIGINE DU MONDE, MÉDUSE ET TARENTULE : UN SEXE MATERNEL INCESTUEL
À une période où la psychanalyse se développe à Vienne (Schorske, 1983) et où Freud (1950, or. 1926, 133) parle du sexe féminin comme d’un « continent noir », le peintre viennois Egon Schiele (1890‑1918) représente les poils noirs de ses modèles comme d’effrayantes araignées, tant au niveau du pubis dans Nu allongé jambes écartées (1914), qu’au niveau des aisselles dans Moa (1911).
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/Schiele_-_Moa_-_1911.jpg/375px-Schiele_-_Moa_-_1911.jpg
Moa (1911), Egon Schiele, gouache, aquarelle et mine de plomb, 31 x 48 cm, Museum of modern Art, New York
Alors même que les campagnes d’affichage publicitaire utilisent largement les codes de la pornographie, en 2018, les affiches d’une exposition d’Egon Schiele[21] furent censurées dans plusieurs villes européennes, notamment à Londres et à Berlin. Le sexe féminin, représenté par Schiele de manière trop frontale, trop crue, et trop velue pour notre époque, fut dissimulé sous un bandeau sur lequel on pouvait lire : « Pardon, cent ans d’âge et toujours trop audacieux de nos jours ! »[22]. Ce bandeau venait certes cacher au regard des œuvres jugées « obscènes », mais il avait aussi implicitement pour but de préserver le spectateur d’éventuelles réactions phobiques, similaires à celles que peuvent provoquer l’Origine du monde.
Le tableau de Courbet a le pouvoir d’effrayer les hommes comme les femmes, convoquant, ainsi que l’indique son titre, l’image du sexe de leur mère dont ils sont sortis ; cet effroi est du même ordre que celui provoqué par la tête de Méduse : « L’effroi devant la Méduse est donc l’effroi de la castration, rattaché à quelque chose qu’on voit. Nous connaissons cette circonstance par de nombreuses analyses, elle se produit lorsque le garçon, qui jusque‑là ne voulait pas croire à la menace, aperçoit un organe adulte, entouré d’une chevelure de poils, fondamentalement celui de la mère » (Freud 1985, or. 1922, 49)[23]. Se retrouver « nez à nez » avec le sexe de sa mère peut susciter le dégoût (Bromberger, 2011), sentiment dont la psychanalyse montre qu’il n’est que l’inverse d’une attirance irrecevable, en l’occurrence incestueuse.
La vision enfant du sexe maternel analogue à une touffe de poils s’apparente à une sorte d’araignée. La phobie des araignées s’expliquerait par la terreur du sexe maternel, lui‑même semblable à une tête de Méduse. Selon Freud (1984, or. 1933, 157) : « D’après Abraham (1922), l’araignée est, dans le rêve, un symbole de la mère, mais de la mère phallique, qu’on redoute, de sorte que la peur de l’araignée exprime la terreur de l’inceste avec la mère et l’effroi devant les organes génitaux féminins. Vous savez peut‑être que l’image mythologique de la tête de Méduse doit être ramenée au même motif de l’angoisse de castration ».
Abraham, premier psychanalyste à évoquer le lien entre araignée et sexe maternel interprète ainsi l’un des rêves de ses analysants : « Je suis devant une armoire avec ma mère ou ma femme dans mon bureau. Lorsque je saisis une pile de dossiers, une grosse araignée velue tombe à mes pieds. Je suis content qu’elle ne m’ait pas touché. L’araignée qui tombe, c’est le pénis prêté à la mère qui s’en détache lorsque le patient s’approche de l’armoire (symbole maternel). La joie du patient de ne pas l’avoir touchée correspond à son effarouchement devant l’inceste. […]. Nous parvenons ainsi à une deuxième signification symbolique de l’araignée. Elle représente le pénis prêté à la mère et niché dans ses organes génitaux […]. Ici encore, ses fantasmes permettent de montrer au patient sa représentation d’un pénis féminin. […]. La toile de l’araignée représente la toison pubienne ; le fil isolé a une signification sexuelle virile[24] ».
Bien que le cas clinique cité ici soit masculin, la phobie des araignées se rencontre davantage chez les femmes que chez les hommes. Une telle différence s’explique par le fait que, pour la fille, la dissemblance entre son propre sexe et celui de sa mère réside dans cette touffe de poils qu’elle ne possède pas, alors que, pour le garçon, la dissemblance sexuelle d’avec sa mère consiste non seulement dans le fait d’avoir ou non des poils, mais d’avoir ou non un pénis. La question de la pilosité en tant que marqueur visuel du sexe féminin est donc cruciale. L’araignée, généralement représentée comme noire et velue, renvoie indubitablement au sexe maternel et à son caractère incestueux[25].
La tarentule ou mygale, que semblent dessiner les poils pubiens de l’Origine du monde réactive chez les spectateurs la phobie des araignées qui n’est autre que celle du sexe de leur mère. De manière symétrique et inverse à Courbet, Odile Redon (1840‑1916) dessine de manière quasi obsessionnelle le motif d’une araignée velue qui rappelle la toison pubienne féminine : comme le sexe/visage de l’Origine du monde, l’araignée possède un visage et sourit au spectateur, notamment L’araignée souriante (1881).
https://www.musee-orsay.fr/fr/oeuvres/laraignee-souriante-200960
L’araignée souriante (1881), Odilon Redon, dessin au fusain, 49,5 x 39 cm,
musée d’Orsay (conservée au cabinet d’arts graphiques du musée du Louvre) © RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Jean-Gilles BerizziL’association de l’araignée avec le sexe maternel transparaît dans le travail de plusieurs femmes artistes. C’est notamment le cas de l’artiste française Louise Bourgeois (1911‑2010) dans sa sculpture figurant une immense araignée aux pattes velues sous laquelle les spectateurs déambulent. Le nom donné à cette œuvre, Maman (1999), atteste que cette araignée monumentale incarne la mère de l’artiste (Cajori et Wallach, 2008) sous son aspect le plus phallique et le plus terrifiant. De même, l’artiste française Niki de Saint Phalle (1930‑2002) représente de grosses araignées noires semblables à des mygales dans une série de sculptures et de dessins explicitement intitulée Les mères dévorantes (The Devouring Mothers) (1974)[26].
ARAIGNÉES, CRABES OU PIEUVRES : UN SEXE VELU TENTACULAIRE
L’homologie entre araignée et sexe féminin se retrouve dans un rituel de possession étudié en Italie du Sud par l’anthropologue italien Ernesto De Martino (1999, or. 1961), bien que cette homologie n’ait pas été explicitée par l’auteur. Ce rituel de possession, qui concerne exclusivement les femmes, est expliqué localement par la morsure d’une tarentule ; la possédée est dite « mordue de la tarentule » ou « poursuivie par la morsure de la tarentule » (p. 275). La tarentule est elle‑même identifiée à une femme comme le montre la manière dont les habitants du Salento s’adressent à elle dans leurs chansons : « Madame la tarentule » (p. 187). Le terme de « tarentelle » (tarentella) qui désigne les chants et les danses accompagnant cette forme de transe est en outre dérivé du mot « tarentule » (tarenta). Il est par ailleurs significatif que le « pubis » (p. 189) soit un des organes les plus visés par la tarentule comme le rapporte une chanson recueillie par De Martino : « Où t’a mordu la tarentule ? En dessous du bord de ma jupe » (p. 188).
Une des caractéristiques de cette possession consiste pour les femmes à libérer leur chevelure habituellement recouverte d’un fichu. Leurs cheveux noirs, agités de toute part, rappellent visuellement les cheveux‑serpents de la tête de Méduse mais aussi les pattes velues de la tarentule censées être à l’origine de la possession. De Martino (p. 87, 73, 81) parle à cet égard « d’identification à l’araignée », « de se faire araignée », de « danser l’araignée », de « se transformer en corps‑tarentule ». Les femmes « tarentulées » (tarentata), en devenant elles‑mêmes méduses ou tarentules[27], contrecarrent le mal sexuel à l’origine de leur crise. Cette « morsure d’amour » selon l’expression locale (de Martino, 1999, 89) est en effet un « mal d’amour » (Charuty, 1987) qui affecte les femmes mal mariées[28] souffrant de « remords » (rimorsi)[29] liés à une frustration amoureuse ou sexuelle.
On retrouve chez les Bédouins de Libye un rituel de possession analogue à celui observé dans la région du Salento. Significativement, il ne concerne que des femmes sans mari, qu’il s’agisse de jeunes filles non mariées, de femmes divorcées ou de veuves (Camps, 1994). Celles‑ci, en ligne ou en cercle, les bras collés le long du corps, agitent violemment la tête au rythme des mouvements de plus en plus saccadés du tambour, ce qui a pour effet de libérer leurs cheveux, d’où le nom donné par les anthropologues à ce rituel : « danse des cheveux », bien que celui‑ci ressorte davantage de la transe que de la danse.
Dans ce type de société où les cheveux, tout comme le sexe féminin dont ils sont l’emblème, sont voilés et « sous contrôle » (Fortier, 2010a), leur monstration — au sens de montrer et de monstre — rappelle visuellement la tête de Méduse. Les mouvements tentaculaires des cheveux qui les autonomisent du reste du corps les apparentent à une sorte d’entité monstrueuse ayant sa vie propre — tout comme le sexe de l’Origine du monde apparaît détaché du reste du corps —, suggérant que le sexe féminin peut être traversé par d’irrépressibles convulsions.
Ce rituel d’une grande puissance visuelle vient ainsi rappeler que le désir sexuel féminin est bien réel et qu’il ne doit pas être négligé sous peine de provoquer l’ire de la Gorgone. Les femmes sans mari, donc sans sexualité, affichent à cette occasion la puissance de leur organe sexuel, mais aussi sa fureur hystérique au sens étymologique de ce terme qui renvoie à l’utérus, témoignant de son intense frustration lorsque ses besoins impérieux ne sont pas rassasiés, frustration que ce rituel exprime et conjure tout à la fois.
DU CÔTÉ ARTISTIQUE
L’artiste parisienne contemporaine Sophie Sainrapt (née en 1960) traite de manière détournée et humoristique de la libido féminine dans une gravure intitulée Nid d’amour (2014) où, semblablement au focus de l’Origine du monde, l’artiste se focalise sur la toison pubienne d’un sexe féminin représenté tel un nid d’oisillons qui crient famine.
Il arrive en effet que le travail de certains artistes renoue avec des représentations inconscientes qui traversent les cultures et les époques. C’est le cas d’une toile de l’artiste française Sandrine Enjalbert (née en 1972) dans laquelle un crabe tient lieu de sexe féminin. Le contenu et le titre de ce tableau, Les maux du cœur, renvoient à la problématique du « mal d’amour » décrite par De Martino dans le Salento, auteur qui a par ailleurs montré que si « la morsure d’amour » est le plus souvent provoquée par une tarentule, elle peut l’être également par un scorpion, animal dont la piqûre joue un rôle important dans le rituel de possession sarde nommé argia étudié par l’anthropologue italienne Clara Gallini (1988).
De manière semblable, au Japon, c’est la forme du crabe et de ses poils (mogusa gani) qui évoque et même désigne le sexe féminin : « mogusa gani : vagin poilu, par allusion au crabe dont la pince est couverte d’une sorte de fourrure. Les prostituées se faisaient tatouer l’image d’un tel crabe sur le pubis et la pince était figurée par leurs petites lèvres. Ce tatouage symbolisait la puissance sexuelle : une fois le client “pincé”, impossible pour lui d’échapper aux tenailles » (Giard, 2008, 217). Remarquons que l’idée de « pinçure » du crabe au Japon rappelle « la morsure » de la tarentule au Salento — le nom de la danse dite pizzicca signifie « piqûre » —, mais ici on observe une réversibilité des positions où, de « pincée » la femme devient « pinçante », de « mordue » « mordante », de « piquée » « piquante », évoquant ainsi le caractère possiblement agressif, phallique et dangereux du sexe féminin[30]. L’homologie entre araignée et crabe est présente chez l’artiste française contemporaine Anne van der Linden (née en 1959) qui, dans sa toile intitulée Araignées du soir (2021), représente une grosse araignée aux pâtes velues et effilées ressemblant à un crabe, en lieu et place du sexe féminin.
Anne Van der Linden témoigne par ailleurs de l’analogie entre pilosité féminine et araignée velue dans son dessin (2022) intitulé Hairy legs, soit « jambes poilues ».
Le sexe féminin est donc conçu à la fois comme une proie et comme un prédateur. C’est le cas dans la mythologie grecque où Arachnée est un personnage féminin, non seulement victime d’Athéna qui, jalouse de ses talents de tisseuse la destine à être suspendue éternellement à un fil[31], mais aussi prédatrice, capturant et ligotant sa proie dans la toile qu’elle a préalablement tissée (Frontisi‑Ducroux, 2002, 262). Représentation qui apparaît également au Japon dans l’assimilation du sexe féminin à une pieuvre, ainsi que le montre l’estampe érotique d’Hokusai (vers 1760‑vers 1849) connue localement sous le nom d’Ama et le poulpe (Tako to Ama) (1814), et en Occident sous le titre Le rêve de la femme du pêcheur. Semblablement aux araignées ou aux tarentules, au Japon, les poulpes, tout comme les crabes, sont considérés comme des créatures « tentaculaires » pénétrantes, intrusives et étouffantes. De même, l’écrivain français Ernest Feydeau (1821-1873) rapporte qu’une courtisane parisienne du XIXe siècle était dénommée « la plus belle des pieuvres » (Feydeau, 1868, 233).
https://photo.rmn.fr/archive/14-500504-2C6NU0LRXYCO.html
L’Ama et le poulpe (vers 1814), Hokusai, estampe, 16,51 x 22,23 cm,
British Museum, département Asie, référence OA+, 0.109TACTILE GAZE : TOISON PUBIENNE ET FOURRURE
Les poils pubiens sont d’autant plus érotisés qu’ils contrastent avec la couleur blanche de la peau, comme le montre la photographie (1924) de Tina Modotti (1896‑1942)[32] prise par le photographe américain Edward Weston (1866‑1958).
La toison pubienne des femmes a la même fonction que le rideau de Khalil‑Bey destiné à cacher l’Origine du monde : préserver la pudeur féminine et susciter le désir masculin. Tandis que le sexe épilé apparaît comme nu, exhibé, vulnérable, offert au regard et prêt à consommer. Ainsi que le remarque Anne Marie Moulin (2011, 61) à propos du monde arabo‑musulman : « L’épilation est métonymie pour désigner le sexe prêt à l’emploi. Si elle est recommandée le vendredi, jour de hammam, c’est parce qu’elle prélude à la nuit de l’amour, du vendredi au samedi ».
Le monde arabo‑musulman est largement « trichophobe » pour reprendre l’expression de l’anthropologue Christian Bromberger (2005). Il est à cet égard éloquent, qu’en arabe, les termes pour désigner le sexe féminin (farj) ne renvoient ni aux poils ni au pubis, comme si celui‑ci une fois épilé n’était plus visible et n’avait plus de réelle existence, mais à la forme intérieure du vagin : « étroit » (ma‘zam), « large » (shaqq), « vaste » (‘arīdh), « sans fond » (mukawar) (Chebel, 1995, 627), termes qui font explicitement référence à ce pourquoi le sexe féminin est destiné : le plaisir pénétratif masculin[33].
L’œuvre de l’artiste franco‑libanaise Lamia Ziade (née en 1968) intitulée Great Syrian Nude (2007), exposée dans l’exposition Sexy souks au Point Éphémère à Paris en 2007, rend compte de ce paradoxe d’un point de vue occidental selon lequel le voile intégral d’une femme peut cacher un « sexe intégral » au sens d’un sexe intégralement épilé. La photographie intitulée La Belle Otero (vers 1895) de Léopold Reutlinger (1863‑1937) est le symétrique inverse de cette image dans la mesure où la courtisane (1868‑1965) apparaît vêtue d’un vêtement moulant blanc qui contraste avec sa cape de fourrure noire, suggérant que sous son justaucorps lisse et immaculé se cache une toison pubienne noirâtre et touffue.
La fourrure est un substitut de la toison pubienne et donc du sexe féminin, ainsi que le remarquait Freud (1987, or. 1942, 65) : « […] la “fourrure” doit sans doute son rôle de fétiche à son association avec les poils du Mons Veneris […] », ce qui explique l’érotisme lié au manteau de fourrure, comme l’illustre le roman La Vénus à la fourrure (Venus im pelz) (1870) de Léopold von Sacher‑Masoch (1836‑1895).
La fourrure, associée fantasmatiquement à la toison pubienne dans la peinture occidentale, sert à la fois à cacher et à représenter le sexe féminin, qu’on pense à La Vénus au miroir (1555) de Titien (1488‑1576) dont la fourrure dessine une toison pubienne au niveau du bas‑ventre.
Outre la fourrure, les plumes peuvent tenir lieu de toison pubienne, ne parle‑t‑on pas à cet égard de « duvet » pubien ? C’est tout au moins le cas dans La grande odalisque (1814) d’Ingres dont l’éventail en plumes joue le rôle de substitut de ce qui est hors champ : son sexe. Les irisations bleutées des ocelles en forme d’œil des plumes de paon de l’éventail semblent regarder le spectateur tout comme les yeux bleus de l’odalisque dévisagent ceux qui la regardent, renouant avec le regard pénétrant et pétrifiant de la Méduse ; ainsi que l’observe Janine Filloux (2002, 109) : « Ferenczi met particulièrement l’accent sur la signification des yeux : les yeux de Méduse sont aussi apotropaïques. Ce sont des ocelles ; or l’ocelle n’est pas une image schématique de l’œil ; ce sont des “cercles démesurés, concentriques, immobiles et lumineux, (…) purs et abstraits foyers d’hypnose et de terreur” comme les décrit excellemment R. Caillois, “qui paralysent et changent en pierre celui qu’ils regardent ou qui les regarde”. Les ocelles servent de parure intimidante ou séductrice à de nombreux insectes — aux papillons notamment — et caractérisent aussi les yeux des rapaces nocturnes. La clinique montre la fréquence de ce matériau représentatif dans les rêves, les dessins d’enfants, les phantasmes, et ce qu’il permet de figurer de l’angoisse chez la fille comme chez le garçon ».
On peut à cet égard parler de « tactile gaze » (Bernardi, 2014, 148) ou de « regard tactile », dans la mesure où la figuration de la plumasserie ou de la fourrure stimule le désir de la toucher et de la caresser. Le sexe féminin est d’ailleurs souvent désigné en français par des termes renvoyant à la « toison », à la « fourrure », à l’« angora », à la « crinière », au « pelage », ou encore à la « moumoute » (Monestier, 2002, 130). Ainsi, dans sa série de nus, l’artiste américain Tom Wesselman (1931‑2004) représente le sexe féminin comme une « moumoute », notamment dans Reclining Stockinged Nude (Yellow Stockings Brunette) (1982) ou « Nu couché aux bas (brunette aux bas jaunes) ».
Similairement, mais selon un regard plus féminin (female gaze), l’artiste franco‑libanaise Lamia Ziade a créé une série de sexes féminins en textile où la toison pubienne est constituée de fourrure et de laine (2008).
CHATTE FÉROCE OU CHIEN DOCILE ?
Ce n’est sans doute pas un hasard si la manière de nommer le sexe féminin en français renvoie le plus souvent à un animal à fourrure : la « chatte »[34]. Un tableau iconique incarne cette idée : l’Olympia (1863) d’Édouard Manet (1832‑1883) ; le chat au côté de la courtisane dénudée suggère le sexe féminin que cette dernière cache et désigne à la fois.
Une caricature du tableau de Manet réalisée par Bertall (1820‑1882) intitulée de façon suggestive, La queue du chat ou la charbonnière des Batignolles, parue dans le journal l’Illustration du 3 juin 1865, rend compte de façon très claire de cette association entre chat noir et sexe féminin en représentant l’animal au lieu même de l’entrejambe de la femme. Pablo Picasso a également revisité l’Olympia de Manet dans Nu couché et chat IV Mougins (1964)[35], en plaçant le chat juste au‑dessus du bas‑ventre de la courtisane tandis que celle‑ci se fait chatte si l’on en croit la métamorphose du bout de son nez et de ses doigts.
La position d’Olympia est inspirée de celle de la Vénus d’Urbino (1538) du Titien, sauf que Manet a remplacé le petit chiot endormi qui tenait lieu de sexe féminin par un chat aux poils ébouriffés, aux yeux jaunes menaçants et à la queue en érection[36]. Notons que le chat noir porte malheur en Europe compte tenu de son association avec le sexe féminin : croiser un chat noir est aussi effrayant que se retrouver nez‑à‑nez avec le tableau de Courbet.
La représentation du sexe féminin dans l’Olympia de Manet est radicalement différente de celle de la Vénus d’Urbino du Titien, puisqu’on passe d’un sexe endormi de couleur claire tout en courbe à un sexe noir furieux de forme phallique. Remarquons que l’expression française « avoir du chien » désigne une femme au « sexe fort » qui a du mordant, or paradoxalement ce type d’archétype féminin est davantage incarné par le chat sauvage du tableau de Manet que par le chien paisible du tableau de Titien.
Courbet dans Femme nue au chien (1861‑1862) représentera également le sexe féminin par un petit chien affectueux aux poils clairs et bouclés, représentation opposée à celle de la mygale venimeuse de l’Origine du monde (1866).
On retrouve par ailleurs dans l’art occidental, notamment symbolique, de nombreuses représentations où la femme est assimilée à une panthère ainsi que le montre le tableau de l’artiste français Fernand Khnopff (1858‑1921), L’art ou Des caresses (1896), dans lequel la femme‑panthère s’approche doucement de sa proie, en l’occurrence un jeune homme significativement représenté sous une forme efféminée.
L’image de la panthère, du léopard ou de la tigresse renvoie, comme le chat de Manet, au sexe féminin velu, mais aussi à sa férocité supposée. De même, au Japon, les termes pour désigner le sexe féminin se réfèrent à un animal à fourrure, qu’il s’agisse de la « renarde » (kitsune) ou encore de la « peau d’ours » (kuma no kawa) (Giard, 2008, 216).
LA CHEVELURE, SUBSTITUT VISIBLE DE LA TOISON PUBIENNE
Chez de nombreux artistes, la visibilité de la chevelure remplace la toison pubienne qui est cachée, invisible ou très pudiquement suggérée, on pense en premier lieu au peintre français Pierre‑Auguste Renoir (1841‑1919), notamment dans La source (1906) où le mouvement tombant de la chevelure de la jeune fille contraste avec le mouvement contraire du vêtement remonté sur son sexe.
De même, dans la Danaé (vers 1900) de Carolus‑Duran (1837‑1917), la chevelure rousse qui tombe en cascade sur l’épaule de la Danaé s’oppose à la blancheur lisse de son corps.
La couleur rousse des cheveux et dans une moindre mesure des poils pubiens a été dépeinte par Henri de Toulouse Lautrec (1961‑1904), notamment dans son œuvre intitulée Le sofa (1896) dans laquelle le peintre souligne d’un trait roux la pilosité féminine de la prostituée au second plan.
On pense également au peintre viennois Gustave Klimt (1862‑1918) représentant fréquemment la chevelure flamboyante de femmes rousses ainsi que, dans une moindre mesure, la rousseur de leur toison pubienne, comme le montre le panneau Nuda Veritas (1899) ou « la vérité nue ».
Un dessin de Klimt témoigne par ailleurs du contraste entre la forte visibilité de la chevelure et la quasi‑invisibilité de la toison pubienne : Modèle nue accroupie regardant à travers ses cheveux (1907).
Mais le plus radical en matière de visibilité de la chevelure féminine et d’invisibilité de la toison pubienne est sans aucun doute le peintre du Bain turc, comme le remarque Régis Michel (2000, 167) : « Le déficit pileux de l’anatomie ingresque a pour éclatante contrepartie sa luxuriance capillaire. Les cheveux ruissellent un peu partout sur la courbe des épaules en un flot continu de féminité altière. Angélique ou Antiope, Vénus urbinate ou anadyomène, odalisques de hammam ou baigneuses de harem, toutes arborent des crinières diluviennes qui rivalisent de taille et d’éclat… On se doute que, chez Ingres, l’hypertrophie de la chevelure est le principe heuristique de la sexualité féminine : le produit correcteur d’un déplacement métonymique où se vérifie, s’il était besoin, l’acuité visuelle de la rhétorique freudienne. La toison démesurée des héroïnes ingresques vaut en somme pour deux, capillaire et pubienne. C’est que l’une est licite et l’autre pas. Morale, pudeur, esthétique, tout conspire à prendre l’une pour l’autre, dans une production frigide, où le nu s’exhibe, mais le sexe s’élide ». C’est le cas de nombreux tableaux d’Ingres et notamment de Vénus anadyomène (1848).
À la différence de la Vénus d’Ingres intégralement épilée, les cheveux des Vénus de Botticelli (1445‑1510) dissimulent et suggèrent à la fois leur toison pubienne, rappelant que, selon le christianisme, « la chevelure est donnée à la femme pour lui servir de voile » (Agacinski, 2005, 172).
La chevelure est en effet un substitut de la toison pubienne, toison qui est parfois nommée en français « la chevelure d’en bas » (Monestier, 2002, 212). À cet égard, le surnom de Casque d’or donné à Amélie Élie (1878‑1933), prostituée parisienne de la belle époque incarnée par Simone Signoret dans le film de Jacques Becker (1952), fait autant allusion à sa chevelure qu’à sa toison.
Les poils des aisselles sont également un substitut érotique de la toison pubienne. Cela apparaît très clairement chez le romancier français Émile Zola (1840‑1902) qui déclare à propos du personnage éponyme de son roman, Nana (1977, or. 1880) : « Ce sont les poils d’or de ses aisselles […] qui mettent les hommes en rut ». C’est cette même couleur dorée des aisselles que Courbet choisit de représenter dans La Femme à la vague (1868), couleur moins effrayante que la couleur sombre du sexe féminin de l’Origine du monde.
Les poils des aisselles, comme les cheveux lorsqu’ils sont cachés, doivent leur caractère érotique à ce jeu entre le dissimulé et le visible, apparaissant à de rares instants furtifs et à l’occasion de certains mouvements, par exemple quand la femme, à la manière du tableau de Courbet, lève les bras.
L’ŒIL DU SEXE FÉMININ
Pablo Picasso (1881‑1973), dans une de ses compositions humoristiques[37] s’est amusé, au stylo Bic noir, à ajouter des poils au niveau de l’entrejambe ainsi que sous les bras d’une pin‑up de magazine (Collectif, 2001, 303), renouant ainsi avec les graffitis obscènes qu’on trouve dans les rues de Paris (Brassaï, 2006) ou sur les murs des toilettes publiques.
Picasso a beaucoup représenté la pilosité sexuelle féminine mais aussi la pilosité masculine (barbe, poils du torse et du sexe), notamment dans sa série sur le peintre et son modèle. En dépit du fait que Picasso ne portait pas de barbe, une telle représentation s’apparente à un autoportrait déguisé, rendant compte de l’image virile que l’artiste avait de lui‑même. Notons que le pinceau servant à peindre le modèle est constitué de poils qui rappellent les poils pubiens, « pinceau » dont l’étymologie dérive significativement du terme latin penicillus qui signifie « petit pénis » (Arasse, 2000, 119). Cette étymologie signale que le geste de peindre s’apparente à une appropriation sexuelle sinon à un acte de pénétration, surtout lorsqu’il s’agit de « croquer » un sexe féminin.
Dans l’un des dessins de Picasso figurant Raphaël avec son modèle, la Fornarina, intitulé Raphaël et la Fornarina, V : avec voyeurs écartant le rideau (1968)[38], Picasso représente un homme qui entrouvre un rideau semblable aux lèvres d’un sexe féminin pour observer l’artiste peindre son modèle comme s’il épiait une scène sexuelle. Picasso donne ainsi à voir la position voyeuriste du spectateur ainsi que la « jouissance visuelle » et « l’excitation érotique » qu’elle procure (Clair, 1989, 198).
L’analogie côté masculin entre regard et pénétration a pour pendant une autre analogie côté féminin, celle entre œil regardé et sexe pénétré. L’œil pénétré est d’emblée associé au féminin dans de nombreuses langues (Abraham, 1959, or. 1909 ; Bidou, 2004, 35), ainsi qu’en témoigne le terme français de « pupille » dérivé du latin pupilla issu du mot puppa ou poupée, ou encore le terme grec de coré[39] qui signifie « jeune fille », employé pour désigner le siège de la vision (Frontisi‑Ducroux et Vernant, 1997, 66). Comme le remarque Julia Kristeva (1998, 36), le sexe féminin est un œil : « Vulve féminine, la tête de Méduse est un œil glaireux, tuméfié, chassieux ; trou noir dont l’iris immobile s’entoure de lambeaux, lèvres, plis, poils pubiens ». Une telle homologie affleure dans le travail de Picasso (Clair, 1989, 50) où le sexe féminin est semblable à un œil entouré de cils, et où, inversement, l’œil ressemble à une vulve cernée de poils[40].
La représentation iconique et protectrice dans les sociétés arabo‑musulmanes et méditerranéennes du « mauvais œil »[41], connue dès l’Égypte ancienne, est une forme de figuration du sexe féminin analogue à celle de la Gorgone[42]. Ainsi que le remarque Janine Filloux (2002, 109) : « L’association du mauvais œil et de la féminité est abondamment soulignée par les ethnologues. Elle a à voir avec l’envie de quelque chose de l’autre ou en l’autre. Plus précisément, le regard féminin maléfique est celui de la femme menstruée ; l’association du sexuel et du visuel est explicite quand on dit d’une jeune fille qui a ses règles “qu’elle voit” ; “qu’elle ne voit pas encore” quand elle n’est pas encore formée, et “qu’elle ne voit plus” quand elle est ménopausée. Trop souvent on se contente d’appréhender le rapport entre l’œil et le sexe féminin sur le mode d’une simple analogie alors que ce qu’il traduit est plutôt quelque chose de notre rapport mimétique au monde et de sa continuité dans les mythes, que l’on pourrait saisir dans le fait que, par la projection, l’œil ne fait qu’un avec ce qu’il voit de telle sorte que le déplacement sur l’œil qui voit rend visible ce qui ne se voit pas : le sexe féminin ».
L’association entre sexe féminin et œil est manifeste chez l’artiste française contemporaine Sophie Sainrapt comme le montrent sa gravure intitulée Les Mille et une nuits (2012) ainsi que son tableau Les rires d’Éros (2008) — œuvre dont le titre rappelle le « sourire d’en bas » — dont le format en tondo évoque la forme de l’œil comme du sexe féminin.
La jeune photographe coréenne Yoonkyung Jang (née en 1994) suggère cette collision entre sexe féminin, œil, et tête de Méduse dans une photographie de sa série significativement intitulée Glimpse ou « coup d’œil ».
De même, l’artiste luxembourgeoise Deborah De Robertis (née en 1984) inverse le regard entre le modèle (Schicharin, 2018) et le spectateur, en parlant « d’œil du sexe » de la femme. Dans une de ses performances[43] réalisées au musée d’Orsay sous l’Origine du monde, elle pose, à la manière de VALIE EXPORT, jambes écartées, afin de mieux montrer son sexe poilu. Deborah De Robertis explique ainsi sa performance : « Je ne montre pas mon sexe, mais je dévoile ce que l’on ne voit pas dans le tableau, cet œil enfoui qui au‑delà de la chair répond à l’infini, l’origine de l’origine. […]. L’ensemble de mon travail vidéo et photographique part du “point de vue du sexe”, je parle souvent de “l’œil du sexe”. […]. En posant sous l’Origine du monde, je questionne la place du maître en me positionnant en tant que versant féminin dans le rôle de muse pour tendre un miroir à celui qui historiquement m’aurait fait naître. Nous nous regardons yeux dans les yeux, lui tenant en main un pinceau, moi tenant en main mon sexe »[44].
Deborah De Robertis déclare dans un entretien : « Il y a ainsi une inversion du regard qui s’opère. Le spectateur ne regarde plus un objet inerte, c’est‑à‑dire un sexe féminin passif sur une toile, mais il est regardé par un sexe féminin bien vivant et ça, ça dérange »[45]. Remarquons que cette dernière assertion ne vaut pas seulement pour la performance de Deborah De Robertis mais pour la « nature morte » bien vivante que représente l’Origine du monde, tableau qui, comme on l’a vu, sourit, mais aussi regarde, provoquant ainsi le trouble chez le spectateur. Comme l’observe également l’historien d’art Bernard Mercadé (1995, 24) : « Ce que nous voyons est bien un sexe de femme qui nous regarde ».
INVERSION DU REGARD ET TOISON PUBIENNE CONQUÉRANTE
Le vrai renversement du primat du regard masculin sur le corps féminin est sans conteste opéré par l’artiste française ORLAN qui fait basculer le male gaze sur le sexe féminin en female gaze sur le sexe masculin. Artiste femme, elle inflige à son modèle de sexe masculin le même sort que Courbet fait subir à son modèle féminin, en lui coupant la tête, les bras et les jambes, ne gardant que son sexe poilu et son torse velu. Le titre de ce tableau est le symétrique inverse de celui de Courbet, non plus l’Origine du monde mais l’Origine de la guerre (1989), celui‑ci ne se référant plus à la « puissance génitale de la mère, vallée originelle des humains », pour reprendre les termes de Julia Kristeva (1998, 36), mais au caractère destructeur du sexe masculin, ORLAN dénonçant ainsi les violences inhérentes à la phallocratrie[46].
Plus récemment, l’artiste iranienne Shagha Ariannia (née en 1984) basée aux États‑Unis peint des hommes barbus dévêtus allongés dans des poses lascives, parodiant ainsi la manière dont ses prédécesseurs masculins ont représenté le corps féminin, qu’on pense au tableau de la Vénus d’Urbino du Titien, renversant ainsi le male gaze sur les nus féminins en female gaze sur les nus masculins. Les titres de ses tableaux sont éloquents, car, comme dans l’Olympia de Manet ou la Fornarina de Raphaël qui mentionnent le prénom du modèle[47], l’artiste cite le prénom de ses amants, par exemple dans Here lies Timothy, waiting with blue pillows (2022) ou « Ici est allongé Timothy, attendant avec des coussins bleus » (2022) ou Here lies Damian, napping with a pink light ou « Ici est allongé Damian, faisant la sieste avec une lumière rose ».
Here lies Damian, napping with a pink light (2022), acrylique sur toile, 91 x 122 cm,
Septième galerie, Paris (photographie Corinne Fortier, Art Paris, 7 au 10 avril 2022)Here lies Timothy, waiting with blue pillows (2022), acrylique sur toile, 91 x 122 cm,
Septième galerie, Paris (photographie Corinne Fortier, Art Paris, 7 au 10 avril 2022)Renouant avec les archétypes de la mise en scène du nu féminin dans l’art occidental, Shagha Ariannia utilise le motif du rideau que l’on retrouve dans les œuvres préalablement citées de la Vénus d’Urbino ou de la Vénus au miroir du Titien, la Grande odalisque d’Ingres, la Femme nue au chien de Courbet, ou encore l’Olympia de Manet. Ce motif revêt de surcroît un sens particulier dans la culture persane dont est originaire l’artiste puisque le mot qui désigne le rideau en persan ou purdah renvoie à la réclusion féminine, transformée ici en « réclusion masculine ».
Remarquons que le peintre français Jacques Hélion (1904‑1987) tentera de renverser la hiérarchie entre le peintre et son modèle, tout au moins au niveau de la représentation, dans son tableau explicitement intitulé Le peintre piétiné par son modèle (1983), œuvre dans laquelle l’artiste est mis à terre par sa muse qui, entièrement dénudée, arbore une toison pubienne conquérante.
Cette peinture apparaît comme le symétrique inverse de la Tentation de l’impossible (1928)[48] de l’artiste belge René Magritte (1898‑1967), œuvre qui témoigne du rôle quasi démiurgique du peintre vis‑à‑vis de son modèle. Comme dans le tableau d’Hélion, le costume du peintre contraste avec la complète nudité de la femme dont la toison pubienne et la chevelure sont les uniques parures. Ce nu fera l’objet d’un « rhabillage » par l’artiste Fanny Violet qui rééquilibrera ainsi le rapport dissymétrique entre le peintre et son modèle.
TEXTURE DES POILS PUBIENS
La visibilité de la toison pubienne est particulièrement évidente chez l’artiste contemporaine basque espagnole Esther Ferrer (née en 1937) qui la représente de couleur rouge dans une matière textile, mettant ainsi au jour l’analogie entre fils et poils pubiens.
Cette analogie avait déjà été relevée par Freud (1984, or. 1932, 177‑178) qui explique l’invention du tissage[49] par le fait que les femmes auraient tissé ensemble leurs poils pubiens pour cacher leur sexe : « On estime que les femmes ont apporté peu de contributions aux découvertes et aux inventions de l’histoire de la culture mais peut‑être ont elles quand même inventé une technique, celle du tressage et du tissage. S’il est ainsi, on serait tenté de découvrir le motif inconscient de cette réalisation. C’est la nature elle‑même qui aurait fourni le modèle de cette imitation en faisant pousser, au moment de la puberté, la toison pubienne qui cache les organes génitaux. Le pas qui restait encore à franchir consistait à faire adhérer les uns aux autres les fibres qui, sur le corps, étaient plantées dans la peau et seulement emmêlées les unes avec les autres ».
On sait en effet que, dans certains contextes, les femmes tressaient leurs poils pubiens. D’une part, en France, des cocottes les entrelaçaient avec des cordons et des rubans appelés faveurs, d’où l’expression « accorder ses faveurs » (Monestier, 2002, 27). D’autre part, au Japon, certaines prostituées se peignaient les poils pubiens ou se les faisaient peigner par leur admirateur, d’où l’expression « allonger les poils » (hamage o nobosu) qui signifie « perdre la tête pour une femme » (Giard, 2008, 216). En effet, malgré ce qui est très souvent affirmé, la société japonaise n’est pas trichophobe ainsi qu’en témoignent les estampes japonaises érotiques (shunga) apparues dès le début du XVIIe siècle durant la période Edo où les sexes féminins et masculins sont représentés avec des poils, la plupart du temps de façon surdimensionnée, différence d’échelle les rendant d’autant plus visibles.
Dans la mesure où, au Japon, les poils pubiens représentent le sexe féminin, comme la synecdoque ou la partie pour le tout, leur monstration en public est jugée obscène et de l’ordre de l’exhibition sexuelle, ce qui explique leur pixellisation dans les productions visuelles (Allison, 2000) et notamment dans les photos ou les films occidentaux. À la différence de ce que pensent beaucoup d’Occidentaux, les Japonais censurent les poils non pas parce qu’ils ne les aiment pas, mais parce qu’ils les aiment trop.
Il existe en outre une myriade de termes japonais pour désigner les poils selon qu’ils sont courts (sosoge), bouclés (chijiregami)… Des métaphores végétales sont par ailleurs utilisées comme « l’herbe de printemps » (shunsa) (Giard, 2008, 216‑217). Ce type de métaphore se retrouve dans d’autres sociétés, par exemple en Grèce ancienne où Aristophane parle des poils pubiens en termes d’« endroit touffu où poussent des arbustes ou fourré » (Cootjans, 2000, 55). En France, des métaphores végétales sont également employées pour désigner le sexe féminin : « mousse », « buisson », « cresson », « gazon », « pelouse » (Monestier, 2002, 130). Guillaume Apollinaire (2006), engagé en tant que « poilu de 14 » (Cronier, 2011), écrit en pleine guerre à son aimée : « Ta toison est la seule végétation dont je me souvienne, ici où il n y a pas de végétation ».
Les sociétés occidentales et japonaises ne sont pas les seules à investir érotiquement les poils pubiens féminins, c’est également le cas de certaines sociétés africaines comme les Massa du Tchad et du Nord‑Cameroun : « Il y a vingt ans, les jeunes filles massa et moussey encore impubères allaient pratiquement nues, vêtues d’un rang de perles ou d’un minuscule cache‑sexe en perles de verre. Adultes, les femmes massa portaient entre les jambes un écheveau de coton rouge vif accroché à une ceinture blanche, les femmes moussey, une touffe de feuilles, abondante par‑derrière et restreinte par‑devant. Dans les deux cas, une partie des poils pubiens restaient exposés. Ils semblent avoir exercé une véritable fascination sexuelle. […]. Chez les Massa : “Un homme avait pris femme. Celle‑ci avait un pubis poilu, tous les gens l’aimaient. Il ne pouvait la laisser se promener” » (De Garine, 1987, 112).
ÉPILATION ET DOUCEUR SUCRÉE
Si l’épilation, dans le monde arabo‑musulman ou perse, est le plus souvent intégrale au niveau du sexe elle ne l’est pas nécessairement au niveau du visage. En effet, les sourcils sont particulièrement érotisés en Iran (Bromberger, 2010, 37) et en Asie centrale où les femmes prennent soin de leurs sourcils qui viennent structurer leur visage, rehausser leurs yeux et souligner leur regard. Bien loin d’être effacés comme c’est le cas dans certaines sociétés africaines, asiatiques ou océaniennes, les sourcils sont en ce contexte touffus et fournis. Leur noirceur est d’autant plus appréciée qu’elle contraste avec la blancheur du visage. En Asie centrale, jusqu’à récemment, les femmes n’hésitaient pas à faire rejoindre leurs sourcils au‑dessus du nez par un trait de khôl qui formait un pont au niveau du front. Pratique que l’on retrouve en Grèce ancienne où la réunion des deux sourcils en un seul s’obtenait par un dessin au fard noir (Paquet, 1997, 21).
Femme ouzbek et l’autrice, Ouzbékistan, 2008 (photographie Corinne Fortier)
Femme ouzbek, Ouzbékistan, 2008 (photographie Corinne Fortier)
Remarquons que, dans les sociétés musulmanes, noircir ses sourcils n’est pas propre aux femmes mais peut concerner, dans de plus rares cas, les hommes, comme le montre l’exemple du Prophète Mahomet qui « noircissait ses paupières avec le “Koheul”, qui aiguise les regards et fortifie les cils » (Dinet et Ben Ibrahim, 1937, 269).
À l’instar de l’excision, l’épilation n’est pas dénuée de souffrance. Celle‑ci est fréquemment réalisée dans le monde arabo‑musulman au moyen d’une pâte fabriquée à base de sucre semblable au caramel. Celle‑ci inspirera le titre du film de la réalisatrice libanaise Nadine Labaki, Caramel (2007), dont l’action se déroule dans un salon de beauté de Beyrouth. Ce titre, « doux comme le miel », selon la formule d’arabe d’usage, évoque moins les aspects douloureux liés à cette pratique que les plus heureux, dans la mesure où l’épilation dans le monde arabo‑musulman n’est pas, comme en Occident, un moment intime et solitaire (Al Joundi, 2007, 77), mais un espace de socialisation où les femmes rient, se confient et racontent leurs histoires amoureuses. On comprend alors que l’odeur caramélisée de cette pâte dépilatoire agisse comme une « madeleine de Proust » auprès de certaines femmes libanaises telle Zarah al‑Joundi.
Zarah al‑Joundi (p. 78) rapporte, qu’enfant, elle acceptait d’autant mieux l’épreuve de l’épilation, que sa mère lui donnait un morceau de pâte dépilatoire à déguster comme s’il s’agissait d’une « sucrerie » (halwa) : « Quand tu la préparais, tu disais toujours : “Tu sens l’odeur du sékar ?” Chez nous on l’appelle sékar[50], un mélange de sucre et de citron, chauffé à feu doux. En plus c’est tellement bon. Quand j’étais gamine pour accepter de te laisser m’épiler, il fallait que tu me donnes une bouchée de halawa, on a gardé ce rituel ! ».
La notion de douceur en arabe (hulū au masculin, halwa au féminin, terme dérivé de la racine arabe h‑l‑ū) est une caractéristique à la fois visuelle, tactile et gustative corrélée au plaisir. Elle est d’emblée référée dans le monde arabo‑musulman aux rivières de miel du paradis (Fortier, 2005), métaphore que l’on retrouve dans le Cantique des cantiques, texte hébraïque qui parle des plaisirs de l’amour (Flandrin, 1987, 32). Elle est aussi associée aux houris (huriyyāt), ces femmes toujours vierges (Fortier, 2022b) selon le Coran (LVI, 35‑38) qui attendent le musulman au paradis : « Des Houris que nous avons formées, en perfection, et que nous avons gardées vierges, coquettes, d’égale jeunesse, appartiendront aux Compagnons de la Droite » (Blachère, 1980, 573).
L’ÉPILATION COMME CHIRURGIE SEXUELLE
Rappelons que le terme de puberté en français dérive étymologiquement de pubes qui désigne les poils, témoignant que la pilosité est l’un des signes physiques les plus visibles du passage à l’âge adulte. La pilosité pubienne a par ailleurs pour caractéristique d’être l’apanage des deux sexes, à la différence des seins, spécifiques aux femmes. Dans le monde arabo‑musulman, la pratique de l’épilation du corps féminin tout d’abord entreprise par la mère se poursuit à la puberté avec celle des poils pubiens conformément aux injonctions musulmanes.
Dans le monde arabo‑musulman, l’épilation ne concerne pas uniquement la gent féminine puisque s’épiler les poils des aisselles et du pubis est une prescription islamique recommandée aux deux sexes pour des raisons d’hygiène et de pureté (tahāra) (Suyūtī, 1994, 50). De ce point de vue, de même que l’épilation du pubis chez les femmes est comparable à l’excision, celle des hommes est similaire à la circoncision[51], pratique ayant cours dans les sociétés musulmanes bien qu’elle n’ait aucun caractère obligatoire mais seulement recommandable (Fortier, 2020b). Notons qu’aux États‑Unis, pour des raisons hygiéniques, la circoncision, tout comme l’épilation masculine du pubis, sont des interventions très courantes chez les hommes indépendamment de leur religion (Fortier, 2020c).
Si dans le monde arabo‑musulman, l’épilation masculine est essentiellement hygiénique, comme le montre le fait qu’elle concerne uniquement le pubis et non d’autres parties du corps telles que le torse, celle de la femme, en revanche, possède une fonction érotique, ainsi que l’atteste le fait que, dans la plupart des œuvres érotologiques arabes (Chebel, 1995, 529), le pubis se doit d’être glabre.
La pilosité pubienne de la femme renvoie à la représentation d’une sexualité sauvage, libre, affirmée et indépendante perçue comme menaçante. Aussi l’injonction sociale à l’épilation est‑elle une manière de domestiquer le corps féminin afin de produire une créature soumise, douce, infantile, dépendante et docile qui ne mettra pas à mal l’angoisse de castration masculine. S’éclaire ainsi la « trichophobie » arabo‑musulmane.
Ainsi, les femmes sont‑elles sommées de se débarrasser de leurs poils pubiens, associés à un sexe phallique puissant et angoissant. Cette représentation n’est pas propre aux sociétés arabo‑musulmanes puisqu’on la retrouve chez les Trobriands qui pratiquent l’épilation. Bronislaw Malinowski (2000, or. 1930, 219) rapporte la croyance selon laquelle sur une île isolée d’Océanie vivent des femmes entièrement nues et non épilées dont les poils pubiens « atteignent une longueur telle qu’ils forment parfois une sorte de doba (jupe en fibres végétales) qui les recouvre par‑devant », femmes dont le désir sexuel est si féroce qu’il fait violence aux hommes, y compris à leur propre fils (Müller‑Delouis, 2011, 277).
Remarquons que, dans l’art occidental, la figure de Marie Madeleine, ancienne prostituée dont le désir est perçu comme insatiable, a été représentée au Moyen‑Âge couverte de cheveux mais aussi de poils (Arasse, 2000, 118), notamment dans la sculpture en bois du sculpteur allemand Tilman Riemenschneider (1460‑1531) intitulée Marie‑Madeleine entourée d’anges (1492). L’expression française « poilue comme le diable » se réfère à cet aspect animal de la femme ainsi qu’à son association avec le diable, figure maléfique obéissant à des pulsions « animales ».
Dans son tableau, La p’tite robe bleue (2012), l’artiste contemporaine Anne van der Linden témoigne quant à elle du côté animal et démoniaque des poils des jambes des femmes, qui, semblables à la laine de mouton, sont transformés en pelotes de laine.
Dans une autre toile d’Anne van der Linden ironiquement intitulée Pied de biche (2016), les poils qui recouvrent les jambes du modèle, loin d’être repoussants, rappellent les bas érotiques des courtisanes.
LA TOISON PUBIENNE OU LE SEXE FÉMININ PHALLIQUE
L’apaisement de l’angoisse de castration de l’homme passe par le réel de la castration chez la femme à travers l’excision de son clitoris, assimilé à un pénis, ou encore à travers l’épilation de ses poils pubiens, pratique équivalente à la castration de son sexe dans la mesure où celui‑ci est assimilé dans son aspect visible aux poils pubiens. La toison pubienne est en effet importante dans l’identité féminine puisqu’elle rend visible le sexe féminin qui sinon resterait invisible. Ce n’est pas un hasard si le triangle, dans de nombreuses sociétés, symbolise la femme, en tant qu’il se réfère à la forme triangulaire de la toison pubienne. Totalement épilé, le sexe de la femme ne semble avoir aucune réalité perceptible. Déjà castrée par nature parce que née sans pénis (Freud 1987, or. 1905) — pénis qui, dans une perspective androcentrée (Fortier, 2021a) incarne le sexe visible par excellence —, la femme est castrée une seconde fois suite à l’épilation de sa toison pubienne.
En réaction avec les représentations picturales récurrentes d’un sexe dénué de toute pilosité, ORLAN réaffirme l’existence d’un sexe naturellement poilu dans une performance ironiquement intitulée À poil sans poils réalisée en 1978 au musée du Louvre. L’artiste choisit de poser non pas devant l’Origine du monde, comme le fera ultérieurement Deborah De Robertis, mais devant un tableau représentant une femme au sexe glabre, afin, d’une part, de mettre en évidence le caractère poilu du sexe féminin, et, d’autre part, de mettre en scène de façon grotesque la pratique dépilatoire tout en dénonçant son caractère mutilatoire. ORLAN (2021, 254) décrit ainsi sa performance : « Face au public assis à mes pieds, j’ai enlevé le triangle de représentation du pubis photographique, dévoilant mes vrais poils que j’avais pris soin de couper au préalable et de recoller à l’aide de colle à postiche. J’ai fait semblant d’arracher ces poils par touffes, et je les ai recollés sur une palette de peintre en plastique sur laquelle il y avait des sparadraps positionnés en croix. Une fois ces poils posés sur la tablette “malade”, mon pubis était lisse et nu, semblable à ceux figurant sur la toile dans mon dos ».
Comme nous l’avons précisé, le sexe d’une femme, non épilé, dans le monde arabo‑musulman étant assimilé à un sexe masculin — le terme de « barbu » utilisé en français pour désigner le sexe féminin renvoie à une représentation de cet ordre —, la menace de son exhibition horrifie les hommes en tant qu’il est le symbole de la confusion des sexes radicalement abhorrée. On peut rapprocher cette peur de celle que provoquait, selon la légende grecque, la Méduse ou Gorgone, nom grec qui se réfère à l’effroi, avec sa barbe et ses cheveux‑serpents dont la vue changeait les hommes en pierre, ou dans d’autres contextes, était cause d’impuissance (Devereux, 2011, 73), pétrification ou castration provoquée par la vision de ce sexe féminin phallique.
Cette peur masculine était utilisée en Grèce ancienne par les femmes qui avaient coutume de s’épiler le pubis. Dans la mesure où leur pilosité sexuelle ne les rendait plus désirables, les épouses, en rébellion contre leur mari, « jetaient le rasoir par la porte » (Cootjans, 2000, 59), déclarant par ce geste la « grève du lit », selon l’expression d’Aristophane.
L’épilation répond à ce double bind lié à la féminité consistant à fabriquer un corps féminin davantage désirable que désirant, conformément à des représentions genrées bien connues d’autres sociétés selon lesquelles seuls les hommes ont droit au désir sexuel (Fortier, 2004). Qu’elles soient voulues dans le cas de l’épilation ou bien subies dans le cas de l’excision, ces opérations découlent indistinctement d’une forme d’aliénation des femmes au regard et au désir masculin, aliénation que la chercheuse américaine en études visuelles, Laura Mulvey (1975), a conceptualisée sous le nom de « male gaze ».
L’artiste française contemporaine Anne Van der Linden rend compte dans une de ses toiles de l’automutilation que constitue le fait de se couper les poils du pubis afin de devenir, selon le titre du tableau, une Cendrillon.
Dans la plupart des sociétés, les femmes sont construites socialement en tant qu’objet de désir, tout entières réduites à leur corps qui se doit d’être beau – ne parle‑t‑on pas de « beau sexe » à leur propos. Aussi, la chirurgie sexuelle que représente l’épilation vise à sculpter la plastique des femmes selon des esthétiques destinées à susciter le désir masculin, désir qui relève de la pulsion scopique (schautrieb) (Freud, 2018, or. 1915 ; Bonnet, 1996) et du registre du visuel.
La présence de charmes spécifiques susceptibles de séduire les hommes détermine la féminité, l’érotisme féminin constituant un préalable nécessaire à la procréation masculine (Fortier, 2022a). Ainsi, dans le monde arabo‑musulman, le rituel d’épilation[52] qui précède la cérémonie de mariage, est accompli dans le but que la femme soit désirable auprès de son mari lors de la nuit de noces afin qu’il parvienne à la déflorer (Fortier, 2022b). Le fait d’avoir un sexe épilé semblable à un sexe de jeune fille renvoie au statut virginal de l’épousée. L’épilation vise à sculpter un sexe féminin débarrassé de tout élément phallique afin de ne pas réveiller l’angoisse de castration masculine qui nuirait au bon déroulement de la sexualité procréative.
DE L’INJONCTION A L’ÉPILATION A LA NYMPHOPLASTIE
Si l’épilation du pubis n’est pas le propre des sociétés arabo‑musulmanes, elle n’a jamais été privilégiée dans les sociétés occidentales[53], bien qu’elle tende à le devenir depuis les années 1990 (Rose, 2010, 13). L’épilation sexuelle est désormais la norme compte tenu de l’influence de certains magazines « féminins » non féministes, et surtout d’images médiatiques et pornographiques (Rose, 2010 ; Sakoyan, 2002) produites pour satisfaire la pulsion scopique des spectateurs.
Selon notre hypothèse, dans la mesure où le sexe féminin en Occident comme ailleurs (Fortier, 2020b), y compris dans l’univers pornographique globalisé (Ovidie, 2004, 84), n’est aucunement considéré comme beau (Fortier, 2020b), la pratique de l’épilation dans les films pornographiques n’a pas pour but de visibiliser le sexe féminin en tant que tel mais plutôt le sexe masculin, « organe »[54] qui, à la différence du premier, est perçu comme majestueux. Il est par ailleurs significatif que si, dans le monde pornographique, la pratique dépilatoire concerne les deux sexes, elle vise surtout à supprimer les poils pubiens féminins (Ovidie, 2004, 84) qui font écran à la bonne visibilité du spectacle pénétratif.
Alors que, dans les années 1970, la pratique de l’épilation du pubis en France était minoritaire, ne touchant que 10 % des femmes, dont à 90 % des femmes originaires du Maghreb (Descamps, 1986, 126), elle est devenue majoritaire en 2013, concernant 85 % des femmes. En 2021, le pourcentage était estimé à 75 %, baisse temporaire liée au COVID qui s’explique par le fait que confinées[55], donc sans regard masculin extérieur, les femmes ne ressentaient plus le besoin de s’épiler. Par ailleurs, la pratique de l’épilation intégrale devient, de nos jours, de plus en plus courante, puisqu’en 2021, 24 % de femmes y avaient recours, notamment des jeunes femmes de moins de vingt‑cinq ans, celles‑ci étant particulièrement influencées par les injonctions pornographiques des réseaux sociaux.
Le poil du pubis, autrefois féminin et désirable, est devenu masculin et répulsif, comme le montrent les déclarations de plusieurs femmes qui, non épilées, se sentent « non féminines » et « freak » (Toerien et Wilkinson, 2003, 334), terme qui renvoie au monstrueux et au bigenré. L’épilation féminine est sans doute un des exemples les plus criants de ce que le chercheur américain Duncan Kennedy (2008, or. 1993) appelle « l’auto‑objectivation féminine » (p. 33) et « l’érotisation de la domination », soit « l’idée que le régime patriarcal construit la sexualité masculine et féminine de sorte qu’hommes et femmes sont excités par des expériences et des images de domination masculine » (p. 60).
Dans la mesure où l’épilation découvre au regard le sexe féminin, auparavant dissimulé sous le « voile » ou le « rideau » que représente la toison pubienne, l’injonction sociale à son perfectionnement esthétique devient de plus en plus pressante, contraignant certaines jeunes femmes[56] à recourir à l’opération de nymphoplastie. Cette chirurgie sexuelle est utilisée par des jeunes filles lorsqu’elles ont le sentiment que leurs lèvres « pendent », surtout eu égard au dictat des représentations publicitaires où le sexe féminin apparaît comme lisse et invisible, sans aucun poil et « sans rien qui dépasse », soit sans aspérité phallique.
Ainsi la nymphoplastie, comme l’excision, consiste à couper ce qui est jugé inesthétique chez la femme, soit ce qui est considéré comme masculin. Une forme d’excision est donc réalisée dans le monde occidental par ceux‑là mêmes qui la condamnent, sans que celle‑ci ne soit envisagée comme telle dans la mesure où les femmes qui procèdent à cette chirurgie sont censées l’avoir choisie. Un même type de « grand partage » ethnocentrique prévaut pour l’épilation qui est qualifiée de « moderne », « tendance » et « libre de choix » lorsqu’elle est pratiquée par des femmes occidentales, alors même qu’elle est perçue comme « religieuse », « traditionnelle » et « forcée » lorsqu’elle concerne des femmes arabo‑musulmanes[57].
Pourtant, dans les deux cas, ces « chirurgies sexuelles », qu’elles soient ou non occidentales, obéissent aux mêmes motivations : sculpter un sexe de femme désirable aux yeux des hommes. Aussi, si l’épilation dans le monde arabo‑musulman est comparable à l’excision dans les sociétés où elle pratiquée, l’épilation dans le monde occidental est similaire à la nymphoplastie à laquelle elle est parfois associée, dans la mesure où ces « technologies du genre » ont en commun de féminiser, sexualiser, revirginiser, et rejuvéniser le corps féminin.
DE JEUNES IMBERBES DÉSIRABLES
La confusion des sexes étant considérée comme nuisible et dangereuse pour la bonne reproduction de la société, ôter ses poils pour une femme ou laisser pousser sa barbe pour un homme visent à distinguer visiblement les deux sexes. Dans la poésie arabe, la pilosité, signe visible de la différence des sexes, distingue l’homme, désigné par sa barbe, de la femme, référée à sa chevelure, mais une particularité de la poésie persane ainsi que de la poésie arabe citadine d’Abū Nuwās (vers 747/768‑815), qu’on ne retrouve pas dans la poésie arabe bédouine (Fortier, 2021c), consiste à chanter les charmes d’un « troisième genre » (Fortier, 2017b) : l’imberbe, paradoxalement caractérisé par sa moustache ou par sa barbe naissante dans la poésie persane et arabe.
Si la moustache (shārib en arabe[58] ou sībīl en persan) et la barbe (lahya en arabe ou rish en persan) sont des indicateurs de masculinité, l’apparition des premiers poils qui marquent le passage du jeune garçon vers l’âge adulte (Fortier, 2010a) signalent que l’adolescent n’est pas tout à fait un homme, demeurant encore asexué ou féminin. Comme le rapporte Le Livre de la barbe (Rish‑namè) du poète persan Obeid‑é‑Zākāni (m. vers 1370), l’éphèbe est admirable tant que sa pilosité est balbutiante, trop de poils venant altérer la beauté de son visage (Patane, 2016, 275) ainsi que la douceur de son corps. Al‑Jāhiz (777‑869), encyclopédiste renommé de Bagdad, dans Le livre des mérites respectifs des jouvencelles et des jouvenceaux (2000), souligne que si les « jouvenceaux » présentent l’avantage de n’avoir « ni menstrues ni grossesses », ils ne sont désirables que jusqu’au moment où ils commencent à avoir de la barbe, à la différence des « jouvencelles » qui le sont beaucoup plus longtemps.
Notons que l’assimilation de l’éphèbe à un « troisième genre » n’est pas propre au monde arabo‑musulman : « À propos de l’“amour nommé socratique”, Voltaire explique dans son Dictionnaire philosophique que “souvent un jeune garçon, par la fraîcheur de son teint, par l’éclat de ses couleurs et par la douceur de ses yeux, ressemble pendant deux ou trois ans à une belle fille ; si on l’aime, c’est parce que la nature se méprend : on rend hommage au sexe, en s’attachant à ce qui en a les beautés, et que, quand l’âge en a fait évanouir la ressemblance, cette méprise cesse”» (cité par Steinberg, 2011, 171).
En islam, l’idéal fantasmatique de jeunes garçons (fatā) demeurant éternellement beaux et imberbes, se retrouve dans la description coranique (LXXVI, 19) des plaisirs qui attendent le croyant au paradis : « Parmi eux circuleront des éphèbes immortels tels qu’à les voir tu les croirais perles détachées » (trad. Blachère, 1980, 629)[59]. Notons que, de façon similaire, dans le monde occidental, c’est un adolescent imberbe qui incarne la figure de l’amour sous la personne de Cupidon (Greer, 2003, 59), comme le montre le tableau du peintre florentin Alessandro Allori (1535‑1607) intitulé Vénus et l’Amour (vers 1570).
En l’occurrence, ainsi que le remarque Vincent‑Mansour Monteil à propos de la poésie persane, et notamment celle d’Omar Khayyām (vers 1048‑1132) : « L’évocation du duvet velouté (khatt) de la joue d’un adolescent est aussi classique que celle du grain de beauté (khāl) » (Khayyām / Hafêz, trad. Monteil 1998, 167, note 56). Dans les poèmes amoureux d’Hafiz (vers 1315‑1390) (Fortier, 2021b), l’élément homoérotique que représente la moustache naissante d’un garçon est nommée d’un nom particulier : le « trait » (khatt) ou la « ligne » (izār)[60]. On peut à cet égard citer un vers d’Hafiz (Montarezi, 2021, 137) dans lequel cette caractéristique est rattachée à la couleur du paradis et à sa source, nommée Salsabīl dans le Coran (LXXVI, 18)[61] : « La robe verte de votre khat autour des lèvres / comme des fourmis autour du Salsabīl » (sabz‑pūshān‑i khat‑at bar gird‑i lab / hamchū mūrān‑and gird‑i Salsabīl).
L’imberbe est désigné dans la poésie persane, notamment celle d’Omar Khayyām et d’Hafiz, ainsi qu’en Perse jusqu’au XIXe siècle (Najmabadi, 2005, 15), par le terme d’amrad, terme d’origine arabe qu’on retrouve dans la poésie arabe du VIIIe siècle d’Abū Nuwās[62]. De la même manière qu’Hafiz s’extasie sur les « boucles » de l’éphèbe dans le poème intitulé « La lampe qui brille » (p. 130), le poète de Bagdad admire les « accroche‑cœurs » sur les tempes des mignons, rappelons que le nom, ou plus exactement le surnom (kunya) d’Abū Nuwās, qui en arabe signifie « Celui aux cheveux bouclés » (Merzoug, 2002, 12), renvoie à cette caractéristique masculine homoérotique :
« […] Tel est le deuil de mon cœur,
pour les boucles de ta tête
Que ma tombe fleurira
d’un tapis de violettes […] ».
Mais si Abū Nuwās chante sa passion pour les garçons imberbes (ghūlam amrad), de préférence âgés de quinze ans (khumāsi), il ne dédaigne pas non plus les jeunes hommes dont la barbe commence à croître, de même qu’Hafiz apprécie ceux dont la moustache affleure autour des lèvres ; ces garçons sont désignés par un terme particulier, mu‘addir, dérivé du terme arabe ‘idar qui désigne le duvet (Peres, 1953, 341). Comme le révèle un poème d’Abū Nuwās intitulé « L’amour imberbe » (Abū Nuwās, trad. Monteil, 1998, 105), l’intérêt manifeste que porte le poète à l’éphèbe est surtout lié à son absence de pilosité au niveau génital, consentant à ce que celui‑ci se laisse pousser la barbe mais non les poils pubiens. Ceci révèle que le jeune imberbe est objet de désir car son absence de pilosité virile au niveau génital qui l’assimile au féminin ne risque pas de réveiller l’angoisse de castration de son amant au moment des rapports sexuels (Fortier, 2020c) :
« […] Cela fait bien longtemps qu’il me l’avait promis
de ne laisser pousser sa barbe
qu’à condition de laisser glabre
son entrecuisse […] ».
DES IMBERBES TRAVESTIS
En Afghanistan, au Pakistan et en Asie Centrale, c’est la figure des bacha bereesh qui prévaut, expression qui signifie littéralement en dari (dialecte persan) : « garçon sans barbe », dans des pays où la barbe est un indicateur de masculinité et de respectabilité. Ces jeunes garçons sont le plus souvent achetés à leurs parents vers l’âge de onze ans par un souteneur qui leur apprend la musique et la danse avant de les destiner à la prostitution. Il est à cet égard significatif, qu’à la puberté, les jeunes hommes dont les poils commencent à croître arrêtent cette activité pour se marier et procréer, épousant une femme dont la dot a été payée par leur souteneur à leur père (Baldauf, 2010, 17).
Les bacha bereesh se donnent en spectacle dans des mariages ou des cérémonies privées exclusivement masculines où ils se travestissent. À ces occasions, les hommes d’âge mûr rivalisent d’argent et de poèmes pour acquérir un des plus beaux garçons de la soirée. La douceur de leur corps glabre est une caractéristique recherchée, comme le montre un poème composé en l’honneur d’un bacha bereesh lors d’une cérémonie filmée par le réalisateur afghan Najbullah Quraishi dans son documentaire The Dancing Boys of Afghanistan (2010) :
« Son corps est si doux
Ses lèvres sont si tendres
Il touche le garçon
À travers ses habits de coton
Où habites‑tu ?
Ainsi je peux connaître ton père.
Oh garçon ! Je brûle d’amour pour toi ! »[63].
Ce divertissement exclusivement masculin porte un nom, bacha bāzī, littéralement « le jeu du jeune garçon », composé du terme bacha qui signifie « garçon » et du terme bāzī qui signifie « jeu » (De Lind van Wijngaarden, 2011, 1064). Dans la communauté ouzbek d’Afghanistan, cette pratique est appelée bacabaozlik, et les termes d’adresse entre le garçon et celui qui le désire sont pour le premier uka ou « jeune frère », et pour le second, aka ou « frère aîné » (Baldauf, 1990, 15). La différence d’âge et de statut hiérarchique entre l’adulte et l’éphèbe sont ainsi marquées par la référence à l’aîné et au cadet. Par ailleurs, l’emploi de ce type de vocabulaire, qui relève du registre de la fraternité, vise à « légitimer » une relation de type homosexuelle. Loin d’être une activité honteuse, posséder un mignon est un signe de prestige, d’honneur et de richesse pour un homme en Afghanistan.
Une figure proche de celle des bacha bereesh est celle des köçek, indissociables de la culture des harems du monde ottoman du XVIIe au XIXe siècle. Le terme turc köçek (pluriel köçekler), dérivé du persan kuchak qui signifie « petit ou jeune », désignait des garçons habituellement travestis en femme qui se produisaient dans des palais ottomans, et notamment dans les harems où ils étaient admis dans la mesure où ils n’étaient pas considérés comme des hommes à part entière (Popescu‑Judetz, 1982, 43). Leur performance dansée avait lieu pour le plaisir du sultan ou à l’occasion de cérémonies de mariage et de circoncision. Ils étaient recrutés parmi la population non musulmane de l’empire ottoman (Juifs, Roumains, Grecs, Albanais, Arméniens) (Van Dobben, 2008, 45). Les köçek commençaient leur formation à la musique et à la danse vers l’âge de sept ou huit ans, et leur carrière durait, comme pour les bacha bereesh, tant qu’ils demeuraient imberbes (Shay, 2005, 139), généralement vers douze ans.
De même que les miniatures persanes représentaient des amrad (Najmabadi, 2005), les miniatures ottomanes représentent des köçek (Van Dobben, 2008, 48). Ils y apparaissent sans moustache, attribut masculin essentiel du monde ottoman (Delaney, 1992 ; Fliche, 2011 ; Yücel, 2009), et avec des cheveux longs, ces deux caractéristiques corporelles (moustache et cheveux longs) correspondant à des marqueurs du corps inversement genrés. Leur féminité transparaît dans leurs cheveux longs mais aussi dans leur travestissement puisqu’ils sont vêtus d’une jupe ample (Van Dobben, 2008, 48). Le caractère féminin et érotique de leur danse qui utilise des castagnettes attisait le désir des hommes avec lesquels ils entretenaient des relations homosexuelles passives (Dror, 2006, 86). Le phénomène des köçek a graduellement disparu suite à la suppression de la culture du harem à la fin du XIXe siècle (Schmitt, 1992, 84‑85).
Une figure similaire au köçek ottoman est celle du khawal (pluriel khawalat) à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle en Égypte (Boone, 2014, 188). Les khawal étaient de jeunes hommes imberbes, dansant travestis avec des castagnettes à la manière des danseuses égyptiennes ou ghawazee. Comme pour ces dernières, leurs mains étaient ornées de henné, leurs cheveux longs tressés, et leurs yeux maquillés de khôl (Hanna, 1988, 57‑58). Les khawal se produisaient à des occasions festives comme les mariages, les naissances, et les circoncisions. Le public masculin les trouvait désirables ; à cet égard, le mot khawal dans le dialecte arabe égyptien se réfère à leur rôle passif dans les relations sexuelles avec des hommes.
Dans le monde arabo‑musulman, certains jeunes hommes imberbes sont voués à la satisfaction sexuelle d’autres hommes dans une relation de domination qui conjugue la différence d’âge (imberbe/adulte), de genre (garçon efféminé/homme viril), de position sociale (démuni/riche), de rôle sexuel (passif/actif), et de perspective (regardé/regardant). Cette catégorie de garçons impubères ou d’hommes efféminés est le produit de certains désirs masculins qui, loin d’être réprimés socialement, ont droit de cité en tant qu’expression légitime d’une sexualité socialement admise. Cette catégorie d’hommes est objet du regard/désir masculin ou « male gaze » de la même manière que le sont les femmes.
En Occident, contre la tendance à réduire les efféminés à des homosexuels, et inversement les homosexuels à des efféminés, un mouvement né à San Francisco dans les années 1970 a voulu affirmer qu’on pouvait être homosexuel et porter une barbe. Ce mouvement s’est développé à Paris à la fin des années 1990 avec l’apparition du café « Moustache » et de l’association Les gais nounours, rebaptisée aujourd’hui Les ours de Paris. La pilosité est un signe distinctif essentiel de cette communauté « ours » ou bear comme le montre le vocabulaire à laquelle elle se réfère, distinguant « l’ours » (bear) corpulent porteur d’une pilosité faciale et corporelle visible, « l’ourson » (cub) ou ours de moins de trente ans, « l’ours polaire » (polar bear) à la pilosité grisonnante, le « grizli » (grizzly) à la pilosité fournie, la « loutre » ou le « loup » velu et peu corpulent, le « panda » poilu d’origine asiatique. Enfin, le terme péjoratif de « crevette » est réservé à l’imberbe, celui‑ci n’étant, en ce contexte, aucunement idéalisé.
DES EFFÉMINES ÉPILES
Déjà au VIIe‑VIIIe siècle, un terme arabe est attesté pour désigner « l’efféminé » : mukhannath. L’étymologie de ce terme est suggestive puisqu’elle renvoie aux formes lisses et douces, caractéristiques qui sont considérées comme propres à la femme (Boudhiba, 1979, 55). Le terme apparaît dans un hadith ou parole du Prophète : « L’envoyé de Dieu a maudit les hommes s’efforçant de ressembler aux femmes (al‑mukhannathin min al‑rijal) et vice‑versa (al‑mutarajjilat min an‑nisa) » (Nawawy, 1991, 435). Notons qu’un tel anathème se retrouve dans le christianisme où Clément d’Alexandrie ne cache pas son mépris envers les hommes efféminés qui s’épilent, affirmant que le désir de s’embellir « transforme les femmes en courtisanes et les hommes en efféminés (androgynes) » (Agacinski, 2005, 187‑188).
Malgré la réprobation du Prophète à l’égard des mukhannathun, ce hadith atteste de l’existence d’hommes au comportement efféminé à Médine. Ainsi que l’historien américain Everet Rowson (1991, 671) l’affirme : « Il existe à l’évidence une forme d’effémination ou de travestissement reconnue publiquement et institutionnalisée parmi les hommes dans les sociétés antéislamiques et les sociétés arabes du début de l’islam. À la différence des autres hommes, ces efféminés ou mukhannathun pouvaient se joindre librement aux femmes, étant supposé qu’ils n’avaient pour elles aucun intérêt sexuel… ». Ceux‑ci ne se travestissaient pas forcément mais s’épilaient et adoptaient une gestuelle féminine. Ils pratiquaient la musique, le chant et la danse (Rowson, 1991 ; El‑Feki, 2014). En outre, les mukhannathun pouvaient être mariés et avoir des enfants (Mezziane, 2008, 218) dans la mesure où ils n’échappaient pas, à un certain âge, à l’obligation de fonder une famille.
On retrouve des variantes du mukhannath médinois dans le monde perse, ottoman, et arabe (Fortier, 2019b, 2020d). Au‑delà de leur diversité et de leurs désignations variées, ces efféminés partagent des caractéristiques communes avec le mukhannath, telles que celles de s’épiler et d’avoir un corps non velu (Fortier, 2019b). Ne pas porter de barbe dans le monde arabo‑musulman est considéré comme un signe d’efféminisation, un homme imberbe étant en deçà de l’idéal viril.
Ainsi, de même qu’à Byzance les eunuques émasculés étaient distingués des hommes barbus ou barbatoi (Sidéris, 2011, 96), le manque de pilosité des eunuques dans les harems ottomans (Cheikh Moussa, 1983, 84‑214) consécutif à leur émasculation constituait un signe visible de leur impuissance et de leur prédisposition à garder les femmes du sultan. Car, bien que l’islam sunnite interdise l’émasculation, les harems ottomans contournaient l’interdit en pratiquant cette mutilation sur des esclaves vendus par des non‑musulmans, notamment par des marchands chrétiens ou juifs.
Similairement, le terme de barbe (lihya) dans le dialecte arabe local (hassāniyya) de Mauritanie est utilisé pour distinguer de façon métonymique l’homme par rapport à la femme. Inversement, l’expression désignant un homme sans barbe renvoie à l’efféminement : mistandhi dérive du terme nisa qui désigne la femme en arabe. Il existe par ailleurs dans la société maure une catégorie d’efféminés nommés gūrdigan, terme wolof composé du vocable gūr signifiant homme et digan, femme, soit « homme‑femme ». Outre le fait d’être imberbes, leur absence de poils au niveau des bras, qu’ils épilent à l’instar des femmes, est le signe visible de leur féminité.
Les gūrdigan, caractérisés physiquement par leur absence de pilosité, et par conséquent de virilité, ne risquent pas d’attenter à la vertu des femmes, ainsi que l’atteste leur présence dans les mariages où ils sont invités à danser et à jouer du tam‑tam. Ils fréquentent également les salons féminins où ils jouent le rôle d’entremetteur entre les sexes (Fortier, 2004). Même si beaucoup sont mariés, ils aiment séduire les hommes dans une société où l’homosexualité demeure de l’ordre de l’irreprésentable.
La moustache est également l’insigne de la masculinité en Iran (Najmabadi, 2005), et appeler un homme qui a peu de poils sur le visage kuseh est extrêmement péjoratif dans la mesure où ce terme persan renvoie à un homme qui manque de virilité (Riahi, 2009). Une telle représentation est partagée par les hommes trans iraniens (Najmabadi, 2013 ; Saedzadieh, 2020) pour lesquels il est plus important d’avoir une moustache (sībīl en persan) qu’un pénis.
Davantage qu’une moustache, les hommes trans en France portent une barbe, la pilosité apparue avec la prise d’hormones préfigurant une « nouvelle adolescence » et une renaissance. Inversement, la première « chirurgie sexuelle » à laquelle ont recours les femmes trans consiste non pas dans l’hormonothérapie, la plastie mammaire ou encore la chirurgie sexuelle, mais dans l’épilation du visage, puis du corps dans son ensemble (Fortier, 2014a).
Les femmes trans doivent sans cesse lutter contre la repousse de leurs poils comme le montre le documentaire 24 heures dans la vie de Diane (Fortier, 2014b) où la protagoniste s’épile au niveau des seins malgré qu’elle ait subi une épilation laser pendant plusieurs années, comme si le masculin refaisait surface dans un des lieux les plus féminins du corps, les seins (Fortier, 2020e), organes qu’elle vient tout juste d’acquérir suite à une opération chirurgicale.
En outre, la prise d’œstrogènes chez les femmes trans adoucit leur peau et les féminise, tandis que la testostérone chez les hommes trans développe leur pilosité et les masculinise. Car, si la moustache ou la barbe est un signe de masculinité au niveau du visuel, la peau « drue » l’est également sur le plan du toucher, tandis que la peau douce constitue un indice de féminité.
IMBERBES VERSUS BARBUES
Dans le monde arabo‑musulman, les corps sans poils des femmes, des garçons imberbes, et des efféminés, sont objets du désir masculin en tant qu’ils sont féminisés et donc érotisés. Selon notre hypothèse, le jeune imberbe ou l’efféminé, assimilé d’une certaine manière à une femme, est objet de désir homoérotique, car son absence de pilosité virile au niveau des parties visibles de son corps, signe patent de son absence de pilosité au niveau génital, ne risque pas de réveiller l’angoisse de castration de son amant, amant qui, n’ayant pas l’impression de copuler avec un autre homme, ne se considère pas comme homosexuel.
En revanche, la figure homosexuelle occidentale de l’« ours » qui exhibe une longue barbe n’est guère importable dans le monde arabo‑musulman, puisque l’union sexuelle entre deux porteurs de barbe trahirait une relation de type homosexuelle condamnée par l’islam (Fortier, 2017b). C’est donc moins la rencontre des pénis qui détermine l’homosexualité dans le monde arabo‑musulman que la rencontre des barbes, insignes de masculinité plus visibles que le sexe lui‑même.
Selon notre analyse, certaines sociétés arabo‑musulmanes ont érotisé non seulement les femmes mais des figures de troisième genre, telles les imberbes ou les efféminés, pour répondre au besoin masculin de délier la sexualité de la procréation, puisque de telles figures, à la différence des femmes, incarnent, dans leur chair, le fantasme d’une sexualité qui ne serait en aucun cas procréative mais purement sexuelle, soit uniquement dédiée à la jouissance masculine.
Ceci explique que la figure inverse de l’homme efféminé, la femme masculinisée, se rencontre peu à l’échelle des sociétés humaines, la femme à barbe n’étant en aucun cas érotisée par le regard masculin. Semblable à la tête de Méduse, la femme à barbe apparaît comme une icône repoussoir et grotesque qui a pu être exhibée dans des cirques européens[64] (Ernoult, 2019 ; Monestier, 2002). Ainsi que le remarque Jean Clair (1989, 39) : « Or l’inquiétant naît précisément de cette double lecture, de cette ambiguïté cachée au cœur de la représentation qui nous la fait appréhender simultanément comme familière et comme étrangère, comme désirable et comme repoussante. Le visage de Gorgô est effroyable, mais il est aussi grotesque : il suscite la peur, mais aussi, dès qu’il s’est lui‑même objectivé, pétrifié en masque, il est sa propre parade, le risible. “ Femme à barbe”, c’est un monstre de foire ».
L’histoire de sainte Wilgeforte est à cet égard éloquente. Selon la légende, cette princesse s’était convertie au christianisme à l’insu de son père, un roi païen du Portugal (Bromberger, 2010, 72 ; Gélis, 2011, 133). Lorsque celui‑ci décida de la marier au roi de Sicile alors qu’elle avait fait vœu de chasteté, Wilgeforte implora l’aide de Dieu. Celui‑ci lui fît pousser une barbe qui eut pour effet d’éloigner définitivement son prétendant. Pour la punir de sa désobéissance, son père la fit crucifier.
Devenue sainte, sa dévotion fut très populaire en Europe au XVe siècle chez les femmes qui souhaitaient se débarrasser de leur mari, d’où son surnom en français de « sainte Débarras », en anglais de « sainte du Désencombrement (Encumber ou Uncumber) » (Warner, 1995, 309)[65], ou encore, dans plusieurs langues romanes de « sainte Libératrice (santa Liberata) » (Bromberger, 2010, 73 ; Gélis, 2011, 135).
On trouve au sein même du christianisme des figures symétriquement inverses à sainte Wilgeforte, telle sainte Agathe, masculinisée non plus par l’ajout d’un élément anatomique masculin comme la barbe, mais par la soustraction d’un organe spécifiquement féminin, les seins (Fortier, 2022a, 9‑10). En effet, la légende (De Voragine, 1998, 146‑150)[66] raconte que le gouverneur romain Quintien les lui fit arracher après qu’elle eut résisté à ses avances.
En toute hypothèse, l’élection d’Agathe au rang de sainte tient moins à sa foi qu’à sa transformation corporelle en un troisième sexe, conjuguant, compte tenu de son amputation des seins, un torse masculin et un sexe féminin, de même que la sanctification de sainte Wilgeforte découle moins de son abnégation que de sa métamorphose en une figure de troisième sexe suite à l’apparition de sa barbe. On sait en effet que les troisièmes sexes sont, dans de nombreuses sociétés, assimilés à des figures sacralisées, ou inversement, que des figures religieuses sont apparentées à des troisièmes genres.
Or, comme le montre l’exemple de ces deux saintes, le christianisme n’échappe pas au culte du troisième genre. Ce type de culte est probablement hérité d’anciens rites, notamment grecs ou romains, dont la dévotion, fortement ancrée, n’a pu être éradiquée. De même que la chrétienté a construit des églises sur des temples préexistants, elle a intégré ces figures de troisième genre dans le « panthéon chrétien »[67] (Fortier, 2020f). En l’occurrence, d’autres figures de femmes à barbe ont été l’objet de culte avant l’ère chrétienne, qu’on pense à l’Aphrodite barbue de Chypre nommée Aphroditos (Delcourt, 1992, 43, 44), dont sainte Wilgeforte est sans doute la réminiscence.
En outre, sainte Wilgeforte qui arbore une chevelure féminine et une barbe masculine apparaît comme la figure inverse du Christ qui cumule une barbe et des cheveux longs[68], l’un et l’autre se confondant[69], sans qu’on puisse savoir qui est la sainte et qui est le Christ, qui est la femme et qui est l’homme.
CHRIST, PROPHETE, ET AUTRES FIGURES DE TROISIEME GENRE
Le Christ barbu aux cheveux longs, tel qu’on le connaît aujourd’hui en Occident, proviendrait d’Orient et serait inspiré de la figure apotropaïque de la Gorgone comme le relève l’historien d’art André Grabar[70] (cité par Kristeva, 1998, 47) : « […] le rôle que le mandylion jouait primitivement dans la vie religieuse de l’Orient chrétien et son iconographie particulière trouvent une analogie curieuse dans les Gorgoneia. On aurait pu douter de la possibilité de rapports quelconques entre cet apotropée païen et l’image chrétienne qui n’apparaît qu’au VIe siècle. Mais on sait que précisément les têtes de Gorgone étaient encore reproduites sur les objets d’époque byzantine et servaient toujours de talismans ».
La barbe du Christ serait orientale puisque jusqu’au VIe siècle, le Christ en Occident était représenté sans barbe tel un jeune éphèbe (De Landsberg, 2001, 26). Il subsiste aujourd’hui très peu de représentations d’un Christ imberbe, hormis celle tardive et tout à fait exceptionnelle dans l’histoire de l’art occidental de La Cène à Emmaüs (1606) du Caravage (1571‑1610), peintre italien dont on connaît la passion pour les jeunes garçons.
Ainsi que l’analyse l’historienne Marie‑Pierre Auzépy (2011, 72), la barbe « est devenue un signe tangible de l’opposition entre la part occidentale de la chrétienté et sa part orientale, la marque de la division de l’Église en un Occident glabre et un Orient velu ». Or, c’est la figure orientale du Christ qui va peu à peu s’imposer dans le monde occidental « au point que l’on n’imagine plus un Christ glabre » (Auzepy, 2011, 72), à l’exception du tableau de Caravage qui nous rappelle cette réalité.
Le Christ barbu est donc davantage une figure orientale qu’occidentale. Remarquons que la figure orientale de Mahomet porte également une barbe. Les hadith attestent que le Prophète, modèle pour les musulmans, possédait une moustache et une barbe dont il prenait grand soin, les taillant régulièrement avec des ciseaux (Dinet et Ben Ibrahim, 1937, 269)[71].
Dans le droit musulman, et en particulier malékite, on estime que la barbe peut être écourtée lorsqu’elle devient trop longue (Qayrawānī, 1979, 305). La taille de la barbe symbolise pour un homme le contrôle de sa virilité et de ses pulsions sexuelles ; idée que l’on retrouve en Occident, notamment en Grèce ancienne avec la figure antonymique du satyre, représenté poilu comme un bouc, animal bien connu pour sa puissance libidinale.
À la différence du christianisme, il n’existe pas d’iconographie musulmane du Prophète en islam compte tenu de l’interdiction de la représentation de la figure humaine dans cette religion, à l’exception du chiisme iranien qui l’autorise. En effet, en Iran, dans les années 1990 et 2000[72], des images populaires du Prophète, notamment sous forme de poster, le représentent non pas sous la figure d’un barbu autoritaire ainsi que le pense l’Occident — cf. l’affaire des « caricatures de Mahomet » — mais d’un jeune éphèbe à l’épaule dénudée, image qui ressemble étonnamment au Christ imberbe dépeint par Le Caravage. Comme le remarquent les anthropologues Pierre Centlivres et Micheline Centlivres‑Demont (2005, 2‑3) : « […] il s’agit d’un visage d’adolescent, avec une touche très occidentale évoquant le maniérisme de la Renaissance tardive, celle de la fin du Cinquecento, mais surtout les peintures d’adolescents du Caravage, par exemple le Jeune Garçon portant une corbeille de fruits de la galerie Borghese à Rome ou le Saint Jean‑Baptiste du musée du Capitole ; même peau veloutée, même bouche entrouverte, même regard caressant ».
Les Centlivres ont découvert au détour d’une exposition que l’image du Prophète provenait d’un cliché du photographe autrichien homosexuel Rudolf Franz Lehnert (1878‑1948). Ce dernier, installé avec son ami allemand Ernst Heinrich Landrock (1878‑1966) à Tunis jusqu’en 1914, puis au Caire à partir de 1924, créera une maison d’édition de photos à leurs deux noms (L&L), publiant plusieurs milliers de photographies et de cartes postales dites « exotiques » pour ne pas dire « pédophiliques », dont celle utilisée pour Mahomet (p. 3‑4). Comme l’expliquent les Centlivres, Lehnert fait poser de jeunes garçons dévêtus pour « une clientèle européenne adepte de “l’amour qui n’ose pas dire son nom”. Ces garçons et ces jeunes filles ont l’aspect gracieux d’un âge qui hésite entre l’enfance et l’adolescence, entre le féminin et le masculin ». Lehnert s’est sans aucun doute inspiré du photographe allemand homosexuel Wilhelm von Gloeden (1856‑1931) installé à Taormina en Sicile entre 1898 et 1913, qui, pour satisfaire les désirs homoérotiques d’une clientèle occidentale, produisait des clichés de jeunes Siciliens vêtus à l’antique.
L’image du Prophète en Iran serait donc la réplique d’une carte postale homoérotique datée de 1905‑1906 sur laquelle figurait l’inscription « Mahomet », prénom du jeune tunisien ayant posé pour Lehnert. Cette homonymie explique que le portrait de ce garçon ait été retenu pour représenter le Prophète. La boucle est bouclée, puisque si l’image du Christ barbu en Occident dérive de l’iconographie orientale d’un troisième sexe nommé Gorgone, celle du Prophète imberbe en Iran est inspirée de l’iconographie occidentale de l’éphèbe, autre figure de troisième genre.
DES BARBUS AUX BARBUES
Si, comme on l’a vu, la femme à barbe a pu être sanctifiée dans le christianisme sous la figure de sainte Wilgeforte, une telle figure est diabolisée dans l’islam shiite iranien (Bromberger, 2007, 381), figure qui, à l’instar de la Gorgone, n’apporterait qu’effroi et malheur. En effet, en Iran, l’apocalypse est annoncée par une femme barbue juchée sur la chaire d’une des plus grandes mosquées du pays[73]. L’éventualité qu’une femme occupe cette place signifierait que le pouvoir religieux et politique, jusqu’alors aux mains des hommes, est désormais détenu par une femme, éventualité qui ne peut être envisagée que comme un signe de mauvais augure. La représentation selon laquelle l’accès des femmes au pouvoir signerait la destruction de la société n’est pas propre à l’Iran puisqu’on la retrouve dans de nombreuses sociétés que ce soit en Égypte ou en France (Fortier, 2010b), ou encore en Océanie (Godelier, 1982) ou en Amazonie (Bidou, 2001), ce type d’idéologie catastrophiste d’ordre patriarcale visant à discréditer les compétences des femmes à exercer le pouvoir.
Le pouvoir étant symbolisé par l’attribut masculin que représente la barbe, les « barbus » du régime iranien, selon un scénario apocalyptique, sont devenus des « barbues ». Arborer une barbe proéminente constitue un signe de pouvoir dans le monde arabo‑musulman, comme le montre ceux qui sont dénommés de façon péjorative par leurs contemporains « les barbus », qu’il s’agisse des ayatollahs, des talibans ou des islamistes. Le symbole patriarcal de la barbe n’est pas propre à l’islam, puisqu’on le retrouve dans le christianisme où il est « la marque de la décision divine de donner le pouvoir à l’homme » (Agacinski, 2005, 187).
Notons par ailleurs que Dieu est lui‑même représenté dans le monde chrétien avec une barbe, à l’instar de Jupiter, le roi des dieux grecs, comme le montre le tableau particulièrement éloquent de Jean‑Auguste‑Dominique Ingres, Jupiter et Thétis (1811) dans lequel la pilosité de Jupiter est inversement proportionnelle à celle de Thétis. La hiérarchie entre les sexes est ici très nettement affirmée par la posture de Jupiter campé sur son trône à l’extrémité supérieure de la toile, alors même que la nymphe à la peau lisse est figurée à plus petite échelle dans une position de soumission à l’égard de ce dieu tout puissant qu’elle tente néanmoins d’approcher en lui caressant la barbe, geste tout à la fois affectueux et sexuel[74].
Ainsi que le remarque la philosophe Sylviane Agacinski (p. 87) : « Si la pilosité est apte à symboliser l’autorité mâle, c’est évidemment qu’elle fait défaut chez les femmes et chez les jeunes sur qui cette autorité s’exerce ». La barbe est en effet l’équivalent du phallus au sens psychanalytique (Schneider, 2000). Le socioanthropologue Pierre Bourdieu (1972, 60, note 4) a par ailleurs montré qu’en Algérie la barbe ou la moustache est une composante essentielle de l’honneur masculin (nīf), si bien qu’une des expressions utilisées pour évoquer un outrage y fait référence : « Un tel m’a rasé la barbe (ou la moustache) », expression qui évoque l’idée de castration, dans la mesure où la barbe est un symbole phallique.
Contre toute attente, la barbe, substitut du pénis, se révèle être un symbole phallique plus visible et plus efficace que le pénis lui‑même étant donné qu’il peut être montré sans fausse pudeur. La barbe a aussi l’avantage de garder son volume, et même de croître, à la différence de l’organe sexuel qui, ne pouvant demeurer ad vitam aeternam en érection, risque de trahir le fait que le patriarcat n’est pas infaillible, remettant ainsi en cause la croyance indéfectible en sa toute‑puissance.
Postiche, la barbe devient un symbole phallique détachable qui peut être porté autant par un homme que par une femme, rejoignant l’analyse que Paul Preciado (2000, 69‑71) fait du « gode » en tant que « prothèse technologique » pouvant tenir lieu de pénis chez les deux sexes. L’usage d’une fausse barbe en tant qu’insigne du pouvoir est connu en Égypte ancienne où une barbe postiche, soigneusement tressée et incurvée au menton, était autant portée par les rois que par les reines, notamment par la reine Hatchepsout qui régna sur l’Égypte vers 1479 et 1457 avant notre ère. Un tel symbole du pouvoir subsiste aujourd’hui en France, comme en témoigne le groupe d’action féministe La Barbe[75] dont les membres s’invitent dans des conseils d’administration masculins affublés de fausses barbes afin de dénoncer l’absence de femmes dans les instances de décision, comme si le pouvoir ne pouvait appartenir qu’aux porteurs de pénis, la barbe !
Références bibliographiques
Abraham K., (1955) [1909], « Dreams and Myths: a Study in Folk Anthropology ». In: Clinical Papers and Essays on Psychoanalysis, vol. 2. New York : Basic Books Publishers.
Abraham K., (1965) [1922], « L’araignée symbole onirique ». Dans : Œuvres complètes/II 1915‑1925, Paris : Payot, 146‑150.
Abū Nuwās, (1998), Le vin, le vent, la vie (présenté et traduit par V.‑M. Monteil). Paris : Actes Sud (Babel).
Agacinski S., (2005), Métaphysique des sexes. Masculin/Féminin aux sources du christianisme, Paris : Seuil (La librairie du XXIe siècle).
Al‑Jahīz, (2000), Le livre des mérites respectifs des jouvencelles et des jouvenceaux (présenté et traduit par B. Bouillon). Paris : Picquier (Le pavillon des corps curieux).
Al Joundi D., (2007), « Zahra. Dans l’intimité d’un salon de beauté à Beyrouth », La pensée du midi, 20, 76‑81.
Allison A., (2000), Permitted and Prohibited Desires: Mothers, Comics, and Censorship in Japan, Berkeley, University of California Press.
Anderson J., (1997), Judith (traduit par B. Turle), Paris : éditions du Regard.
Apollinaire G., (2006), Lettres à Madeleine. Tendre comme le souvenir, Paris : Gallimard (Folio).
Arasse D., (2000), On n’y voit rien. Descriptions, Paris : Denoël (Descriptions).
Avrane P., (2011), « Le poil freudien ». Dans : M.‑F. Auzépy et J. Cornette (dir.), Histoire du poil, Paris : Belin (Alpha), 325‑359.
Auzépy M.‑P., (2011), « Introduction. Ceci n’est pas un libve barbant ». Dans : M.‑F. Auzépy et J. Cornette (dir.), Histoire du poil, Paris : Belin (Alpha), 5‑24.
Auzépy M.‑P., (2011), « Tonsure des clercs, barbe des moines et barbe du Christ ». Dans : M.‑F. Auzépy et J. Cornette (dir.), Histoire du poil, Paris : Belin (Alpha), 71‑92.
Baldauf I., (1990), « Bacabozlik: Boy love, folksong and literature in Central Asia », Paidika, 2/2, 12‑31.
Ben Dridi I., (2004), Le tasfih en Tunisie. Un rituel de protection de la virginité féminine, Paris : L’Harmattan.
Bernardi C., (2014), « Le sexe et l’œil : anatomies surréalistes de l’Origine du monde ». Dans : Cet obscur objet de désirs. Autour de L’Origine du monde, Paris : Lienart (musée Courbet), 145‑155.
Besse C., (2003), « Iconographies du sexe féminin ». Dans : C. Besse et al. (dir.), Cachez ce sexe que je ne saurais voir, Paris : Dis voir, 33‑66.
Bidou P., (2001), Le Mythe de Tapir Chaman. Essai d’anthropologie psychanalytique, Paris : Odile Jacob, 2001.
Bidou P., (2004), « Les organes de la pensée ». Dans : F. Héritier et M. Xanthakou (dir.), Corps et affects, Paris : Odile Jacob, 33‑42.
Bonnet G., (1996), La violence du voir, Paris : PUF (bibliothèque de psychanalyse).
Boone J.A., (2014), The Homoerotics of Orientalism: Mappings of Male Desire in Narratives of the Near and Middle East, Columbia : Columbia University Press.
Bouhdiba A., (1979), La sexualité en Islam, Paris : PUF.
Bourdieu P., (1972), Esquisse d’une théorie de la pratique, précédée de trois études d’ethnologie kabyle, Genève : E. Droz.
Brassaï (2016), Graffitis, Paris : Flammarion.
Bromberger C., (2005), « Trichologiques : les langages de la pilosité ». Dans : Un corps pour soi, Paris : PUF, 11‑40.
Bromberger C., (2007), « Hair: From the West to the Middle East through the Mediterranean », Journal of American Folklore, 121/482, 379‑399.
Bromberger C., (2010), Trichologiques. Une anthropologie des cheveux et des poils, Paris : Bayard.
Bromberger C., (2011), « Note sur les dégoûts pileux », Ethnologie française, 41, 27‑31.
Cajori M. et Wallach A., (réalisateurs), (2008), Louise Bourgeois : L’araignée, la maîtresse et la mandarine (Louise Bourgeois: The Spider, the Mistress and the Tangerine), [documentaire 99 mns], USA, Art Kaleidoscope Foundation.
Camps G., (1994), « La danse des cheveux », Encyclopédie berbère, 14, « Danse », https://journals.openedition.org/encyclopedieberbere/2373
Centlivres P. et Centlivres‑Demont M., (2005), « Une étrange rencontre. La photographie orientaliste de Lehnert et Landrock et l’image iranienne du prophète Mahomet », Études photographiques, 17, 4‑15.
Charuty G., (1987), « Le mal d’amour », L’Homme, 103/XXVII (3), 43‑72.
Chebel M., (1995), Encyclopédie de l’amour en islam, Paris : Payot.
Cheikh Moussa A., (1982), « Gahiz et les eunuques ou la confusion du même et de l’autre », Arabica, 29, 184‑214.
Clair J., (1988), Le nu et la norme. Klimt et Picasso en 1907, Paris : Gallimard.
Clair J., (1989), Méduse. Contribution à une anthropologie des arts du visuel, Paris : Gallimard (NRF).
Collectif, (2001), Picasso érotique, Paris : RMN.
Cootjans G., (2000), « Le pubis, les poils pubiens et l’épilation : sources grecques », Revue belge de philologie et d’histoire, 78/1, 53‑60.
Coran, (1980), (présenté et traduit par R. Blachère). Paris : Maisonneuve et Larose.
Cronier E., (2011), « Les poilus ». Dans : M.‑F. Auzépy et J. Cornette (dir.), Histoire du poil, Paris : Belin (Alpha), 261‑282.
Da Silva J., (2009), Du velu au lisse. Histoire et esthétique de l’épilation intime, Paris : Complexe.
De Garine I., (1987), « Massa et Moussey : la question de l’embonpoint ». Dans : N. Czechowki et V. Nahoum‑Grappe (dir.), Fatale beauté. Une évidence, une énigme, Paris : Autrement, 91, 114‑115.
De Heusch L., (1971), Pourquoi l’épouser ? Et autres essais, Paris : Gallimard.
Delaney C., (1992), « Untangling the Meanings of Hair in Turskish Society », Anthropological Quaterly, 67/4, 159‑172.
De Landsberg J., (2001), L’art en croix. Le thème de la crucifixion dans l’histoire de l’art, Paris : La renaissance du livre.
De Lauretis T., (2007) [1987], Théorie queer et cultures populaires. De Foucault à Cronenberg (traduit par S. Bourcier, préface de P. Molinier). Paris : La Dispute.
Delcourt M., (1992), Hermaphrodite, Paris : PUF.
De Lind van Wijngaarden J.W. et Bushra R., (2011), « Male adolescent concubinage in Peshawar, Northwestern Pakistan », Culture, Health and Sexuality, 13/9, 1061‑1072.
De Martino E., (1999) [1961], La terre du remords (La terra del rimorso), t. III. Œuvres de Ernesto de Martino (traduit par Claude Poncet), Paris : Les empêcheurs de penser en rond.
Descamps M.‑A., (1986), L’invention du corps, Paris : PUF.
Des Cars L., (2008), Gustave Courbet, Paris : RMN.
Devereux G., (2011) [1983], Baubô. La vulve mythique, Paris : Payot (Petite bibliothèque), or. J.C. Godefroy.
De Voragine J., (1998) [1261‑1268], La légende dorée, Paris : Seuil (Points Sagesse).
Dinet E. et Ben Ibrahim S., (1937), La vie de Mohammed, Paris : G. P. Maisonneuve.
Dror Z., (2006), Producing Desire: Changing Sexual Discourse in the Ottoman Middle East, 1500‑1900, Berkeley : University of California Press.
El‑Feki S., (2013), La révolution du plaisir, Paris : Autrement.
Ernoult N., (2012), « “Trouble dans le genre”, l’ambivalence sexuelle de la femme à barbe dans les représentations ». Dans : A. Caiozzo (dir.), Femmes médiatrices et ambivalentes. Mythes et imaginaires, Paris : Armand Colin (« Recherches »), 131‑144.
Ferenczi S., (1974), Œuvres complètes, Psychanalyse, t. 3, Paris : Payot.
Ferenczi S., (2011) [1983], « La nudité comme moyen d’intimidation ». Dans : G. Devereux, Baubô. La vulve mythique, Paris : Payot (Petite bibliothèque), 239‑242.
Feydeau E, (1868), La comtesse de Chalis ou les mœurs du jour, 1867, étude, Paris : Michel Lévy frères.
Filloux J., (2002), « La peur du féminin : de “La tête de Méduse” (1922) à “La féminité” (1932) », Topique, 78, 103‑117.
Flandrin J.‑L., (1987), « Chant d’amour : à boire et à manger ». Dans : N. Czechowki et V. Nahoum‑Grappe (dir.), Fatale beauté. Une évidence, une énigme, Paris : Autrement, 91, 32‑36.
Fliche B., (2011), « Éléments pour une trichologie turque ». Dans : M.‑F. Auzépy et J. Cornette (dir.), Histoire du poil, Paris : Belin (Alpha), 235‑260.
Fortier C., (1998), « Le corps comme mémoire : du giron maternel à la férule du maître coranique », Journal des Africanistes, 68/1‑2, 199‑223, http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/jafr_03990346_1998_num_68_1_1169
Fortier C., (2001), « “Le lait, le sperme, le dos. Et le sang ?”. Représentations physiologiques de la filiation et de la parenté de lait en islam malékite et dans la société maure de Mauritanie », Les Cahiers d’Études Africaines, XL1/161, 97‑138, http://etudesafricaines.revues.org/68
Fortier C., (2004), « Séduction, jalousie et défi entre hommes. Chorégraphie des affects et des corps dans la société maure ». Dans : F. Héritier et M. Xanthakou (dir.), Corps et affects, Paris : Odile Jacob, 237‑254. https://books.google.com.ec/books?id=wSfGmRgz79wC&lpg=PA1&hl=fr&pg=PA237#v=onepage&q=fortier&f=false
Fortier C., (2005), « “Infléchir le destin car la vraie souffrance est à venir” (société maure‑islam sunnite) », Systèmes de pensée en Afrique noire, 17, C. Casajus (dir.), L’excellence de la souffrance, 195‑217.
Fortier C., (2010a), « La barbe et la tresse. Marqueurs de la différence sexuée (société maure de Mauritanie) », Les cahiers du Laboratoire d’Anthropologie Sociale, 6, D. Karadimas (dir.), Poils et sang, 94‑104.
Fortier C., (2010b), « Le droit au divorce des femmes (khul‘) en islam : pratiques différentielles en Mauritanie et en Égypte », Droit et Cultures, 59/1, dans : C. Fortier (dir.), Actualités du droit musulman : genre, filiation et bioéthique, 55‑82. http://droitcultures.revues.org/1950
Fortier C., (2012), « Sculpter la différence des sexes. Excision, circoncision et angoisse de castration (Mauritanie) », dans : M. Lachheb (dir.), Penser le corps au Maghreb, Paris : Karthala/IRMC (Hommes et Sociétés), 35‑66.
Fortier C., (2014a), « La question du “transsexualisme” en France. Le corps sexué comme patrimoine », Les Cahiers de droit de la santé, 18, dans : D. Nicolas (dir.), Corps et Patrimoine, 269‑282.
Fortier C., (réalisatrice), (2014b), 24 heures dans la vie de Diane [documentaire, 15 mns].
Fortier C., (2017a), « Derrière le “voile islamique”, de multiples visages. Voile, harem, chevelure : identité, genre et colonialisme ». Dans : A. Castaing et É. Gaden (dir.), Écrire et penser le genre en contextes postcoloniaux, Berne : Peter Lang (Comparatisme et société), 233‑258.
Fortier C., (2017b), « Intersexuation, transsexualité et homosexualité en pays d’islam ». Dans : M. Gross et R. Bethmont (dir.), Homosexualité et traditions monothéistes : vers la fin d’un antagonisme ?, Genève : Labor et Fides, 123‑137.
Fortier C., (2019a) « Inceste gémellaire, deuil et mélancolie créatrice. De la transidentité à l’œuvre de Pierre Molinier et d’Annie Ernaux », L’Autre, 20/1, dans : C. Mestre et M.‑R. Moro (dir.), Françoise Héritier : leçons apprises, 51‑61.
Fortier C., (2019b), « Sexualities: Transsexualities: Middle East, North Africa, West Africa », Encyclopedia of Women and Islamic Cultures (EWIC), in: S. Joseph (dir.), 20, Leiden : Brill, http://dx.doi.org/10.1163/1872‑5309_ewic_COM_002185
Fortier C., (2020a), « Vers une reconnaissance des corps‑identités. Excisées, amazones, intersexes, trans, et sourds », Droit et cultures, 80, C. Fortier (dir.), Réparer les corps et les sexes, 2, Intersexuation, transidentité, reconstruction mammaire, et surdité, https://journals.openedition.org/droitcultures/6675
Fortier C., (2020b), « Reconstruction clitoridienne, excision et circoncision. Variations autour d’un sexe féminin phallique », Droit et cultures, 79, dans : C. Fortier (dir.), Réparer les corps et les sexes, 1, Excision, circoncision, et reconstruction clitoridienne, 29‑76. https://journals.openedition.org/droitcultures/5977
Fortier C., (2020c), « Réparer les corps et les sexes. Des rituels sexués aux chirurgies sexuelles », Droit et cultures, 79, C. Fortier (dir.), Réparer les corps et les sexes, 1, Excision, circoncision, et reconstruction clitoridienne, 9‑14, https://journals.openedition.org/droitcultures/5973
Fortier C., (2020d), « Troisième genre et transsexualité en pays d’islam », Droit et cultures, 80, dans : C. Fortier (dir.), Réparer les corps et les sexes, 2, Intersexuation, transidentité, reconstruction mammaire, et surdité, https://journals.openedition.org/droitcultures/6763
Fortier C., (2020e), « Seins, reconstruction, et féminité. Quand les Amazones s’exposent », Droit et cultures, 80, dans : C. Fortier (dir.), Réparer les corps et les sexes, 2, Intersexuation, transidentité, reconstruction mammaire, et surdité, https://journals.openedition.org/droitcultures/6721
Fortier C., (2020f), « Des femminielli aux hijras : la féminité mise en scène. Phallus, virginité et troisième genre à Naples (Campania) ». Dans : I. Becci et F. Prescendi Morresi (dir.), Imaginaires queers. Transgressions religieuses et culturelles à travers l’espace et le temps, Lausanne : BSN Press (A contrario campus), 41‑61. https://www.cairn.info/imaginaires‑queers‑‑9782940648160‑page‑41.htm
Fortier C., (2021a), « Une parenté de corps et un genre sexué : en dialogue avec Françoise Héritier. Des substances à la psyché, de la procréation à l’érotisme, de l’inceste du second type à l’inceste gémellaire, du ventre féminin au sperme masculin, de l’enfantement à l’engendrement, du Sahara à un centre de PMA ». Dans : M. Texeira et F. Viti (dir.), Les butoirs de la pensée. Corps et parenté : hommage à Françoise Héritier, Paris : éditions des Archives contemporaines, 19‑41. doi : 10.17184/eac.9782813004420
Fortier C., (2021b), « Introduction. L’amour poétisé : genre, plaisir et nostalgie dans la poésie arabe et persane masculine, féminine et homoérotique. Gender, Pleasure and Nostalgia in Masculine, Feminine and Homoerotic Arabic and Persian Poetry », Anthropology of the Middle East, 16 /2, dans : C. Fortier (dir.), L’amour poétisé : affects, genre et sociétés. Poetised Love: Affects, Gender and Society, 1‑32. doi:10.3167/ame.2021.160201, https://www.berghahnjournals.com/view/journals/ame/16/2/ame160201.xml
Fortier C., (2021c), « Le désir poétisé ou le goût des Fleurs du mal (poésie maure / poésie arabe antéislamique) », Anthropology of the Middle East, 16/2, dans : C. Fortier (dir.), L’amour poétisé : affects, genre et sociétés. Poetised Love: Affects, Gender and Society, 33‑56, doi:10.3167/ame.2021.160201
Fortier C., (2022a), « Chirurgies sexuelles. Du corps transformé à l’identité retrouvée ». Dans : C. Fortier (dir.), Le corps de l’identité. Transformations corporelles, genre et chirurgies sexuelles, Paris : Karthala, 7‑43.
Fortier C., (2022b), « Virginité féminine/défloration masculine. “Certificats de virginité”/chirurgies de revirginisation ». Dans : C. Fortier (dir.), Le corps de l’identité. Transformations corporelles, genre et chirurgies sexuelles, Paris : Karthala, 55‑104.
Fournier M., (2011), « Mutilations sexuelles féminines. Approche anthropologique psychanalytique », L’Autre, 12/1, 55‑67.
Freud S., (1950) [1915], Ma vie et la psychanalyse, Paris : Gallimard.
Freud S., (1984) [1933], Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse, Paris : Gallimard (Folio).
Freud S., (1985) [1922], « La tête de Méduse », dans : Résultats, idées, problèmes, 1921‑1938, t. 2 (traduit par J. Laplanche). Paris : PUF.
Freud S., (1987) [1905], Trois essais sur la théorie sexuelle, Paris : Gallimard (Folio Essais).
Freud S., (2018) [1915], Pulsions et destins des pulsions, Paris : Payot (Petite bibliothèque).
Frontisi‑Ducroux F., (2003), L’Homme‑cerf et la femme araignée. Figures grecques de la métamorphose, Paris : Gallimard (Le Temps des images).
Frontisi‑Ducroux F. et Vernant J.‑P., (1997), Dans l’œil du miroir, Paris : Odile Jacob.
Gallini C., (1988), La danse de l’argia : fête et guérison en Sardaigne (traduit par G. Charuty et M. Valensi). Paris : Verdier.
Gélis J., (2011), « Le poil monstrueux : femmes à barbe et hommes‑chiens ». Dans : M.‑F. Auzépy et J. Cornette (dir.), Histoire du poil, Paris : Belin (Alpha), 115‑142.
Ghazālī A.H.M., (1989), Le livre des bons usages en matière de mariage (traduit par L. Bercher et G.H. Bousquet). Paris : Maisonneuve.
Giard A., (2008), Dictionnaire du plaisir et de l’amour au Japon, Issy les Moulineaux : Glénat (Drugstore).
Godelier M., (1982), La production des grands hommes : pouvoir et domination masculine chez les Baruya de Nouvelle Guinée, Paris : Fayard.
Greer G., (2003), Les garçons. Figures de l’éphèbe, Paris : Hazan.
Guégan S., (2006), Ingres érotique. Paris : Flammarion.
Haddad M., (2000), Khalil‑Bey. Un homme, une collection, Paris : éditions de l’Amateur (Regards sur l’art).
Hanna J. L., (1988), Dance, Sex, and Gender: Signs of Identity, Dominance, Defiance, and Desire, Chicago : University of Chicago Press.
Kennedy D., (2008) [1993], Sexy Dressing. Violences sexuelles et érotisation de la domination, Paris : Flammarion (Champs Essais).
Khayyām, O. / Hafêz, (1998), Quatrains / Ballades (présentation par V.‑M. Monteil). Paris : Actes Sud (Sindbad).
Kristeva J., (1998), Visions capitales. Arts et rituels de la décapitation, Paris : RMN.
Lacan J., (1994) [1957], Le séminaire IV. La relation d’objet. 1956‑1957, Paris : Seuil.
Leach E., (1980), « Les vierges mères ». Dans : E. Leach, L’unité de l’homme et autres essais, Paris : Gallimard, 77‑107.
Lévi‑Strauss C., (2013), « Problèmes de société : excision et procréation médicalement assistée ». Dans : C. Lévi‑Strauss, Nous sommes tous des cannibales, Paris : Seuil (La librairie du XXIe siècle), 81‑101.
Loyrette H., (2002), L’art français. Le XIXe siècle, 1819‑1905, Paris : Flammarion.
Malabou C., (2020), Le plaisir effacé. Clitoris et pensée, Paris : Rivages.
Malinowski B., (2000) [1930], La vie sexuelle des sauvages dans le Nord‑Ouest de la Mélanésie, Paris : Payot.
Marcadé B., (1995), « Le devenir‑femme de l’art ». Dans : Féminin/Masculin, le sexe de l’art, Paris : Gallimard/Electa, 23‑41.
Merzoug O., (2002), « Abū Nuwās, un poète subversif ». Dans : Poèmes bachiques et libertins, Abū Nuwās (traduit par O. Merzoug), Paris : Verticale/Le Seuil, 7‑28.
Mezziane M., (2008), « Sodomie et masculinité chez les juristes musulmans du IXe au XIe siècle », Arabica, 55, 276‑306.
Michel R., (2000), Posséder et détruire. Stratégies sexuelles dans l’art d’Occident, Paris : RMN.
Monestier M., (2002), Les poils ; histoire et bizarreries ; cheveux, toisons, coiffeurs, moustaches, barbes, chauves, rasés, albinos, hirsutes, velus et autres poilants trichosés, Paris : Le Cherche‑midi.
Montarezi F., (2021), « Who Says Only Men Have A Beard? Revisiting the question of gender ambiguity in Persian poetry », Anthropology of the Middle East, 16/2, dans : C. Fortier (dir.), L’amour poétisé : affects, genre et sociétés. Poetised Love: Affects, Gender and Society, 128‑147. https://www.berghahnjournals.com/view/journals/ame/16/2/ame160207.xml
Moulin A.M., (2011), « L’islam et la question du poil ». Dans : M.‑F. Auzépy et J. Cornette (dir.), Histoire du poil, Paris : Belin (Alpha), 46‑69.
Müller‑Delouis A.F., (2011), « Perspectives anthropologiques sur la pilosité et l’épilation ». Dans : M.‑F. Auzépy et J. Cornette (dir.), Histoire du poil, Paris : Belin (Alpha), 265‑290.
Mulvey L., (1975), « Visual Pleasure and Narrative Cinema », Screen, 16/3, 6‑18.
Najmabadi A., (2005), Women with Mustaches and Men without Beards: Gender and Sexual Anxieties of Iranian Modernity, Berkeley : University of California Press.
Najmabadi A., (2013), Professing Selves: Transsexuality and Same‑Sex Desire in Contemporary Iran, Durham & London : Duke University Press.
Nawawy M., (1991), Les jardins de la piété. Les sources de la Tradition Islamique, Paris : Alif.
Nead L., (1992), The Female Nude: Art, Obscenity, and Sexuality, New York : Routledge.
Obeyeskere G., (1981), Medusa’s Hair, An Essay on Personal Symbols and Religious Experience, Chicago : Chicago University Press.
ORLAN, (2002) [1995], « Conférence Ceci est mon corps… Ceci est mon logiciel…” », 16 ps., https://composicionarqdatos.files.wordpress.com/2008/09/orla‑conference.pdf
ORLAN, (2021), Strip‑tease. Tout sur ma vie, tout sur mon art, Paris : Gallimard (Témoins de l’art).
Ovidie, (2004), Porno Manifesto, Paris : La Musardine (Lectures amoureuses).
Paquet, D., (1997), « Miroir, beauté mon beau miroir ». Dans : Une histoire de la beauté, Paris : Gallimard (Poche).
Patane V., (2006), « L’homosexualité au Moyen‑Orient et en Afrique du Nord ». Dans : R. Aldrich, Une histoire de l’homosexualité, Paris : Seuil, 271‑302.
Peres H., (1953), La poésie andalouse en arabe classique au XIe siècle, Paris : A. Maisonneuve.
Popescu‑Judetz E., (1982), « Kocek and Cengi in Turkish Culture », Dance Studies, 6, 46‑69.
Preciado B., (2000), Manifeste contra‑sexuel (traduit par M.‑H. Boursier). Paris : Balland (Modernes).
Qayrawānī A.M.A., (1979), La Risâla. Épître sur les éléments du dogme et de la loi de l’islam selon le rite mâlékite (traduit par L. Bercher). Alger : Éditions Populaires de l’Armée.
Quignard P., (1996), Le sexe et l’effroi, Paris : Gallimard (Folio).
Quraishi N., (réalisateur), (2010), The dancing Boys of Afghanistan, [documentaire 52 mns], Angleterre, Clover Films. https://vimeo.com/27586143
Riahi J., (1986), « Les soins du corps dans la médecine populaire en Iran », Bulletin d’ethnomédecine, 36, 19‑56.
Riahi N., (2009), « Cheveux et poils au fil du temps : du fœtus au cadavre, pratiques et représentations en Iran en général et à Téhéran en particulier » (non publié, 3 juillet).
Rose S., (2010), Défense du poil. Contre la dictature de l’épilation intime, Paris : La Musardine (L’attrape‑corps).
Rowson E.K., (1991), « The Effeminate of Early Medina », Journal of the American Oriental Society, 111/4, 671‑693.
Saedzadieh Z., (2020), « Trans* in Iran: Medical Jurisprudence and Socio‑legal Practices of Sex Change », Droit et Cultures, 80, dans : C. Fortier (dir.), Réparer les corps et les sexes, 2, Intersexuation, transidentité, reconstruction mammaire, et surdité, https://journals.openedition.org/droitcultures/6551
Saint Phalle N., (2014) [1975], The Devouring Mothers, Paris : Les éditions de l’Amateur.
Sakoyan J., (2002), De la cire au laser : l’adieu au poil dans la société française contemporaine, mémoire de maîtrise d’ethnologie, dans : C. Bromberger (dir.), Université de Provence.
Schicharin L., (2018), « La performativité du corps chez Deborah de Robertis. Ambivalences dans les espaces visuels du féminisme contemporain », Genre, sexualité & Société, 3, https://journals.openedition.org/gss/4522
Schmitt A., (1992), Sexuality and Eroticism among Males in Moslem Societies, New York : Routledge.
Schneider M., (2000), Généalogie du masculin, Paris : Aubier (Psychanalyse).
Schneider N., (2018), « La chevelure féminine et la religion (au Tibet) : entre renoncement et pouvoir », Ateliers d’anthropologie, Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative ‑ Université Paris Nanterre, 0.4000/ateliers.10531
Schopp C., (2018), L’Origine du Monde. Vie du modèle, Paris : Phébus.
Schorske, C., (1983), Vienne, fin de siècle. Politique et culture. Paris : Seuil (Art et Littérature).
Shay A., (2005), « The Male Dancer in the Middle East and Central Asia ». In: A. Shay et B. Sellers‑Young (dir.), Belly Dance: Orientalism, Transnationalism and Harem Fantasy, California : Mazda Publishers, 137‑162.
Sidéris G., (2011), « Jouer du poil à Byzance : anges, eunuques et femmes déguisées ». Dans : M.‑F. Auzépy et J. Cornette (dir.), Histoire du poil, Paris : Belin (Alpha), 95‑114.
Steinberg S., (2001), La confusion des sexes. Le travestissement de la Renaissance à la Révolution, Paris : Fayard.
Suyūtī, S., (1994), La médecine du Prophète, Beyrouth : Dar al‑Bouraq.
Toerien M. et Wilkinson S., (2003), « Gender and Body Hair: Constructing the Feminine Women », Women’s Studies International Forum, 26/4, Oxford : Pergamon Press, 333‑344.
Van Dobben D.J., (2008), Dancing Modernity: Gender, Sexuality and the State in the Late Ottoman Empire and Early Turkish Republic, Electronic thesis : The University of Arizona, Near Eastern Studies.
Vernant J.‑P., (1985), La mort dans les yeux. Figures de l’autre dans la Grèce ancienne, Paris : Hachette.
Viollet F., (2014), Nus rhabillés, Bruxelles : 100 Titres.
Virgili F., (2004), La France “ virile”. Des femmes tondues à la Libération, Paris : Payot (Petite bibliothèque).
Warner M., (1995), « Le vil et le vigoureux, la toison et le poil : des cheveux et leur langage ». Dans : M.‑L. Bernadac et J.‑C. Marcadé (dir.), Féminin‑Masculin, Le sexe de l’art, Paris : Gallimard/Electa, 303‑312.
Yücel T., (2009), La moustache, Paris : Actes Sud.
Zola É., (1977) [1880], Nana, Paris : Gallimard (Folio).
[1].↑.Benjamin Jonson (1572‑1637) est un dramaturge anglais, considéré comme le plus important en Angleterre après son contemporain William Shakespeare (1564‑1616).
[2].↑.Il en est de même dans le christianisme où la barbe est « la marque de la décision divine de donner le pouvoir à l’homme » (Agacinski, 2005, 187).
[3].↑.Proverbe de la société maure de Mauritanie, société arabophone dont le dialecte arabe est le hassāniyya.
[4].↑.Telle la rappeuse française Diam’s.
[5].↑.« Britney Spears : la raison qui l’a poussée à se raser les cheveux en 2007 », Elle, https://www.elle.fr/Beaute/Cheveux/Stars/Britney‑Spears‑la‑raison‑qui‑l‑a‑poussee‑a‑se‑raser‑les‑cheveux‑en‑2007‑3824679
[6].↑.Selon l’expression que celui‑ci utilise dans la préface du catalogue intitulé Collection de son Excellence Khalil‑Bey de 1868.
[7].↑.Le tableau était présenté dans l’exposition du musée d’Orsay intitulée Enfin le cinéma ! organisée par Paul Perrin et Marie Robert du 28 septembre 2021 au 16 janvier 2022.
[8].↑.On pourrait reprendre au sujet de l’Origine du monde les mots de Jean Clair (1988, 116) à propos d’un autre tableau : « […] il traite de l’homme et de son désir, de la femme et de son danger, de la norme et du nu, de l’œil et de sa fascination ».
[9].↑.Le « rhabillage » de l’Origine du monde augurera une longue liste de « nus rhabillés » comprenant différents tableaux de l’histoire de l’art dont le Bain turc.
[10].↑.C’est aussi sa préférée comme elle nous l’a confié le 17 mars 2022 à Paris.
[11].↑.Nous avons préalablement cité ce passage de Freud (1985, or. 1922, 45) qui se termine par cette phrase : « Chez Rabelais, le Diable prend la fuite quand la femme montre sa vulve ».
[12].↑.Théophile Gautier en fait l’éloge en ces termes dans la préface du catalogue aux enchères qu’il a rédigée : « C’est une page importante et si singulière de l’œuvre d’Ingres, une toile amoureusement caressée de son plus suave pinceau, vingt fois quittée et reprise, comme une femme avec laquelle on ne peut se décider à rompre, une sorte de harem qu’il n’a congédié qu’à la fin de sa vie et dans lequel il venait de temps en temps peindre une odalisque ou une nymphe » (Haddad, 2000, 139).
[13].↑.Voir l’émission radiophonique de France Culture « Constance, la femme sans tête », 14 décembre 2019, https://www.franceculture.fr/emissions/une‑histoire‑particuliere‑un‑recit‑documentaire‑en‑deux‑parties/chien‑au‑service‑de‑letat‑12‑mon‑collegue‑a‑quatre‑pattes
[14].↑.Toile nommée Terre érotique.
[15].↑.Claude Lévi‑Strauss ainsi que Marguerite Duras comptent parmi les rares initiés à ce rituel de dévoilement (Haddad, 2000, 381).
[16].↑.Nous y avons effectué un long terrain de recherche.
[17].↑.Que celui‑ci soit épilé ou non comme le remarque pertinemment Devereux (2011, 150) : « Le paradoxe que tant le poil pubien féminin que son absence peuvent stimuler des fantasmes ou des spéculations sur le phallus de la femme reflète bien le besoin de s’accrocher à l’illusion que la femme a un pénis ».
[18].↑.« Valie Export, le féminisme à bras‑le‑corps », par Clémentine Mercier, Libération, le 24 janvier 2018, https://www.liberation.fr/arts/2018/01/14/valie‑export‑le‑feminisme‑a‑bras‑le‑corps_1622358/
[19].↑.Ferenczi (2011, or. 1919, 241) rapporte le cas d’un analysant : « Il raconta ce souvenir d’enfance, qui avait fait sur lui une impression très vive : sa mère lui avait raconté que son frère à elle, quand il était petit, était un “fils à sa maman” ; il était toujours dans les jupes de sa mère, ne voulait pas dormir sans elle, etc. Leur mère n’avait réussi à lui faire perdre cette habitude qu’en se mettant nue devant l’enfant pour l’intimider et le détourner de sa personne. La chose – telle était la morale de l’histoire – avait eu le résultat escompté ».
[20].↑.Ce tableau n’est pas cité par Jaynie Anderson (1997) dans son livre consacré à la figure de Judith dans l’art.
[21].↑.Il s’agit de l’exposition Egon Schiele. Expression et poésie ayant eu lieu au musée Léopold à Vienne du 23 février au 4 novembre 2018.
[22].↑.« Schiele, 128 ans, toujours indécent », par Julie Walter Le Borgne, Beaux Arts magazine, 27 novembre 2017, https://www.beauxarts.com/vu/schiele‑128‑ans‑toujours‑indecent/
[23].↑.Également cité par Patrick Avrane (2011, 305).
[24].↑.C’est le cas dans le rituel maghrébin de virginité nommé tasfih où pour se protéger de l’intrusion du sexe masculin, la jeune fille récite une formule qui fait référence au fil (khit) (Ben Dridi, 2004) en tant que métaphore du pénis de l’homme : « Je suis un mur et le fils d’autrui est un fil ».
[25].↑.Vision qui peut se révéler d’autant plus terrifiante pour l’enfant devenu adulte que sa mère a pu avoir un comportement incestuel à son égard (Fortier, 2019a).
[26].↑.Ces œuvres sont visibles dans le livre du même nom (Saint Phalle, 2014, or. 1975).
[27].↑.L’anthropologue Luc de Heush (1971) parle en ce cas d’adorcisme et non d’exorcisme dans la mesure où la gestuelle de la possédée témoigne d’une forme d’identification à la tarentule.
[28].↑.De Martino (1999, 87‑88) cite par exemple le cas d’une jeune femme, Maria, dont la première morsure fait suite à une déception amoureuse et la seconde à un mariage non désiré.
[29].↑.L’ouvrage de De Martino à propos du Salento est significativement intitulé La terre du remords (Terra del remorso) dans le double sens du « remords » et de la « remorsure ».
[30].↑.Une telle représentation du sexe féminin affleure dans le film Nymphomaniac (2013) du réalisateur danois Lars Von Trier où le personnage féminin est comparé à une nymphe au sens d’un appât constitué d’un hameçon entouré de poils (Malabou, 2020, 105).
[31].↑.Athéna lui dit : « Vis, mais reste suspendue, misérable ! Si tu prétends être si douée pour le tissage alors tu tisseras toute ta vie ! ».
[32].↑.Celle‑ci, d’origine italienne, deviendra elle‑même photographe.
[33].↑.Il en est de même dans la société maure de Mauritanie où nous avons effectué un terrain de recherche.
[34].↑.Et ses dérivés plus ou moins affectueux » : « minou » (Besse, 2003, 49), « minet », « minette », « mistigri », « Mirza », « minou foufoune », « foufounette », « fri‑fri » (Monestier, 2002, 130).
[35].↑.Faute d’autorisation, nous n’avons pu reproduire cette toile qui se trouve au musée Picasso de Málaga en Espagne, on peut néanmoins la voir sur ce lien : https://lewebpedagogique.com/khagnehida/archives/32972
[36].↑.Cette représentation sera maintes fois reprise dans les lithographies de la belle époque et donnera son nom à un fameux caf‑conc parisien, Le chat noir.
[37].↑.Il s’agit de Jaume Sabartés et Esther Williams, Cannes, 23 mai 1957, Barcelone, musée Picasso, don de Jaume Sabartés, 1964, œuvre que nous n’avons pu reproduire faute d’autorisation.
[38].↑.Nous n’avons pu reproduire faute d’autorisation cette eau forte sur cuivre qui se trouve à la BNF à Paris, au département des estampes et de la photographie, IFN‑52513968, mais elle est visible sur leur site ainsi que dans le livre Picasso érotique (Collectif, 2001, 27).
[39].↑.De ce terme dérive le prénom Corinne en français.
[40].↑.Ceci est particulièrement vrai dans sa peinture Nush Eluard (1937) (Staatliche Musem de Berlin, Museum Berggruen, Allemagne, NG MB 54/2000) ainsi que dans son dessin intitulé Nu couché et tête, 13 juillet 1972, qui appartient à une collection particulière et que nous n’avons pu reproduire faute d’autorisation mais qu’il est possible de consulter dans le catalogue Picasso érotique (Collectif, 2001, 55).
[41].↑.Sous forme de talisman ou de pendentif.
[42].↑.On la retrouve sur des amulettes.
[43].↑.On peut voir une de ses performances filmées sur internet sous La Joconde au musée du Louvre, cf. « Le sexe féminin c’est de l’art ? », France Culture, 21 octobre 2017, https://www.franceculture.fr/societe/le‑sexe‑feminin‑cest‑de‑lart Suite à ce type de performance, l’artiste a plusieurs fois été arrêtée pour « exhibition sexuelle ».
[44].↑.« Deborah de Robertis‑Mémoire de l’origine » par Jérôme Lefebvre, le 18 juillet 2014, dust‑distiller.com, https://www.dust‑distiller.com/art/deborah‑de‑robertis‑memoires‑de‑lorigine/
[45].↑.« Le sexe féminin c’est de l’art ? », France Culture, 21 octobre 2017, https://www.franceculture.fr/societe/le‑sexe‑feminin‑cest‑de‑lart
[46].↑.Cette toile a été exposée au musée d’Orsay non loin de l’Origine du monde dans l’exposition Masculin / Masculin. L’homme nu dans l’art de 1800 à nos jours, du 24 septembre 2013 au 12 janvier 2014.
[47].↑.On remarquera qu’on ne retient du modèle que son prénom, alors que le peintre est connu par son nom de famille, différence significative de la hiérarchie entre le peintre et son modèle.
[48].↑.Pour des raisons d’autorisation, nous ne pouvons reproduire ce tableau exposé au musée municipal d’art de la ville de Toyota au Japon.
[49].↑.On peut toutefois douter de cette origine.
[50].↑.Le terme dialectal de sékar dérive du terme arabe sukkar qui désigne le sucre.
[51].↑.Claude Lévi‑Strauss (2013, 86) compare la circoncision à l’excision en tant qu’elle constitue une atteinte à l’intégrité du corps de l’enfant (Fortier, 2020a, 2020c), signalant que la circoncision est moins choquante que l’excision d’un point de vue occidental car elle appartient à un « patrimoine culturel commun judéo‑chrétien » (Lévi‑Strauss, 2013, 87), sans pour autant mentionner qu’une telle pratique relève également du « patrimoine culturel arabo‑musulman » (Fortier, 2012, 2020b).
[52].↑.Selon les sociétés, il pouvait avoir lieu au domicile de la mariée, au hammam, ou aujourd’hui dans un institut de beauté.
[53].↑.Cette pratique a pu être suivie de façon minoritaire à certaines périodes de l’histoire par la catégorie la plus noble de la société, par exemple du Moyen Âge au XVIe siècle (Rose, 2010, 13), usage que les Croisés avaient découvert en Orient (Bromberger, 2010, 96).
[54].↑. Le fait de nommer le sexe masculin « l’organe » renvoie à la différence de valeur qui lui est prêtée relativement au sexe féminin.
[55].↑. On note une légère baisse en 2020 et en 2021 puisque l’enquête a été menée en plein confinement suite au COVID, « Enquête sur les pratiques dépilatoires et le poids des injonctions liées à l’épilation » (2021), d’après un sondage réalisé par l’IFOP pour une plateforme de santé dédiée aux hommes nommée Charles.co, https://www.charles.co/ifop‑pilosite‑intime/
[56].↑. La nymphoplastie serait l’opération sexuelle la plus demandée par les femmes en France, « L’ origine du monde revue et corrigée », par Emmanuèle Peyrret, Libération, 4 décembre 2017, https://www.liberation.fr/france/2017/12/04/l‑origine‑du‑monde‑revue‑et‑corrigee_1614425
[57].↑. Dans la mesure où elle est accomplie avant même la puberté par la mère sur la fille.
[58].↑. Le terme de moustache en arabe dérive de la racine sh‑r‑b qui désigne le fait de boire.
[59].↑. Un autre verset (LII, 24) parle des éphèbes du paradis comme des « perles » : « Pour les servir, parmi eux circuleront des éphèbes à leur service qui sembleront perles cachées » (Coran, trad. Blachère, 1980, 558).
[60].↑. La moustache naissante est aussi appelée métaphoriquement en persan : « plante amour » (mihrgiyāh) ; selon Christian Bromberger (2010, 100), le registre végétal utilisé pour ces premiers poils s’oppose à celui d’ordre animal employé à propos de la pilosité adulte, désignée par un terme (mu) qui s’applique à la fourrure des animaux.
[61].↑. « Source, dans ce jardin, nommée Salsabīl » (Coran, trad. Blachère, 1980, 629).
[62].↑. Celui‑ci est né dans le Sud‑Ouest de l’Iran (al‑Ahwāz, Khūzestān) près de la frontière iraquienne, d’un père arabe et d’une mère persane.
[63].↑. La traduction de l’anglais au français est de notre fait.
[64].↑. Voir par exemple l’histoire de Clémentine Delait (1865‑1939), femme à barbe qui, avec son mari, tenait un café dans les Vosges baptisé Le café de la femme à barbe. Devenue veuve, elle monta des spectacles de cabaret, ou, dirait‑on aujourd’hui, de drag king. Elle assuma jusqu’à sa mort son identité de femme à barbe en faisant écrire sur sa tombe : « Ici gît Clémentine Delait, la Femme à Barbe ». Voir à son sujet la vidéo sur Arte dans la série Invitation au voyage, https://www.facebook.com/arteinvitationauvoyage/videos/282165550088445, ainsi que l’article du Point intitulé « 19 avril 1939. Le jour où meurt la femme à barbe Clémentine Delait », par Frédéric Lewino et Gwendoline Dos Santos, 19 avril 2012, https://www.lepoint.fr/c‑est‑arrive‑aujourd‑hui/19‑avril‑1939‑mascotte‑des‑poilus‑de‑14‑la‑femme‑a‑barbe‑meurt‑d‑une‑crise‑cardiaque‑19‑04‑2012‑1452954_494.php
[65].↑. Marina Warner (1995, 309) rapporte qu’à la statue de la sainte se trouvant dans la chapelle d’Henri VII à Webminster Abbey étaient offertes des offrandes d’avoine, ce qui fait dire à Thomas Moore : « Les femmes […] croient que pour un grain d’avoine sainte Encumber ne manquera pas de les désencombrer (encumber) de leurs époux » (citation de D.H. Farmer, The Oxford Dictionary of Saints, Oxford, Oxford University Press, 1977, 404).
[66].↑. La Légende Dorée (1261‑1268) de Jacques de Voragine (1998) a largement diffusé le récit du martyre de Saint Agathe dans le chapitre XXXVIII intitulé « Sainte Agathe, vierge et martyre ».
[67].↑. Le christianisme est sans doute moins monothéiste qu’il ne l’affirme.
[68].↑. Il en est de même de la figure drag queen de Conchita Wurst (autrichien, né en 2011) qui gagna en 2014 le grand prix de l’eurovision en arborant, tel Jésus Christ, une barbe couplée à des cheveux longs.
[69].↑. Ceux‑ci ont par ailleurs été historiquement confondus comme l’observe Christian Bromberger (2010, 73, note 110) qui se réfère à cet égard à plusieurs historiens.
[70].↑. La Sainte Face de Laon. Le mandylion dans l’art orthodoxe, Seminarium Kondakovanium, Prague, 1931, 34.
[71].↑. Celui‑ci la teignait à la fin de sa vie au henné (Moulin, 2011, 48). Certains des poils de barbe du Prophète sont conservés tels des reliques à la mosquée du Barbier à Kairouan en Tunisie ainsi qu’à la mosquée « petite Sainte Sophie » à Istanbul en Turquie avant que ces derniers ne fassent l’objet d’un vol en 1999 (Monestier, 2002, 248), voir aussi à ce sujet « Un poil de la barbe du Prophète volé dans une mosquée d’Istanbul », L’Orient le jour, 4 septembre 1999, https://www.lorientlejour.com/article/294135/Un_poil_de_la_barbe_du_prophete_vole_dans_une_mosquee_dIstanbul.html
[72].↑. Nous n’avons pas vu ce type d’image en 2015 lors de notre séjour en Iran.
[73].↑. Il s’agit de la grande mosquée de Gowharshad à Mashad (Bromberger, 2007, 381).
[74].↑. Comme le montre son autre bras nonchalamment posé sur l’entrejambe de Jupiter.
[75].↑. https://labarbelabarbe.org/